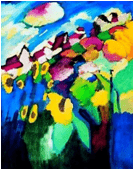
EPhEP, MTh3-CM, le 8/02/2018
Alors pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire que vous m’avez peut-être déjà entendu raconter, je ne sais pas ; enfin comme c’est une histoire que j’aime beaucoup, je vais au moins me faire plaisir et la raconter une seconde fois pour ceux qui ne l’auraient pas entendue, pardon pour ceux qui l’auraient déjà entendue.
C’est l’histoire d’un petit garçon qui devait avoir trois ans et demi, un petit costaud, un petit mec comme ça, solidement musculaire, bien baraqué, et que sa maman m’amenait pour hyperactivité.
« Hyperactivité » disait-elle et je dois dire qu’elle ne mentait pas, parce qu’une fois dans mon bureau, j’ai été extrêmement impressionné par le fait qu’il ne pouvait rester en place et passait son temps littéralement comme une mouche à aller se cogner d’un mur à l’autre, dans un mouvement absolument incessant, sa mère étant incapable de l’inviter à s’asseoir ou à s’arrêter un moment ; et moi-même si je l’attrapais pour essayer d’entrer en contact avec lui, je déclenchais manifestement chez lui une angoisse qui faisait que je le relâchais aussitôt.
Il s’appelait petit Louis, ce garçon par ailleurs délicieux, mais pris dans ce tourbillonnement. Et comme au bout de dix minutes, il était épuisé, il allait se coucher au pied du divan, il s’endormait pour trois quatre minutes, et hop ! il ressortait, il reémergeait, et ça recommençait.
Il est évident que c’est l’école – la mère, elle, s’y était faite, elle s’était habituée – mais il est évident que c’est l’école qui avait jugé qu’il fallait voir quelqu’un.
Je le vois une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et à chaque fois ce tableau qui allait plutôt en s’amplifiant, si c’était encore possible encore plus rapide, encore plus agité, encore plus vite épuisé. La maman était évidemment seule, fort sympathique, intelligente, décidée à faire ce qui pouvait être fait. Qu’est-ce que je pouvais bien faire ? Je me disais : « je ne vais quand même pas lui prescrire de la Ritaline ! Ce n’est pas possible ! ».
Alors je me dis, perdu pour perdu, je vais lui casser le morceau. Et je lui dis : « Écoute, moi je comprends que tu t’agites comme ça, parce que tu ne sais vraiment pas où te tenir. Tu ne sais pas où te tenir parce qu’à la maison, eh bien maman reçoit beaucoup d’amis, et puis il arrive qu’il y en ait qui reste dormir à la maison avec elle – je dis tout ça devant la mère ; et ça ne te plaît pas beaucoup, tu n’es pas content, ça ne te va pas ! Et puis quand tu vas chez papa qui vit maintenant avec une amie, tu as vu qu’elle attendait un bébé ; et l’idée comme ça d’avoir un petit frère ou une petite sœur, ça ne te plaît pas du tout ! » Pendant que je lui dis ça, si on pouvait imaginer que plus d’agitation était possible, alors il aurait marché au plafond ! Et puis il attrape sa mère par la main et il lui dit – « Viens, on s’en va ! » Parce qu’il était autoritaire, je vous le dis un vrai petit mec de trois ans et demi ! La mère me regarde, je lui dis : « Eh bien oui, bien sûr, vous pouvez partir ».
À l’époque mon bureau était situé un étage au-dessus de la salle d’attente, de telle sorte que pour y accéder il fallait monter un escalier assez raide, un escalier en bois. Et petit Louis dégringole cet escalier, en sautant au moins deux marches à chaque fois. Je me dis qu’il va se fracasser une fois en bas. Il y avait des patients en bas qui étaient effrayés de le voir dégringoler les escaliers à cette allure, moi aussi. Il arrive en bas et il remonte tout aussi vite, quatre à quatre ; il me dit - moi j’étais là évidemment plutôt perplexe - il me dit – « Viens, je vais te faire un bisou. » J’ai revu la mère toute seule la semaine suivante qui m’a dit : « L’école demande si je peux leur donner votre adresse parce que… » Voilà !
Ça paraît quoi ? Ce n’est pas de l’ordre essentiellement magique, mais ça nous donne un éclairage utile sur ce qui est en cause. Qu’est-ce qui est en cause pour cet enfant ? Ce qui est en cause est extrêmement simple : c’est qu’il n’a de place nulle part. C’est-à-dire qu’il ne trouve sa place ni chez sa mère où sa filiation n’est plus assurée du fait de ces hommes de passage auxquels il ne peut même pas s’attacher. Elle est défaite du côté de son père pour les raisons que je vous ai dites. C’est donc très exactement ce qu’à Reins j’ai pu appeler un SDF, des gosses qui n’ont plus de domicile fixe. Plus de domicile fixe, sauf que lui n’avait plus de domicile du tout ! Et dans ce cas-là, la seule façon de se rappeler à l’existence, c’était cette épreuve musculaire, celle de sentir son corps, et dans ce mouvement de témoigner qu’il était vivant par cette agitation, d’où l’angoisse quand j’essayais de l’attraper.
Avec ce que je lui ai dit, qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que j’ai fabriqué ? Je veux dire il ne suffit pas de se contenter de se sentir soulagé, d’avoir sorti des énormités à un gosse, et de constater qu’effectivement c’était ce qu’il fallait. Qu’est-ce que je lui ai dit ? Pourquoi il s’est calmé ? Je ne l’ai pas inscrit spécialement dans sa filiation, c’est-à-dire dans celle qu’il tient de son père et de sa mère. Je n’ai rien fait de tel !
Ce que j’ai fait, c’est que je lui ai permis de rencontrer un lieu où « on savait ». Il y avait un endroit où son histoire, on savait ce qu’elle était. Il y avait un lieu de savoir. Donc, du même coup, dans un espace que l’on peut imaginer pour lui absolument compact, se dégageait une sorte d’enclos privilégié. Il y a un endroit où il y a du savoir, et donc dès lors où en tant que tel il est inclus, il a trouvé une habitation dans le savoir d’un autre.
C’est bizarre de dire tout cela ! Mais néanmoins, puisque je fais des hypothèses sur ce qui a pu se produire, et il faut bien essayer d’en rendre compte, c’est vraisemblable. Donc il y avait un endroit où il était fiché, où il était répertorié, où il était inscrit. On savait que pour les enfants c’était comme ça, et lui en était. Dès lors il avait cette place artificielle, mais en tout cas suffisante pour faire qu’il se pose, qu’il s’arrête, qu’il puisse commencer à jouer avec les autres. J’ai revu la mère seule, plusieurs fois ensuite, et ça continuait à aller comme on pouvait l’espérer.
Alors pourquoi est-ce je commence ce soir par cette histoire que j’aime bien ? Je commence par là pour attirer votre attention sur le fait qu’il n’est absolument pas classique de dire - il n’est pas classique non plus même chez Freud - que ce qui est déterminant pour un sujet c’est la place qu’il occupe. Pour un sujet banal, quelconque, ordinaire, cette place n’est pas arrêtée une fois pour toute ! Il doit être capable, selon les circonstances, les relations, les époques, les activités, les engagements, de changer de place. Il y a une place où il parle en maître, il y a une place où il est aux ordres, une place de contestation, il y a une place où il peut faire merveille, enfin il y a une diversité, on va dire, de rôles. Ce ne sont pas des rôles, ce sont des places. Et ce qui fait partie si je puis dire de la norme, c’est évidemment la capacité, selon les circonstances, d’être capable de tenir ces diverses places. Tenir ou ne pas pouvoir tenir !
Par exemple, si on a du caractère comme cela se dit, on ne cède pas à cette sollicitation. Ce qui manifeste le fait qu’avoir du caractère c’est témoigner d’une certaine résistance à cette mobilité, et le fait qu’on entend à chaque fois maintenir - on va appeler ça comme ça - sa personnalité. Hein ? Puisque le comble du caractère, c’est évidemment une position – dont je serai peut-être amené à dire un mot tout à l’heure, si j’y arrive – et qui est la position dont je voulais vous parler, c’est à dire la position paranoïaque. Celle de celui qui est immuable, figé dans le bronze.
Je me demandais en préparant ce cours, si Lacan était mobilisable, souple, ou bien est-ce qu’il était plutôt du côté caractériel ? Vous voulez que je vous réponde ? Je ne vous répondrai pas, je n’en sais rien ! (rires).
Il faut dire que les rapports, en ce qui me concerne, que je pouvais avoir avec lui étaient des rapports d’élève à maître, ce qui implique effectivement une certaine fixité de sa position. Mais je peux dire aussi, puisque ce que je vous dis m’amène à y penser, qu’il lui arrivait à l’intérieur de cette relation de changer de place. Ça pouvait lui arriver, et même il sollicitait qu’on ne soit pas toujours à le figer à la même place.
Repartons d’un évènement banal et simple, que chacun d’entre vous aura pu mettre à l’épreuve et dont on va essayer de tirer les conséquences, on va tirer le fil.
Cet évènement simple, c’est ceci : vous avez tenu un propos que vous aviez mis bien sûr au compte du je, il y a je qui a dit ça, et vous vous dites : « mais qu’est-ce que je suis en train de dire ? » Vous vous demandez cela parce que ce qui vous a échappé, qui s’est trouvé mis au compte du je, eh bien en général, presque toujours, concerne la levée du refoulement. C’est donc l’expression d’un désir, une expression sexuelle, formulation de sens sexuel, crue, mais aussi – j’attire votre attention là-dessus parce que ce n’est pas toujours bien mis en valeur, bien cadré – mais aussi des intentions agressives.
Parce que ce qui est refoulé c’est le sexuel, sûr ! Mais ce qui est refoulé aussi ce sont les vœux de mort. Pourquoi les vœux de mort sont-ils refoulés ? Pourquoi ? Les vœux de mort pourraient simplement être niés, effacés, récusés ! Pourquoi y a-t-il besoin de les refouler ? C’est-à-dire de faire comme si ils ne devaient pas exister, comme s’ils n’avaient pas à exister ?
C’est ça qui doit nous mettre la puce à l’oreille. Ce qui doit nous mettre la puce à l’oreille, c’est que si c’est refoulé, c’est donc que ça a une parenté avec le sexuel, seul à être refoulé. Ce qui connaît le processus du refoulement ce sont le sexe et les vœux de mort.
Donc question : quelle est l’instance – j’y reviens, il faut revenir là-dessus, on n’en prend pas toute la mesure – quelle est cette instance qui a commandé cette parole qui vous a échappé, et qui a pu être porteuse de l’expression d’un désir jugé peut-être à tel moment, ou dans telle situation, ou dans telle circonstance, inconvenante (pas du tout de l’ordre de la séduction mais de l’inconvenance), ou bien un vœu de mort ? On rencontre l’autre et puis paf ! Ce qui surgit c’est : « T’es encore là toi ? T’es encore avec nous ? »
Ce qui est essentiel, c’est que tout ceci est articulé à notre insu à partir certes d’une place dans l’Autre – pour se servir d’un vocabulaire que vous avez déjà dû maintes fois entendre – d’une place dans l’Autre, et à partir d’une instance qui est donc l’instance phallique, que Lacan écrit le grand « Φ » puisque c’est l’instance qui pour être en quelque sorte préservée dans le réel, n’aurait même pas à être nommée. Car si je la nomme, je la fais rentrer dans le champ de la réalité. Or c’est dans le réel qu’elle se tient ! Théoriquement il faudrait faire comme pour Dieu, en rendre compte par un tétragramme, par un nom imprononçable, ou alors par la façon de le dessiner « Φ ». Voilà c’est grand Φ !
Attention, ça signifie que dans ces cas-là, tout se passe comme si c’était lui qui avait parlé par ma bouche. Ma bouche a véhiculé, malgré moi, une chose inconvenante, marquant la levée du refoulement. Voilà quand même qui nous fait faire un petit progrès au-delà de ce qui est assez banal : c’est la même instance qui « rencontre », qui rend compte du désir sexuel (j’ai dit qui « rencontre », je vous dirais pourquoi) qui rend compte du désir sexuel et des vœux de mort ! Ça alors ! Et la preuve en est c’est que les deux sont refoulés de la même façon.
Freud a essayé de s’en sortir en conceptualisant ce qu’il en serait d’un instinct agressif : Thanatos, le vœu de mort. Il y aurait Éros et il y aurait Thanatos. Dans ce très mauvais article qui s’appelle Pourquoi la guerre ?Warum Krieg ? (c’est impressionnant ça pourquoi la guerre ?), il l’explique par ce qu’il en serait de l’instinct agressif qui paraît-il nous habiterait.
Comme nous le savons, il y a des circonstances où cet instinct tant agressif, a libre cours dès lors qu’il est collectivement recommandé : lorsqu’on fait partie d’une armée par exemple. À ce moment-là, il y a cette levée du refoulement qui d’ailleurs se trouve volontiers conjoindre du même coup la levée du refoulement sexuel. Comme c’est bien connu, les armées, ça manque de pudeur, et de respect des dames.
Mais ce qui est pour nous plus intéressant, c’est que l’instance organisatrice, responsable, autoritaire, du désir sexuel, n’est pas sans nous rappeler que la reproduction sexuée est marquée par la mort, la mort de l’organisme sexué. La reproduction sexuée est un mode qui implique la mort de l’organisme dont la reproduction opère de cette manière.
Heureusement il va y avoir de très grand progrès un de ces jours, on va se reproduire par scissiparité. Hein, on abandonnera une moitié de nous-mêmes, comme ça, et puis il y aura l’autre, et on sera immortels ! Je blague évidemment, ne me prenez pas cela au sérieux pour la scissiparité, ça ne va pas nous arriver tout de suite ! Mais ce que je veux dire, c’est que tant que nous sommes dans la reproduction sexuée, nous sommes évidemment promis du même coup à la mort, comme si la même instance dirigeait aussi bien la vie que la mort, qu’Éros et Thanatos étaient les deux faces de la même instance. Ça a un certain intérêt clinique évidemment. Il y a un grand nombre de conduites et de faits qui viennent s’inscrire sous le signe du droit de vie et de mort que cette instance possède.
Ce qui nous complique la tâche, c’est que cette instance qui ainsi nous mène, c’est aussi celle qui est responsable de la castration : nous avons à faire le sacrifice d’une part de jouissance, en particulier sexuelle évidemment, mais sans doute aussi d’une part de jouissance létale. Il n’y a pas à vouloir aller ainsi jusqu’au bout et à jouir de la mort. Nous avons donc à renoncer à une part de jouissance pour accéder à la jouissance sexuelle.
Le dilemme qui se maintient actif, en général, c’est que le curseur entre la part à sacrifier et le désir à accomplir, ce curseur bizarrement est mobile, non seulement selon les individus, selon les personnes, mais également dans la culture, je veux dire dans l’opinion elle-même ! Dans l’opinion elle-même, on ne sait jamais s’il faut admirer la sainte, l’ermite, ou bien s’il faut admirer au contraire le bambocheur, celui qui ne se refuse rien ; et on est capable dans la même foulée d’admirer l’un et l’autre ! Sauf que lorsque ça concerne chacun, c’est évidemment plus compliqué, et il faut bien reconnaître que c’est l’une des sources du malaise dans la culture. Qu’est-ce que je dois ? Qu’est-ce que je me dois ? La réponse n’est pas toujours claire en tout cas il n’y a pas de réponse inscrite. C’est dire il aurait fallu une réponse inscrite, savoir que « voilà, la limite est là ». Eh bien non, cette limite n’est pas inscrite, donc chacun peut y aller selon son cœur, selon son bon ou son mauvais cœur : la part qu’il va laisser dimanche matin à la quête, ça le regarde.
Alors une toute légère complication, une toute petite, toute petite, mais qui est intéressante : c’est que ce désir dont je fais état et qui donc a donné la parole à l’instance directrice est doublé par un autre désir et que celui-là n’est plus autorisé. C’est le désir du sujet, ce désir qui justement ne peut s’autoriser de rien ni de personne si ce n’est de lui-même : le sujet du fantasme. Le sujet lié à la perte irréductible de l’objet et qui anime donc un désir privé. On va dire que le premier désir c’est en quelque sorte le désir collectif, c’est le désir public, en tant que j’y participe, j’y participe comme individu, l’individu d’une collectivité.
Tandis que le second, plus discret, c’est le désir propre à un sujet, celui de la perte d’objet. Mais d’où vient la parole de ce sujet ? Elle ne vient plus de cette instance Une, qui dans le cas du désir public représente le trou dans l’Autre d’où ça parle. Mais dans le cas de ce désir subjectif, personnel, privé, clandestin, propre au sujet du fantasme, le désir de ce sujet-là est parlé depuis, non plus donc de ce Un qui représente l’être de cette instance, mais depuis le trou lui-même ! C’est du trou vide que ça parle. Sauf que ce trou a été investi par une partie du corps : c’est le fameux objet petit a dont vous avez tellement entendu parler je pense, une partie du corps : le regard par exemple, la voix, le caca, chez Freud il y a également le sein ; l’objet a organisé l’espace dans lequel ce désir va se manifester. Que veut dire « l’espace dans lequel ce désir va se manifester » ?
Ceux d’entre vous qui avez voulu vous distraire en regardant ce que Lacan a appelé Télévision, c’est-à-dire cette émission de télévision qu’il a assurée avec Benoît Jacquot, qui est très intéressante ; si elle vous paraît difficile, comme le texte en a été publié, ça peut aider, publié et un peu commenté (enfin bon, peu importe !). Mais c’est un texte très intéressant, parce que Lacan a une formule très énigmatique dans cette émission. Il dit : Je parle pour un regard. Pour un regard ! Qu’est-ce que ça veut dire ça ? Je parle pour un regard ! Ce n’est pas quand même pas parce qu’il y a des gens qui vont le regarder qu’il parle pour un regard ! On pourrait aussi bien dire qu’il parle pour des oreilles ! Je ne sais pas ! Ou pour ceux qui ont du flair qu’il parle pour leur nez. Qu’est-ce que veut dire qu’il parle pour un regard ? Eh bien cela veut dire que l’écran en quelque sorte qu’il se trouve là animer, l’écran qui le supporte, n’est pas l’écran traditionnel en tant que justement il est référencé ordinairement à l’instance phallique, c’est-à-dire où il s’agit sur cet écran référencé à l’instance phallique d’être un homme ou d’être une femme, d’une façon binaire, l’alternative. Mais là il parle pour un espace référencé par un objet, l’objet petit a, référencé par le regard. Les valeurs y sont complètement différentes, puisque là il ne s’agit plus, si je puis dire, de porter les insignes phalliques et de commémorer l’autorité phallique, mais il s’agit d’essayer de faire place à ce qu’il en est de ce désir singulier, celui du sujet du fantasme.
Mais alors vous me direz : tout à l’heure vous nous avez dit que ce qui parlait dans le premier cas, c’était le phallus qui se donnait à entendre ; et là ce sujet du fantasme, ce sujet de ce désir privé, sujet d’un désir privé et animé non plus par un ou une partenaire mais par un objet, sujet pour lequel ne se pose plus nécessairement la question de son identité sexuelle ! Non mais vous vous rendez compte de tout ce truc, de tout ce que ça brasse, tout ce que ça remue comme virtualité ?
Ce sujet qu’est-ce qui le représente ? Qu’est-ce qui en est le support ? Eh bien ce qui en est le support c’est, dans le grand Autre, là encore ce trou lui-même ! Ce trou lui-même et en tant que ce sujet peut aussi facilement devenir le sujet hystérique, c’est-à-dire celui qui réclame que sa parole soit autorisée par un maître, que dans ce lieu vide, d’où elle parle, vienne le maître qui autoriserait sa parole, ce qui lui permet de dénoncer l’impuissance paternelle à ne pas être ce maître pour elle.
Alors on m’objectera, on dira : spéculation ! Sauf que - là je viens d’évoquer au passage l’hystérie - mais si vous considérez cette névrose que je pense toujours comme une des plus belles constructions architecturale que l’on puisse rêver, plus belle que le château de Kafka, vous constatez que dans ladite névrose le névrosé est sans cesse encombré par toutes les formulations qui lui viennent. On appelle ça « des idées ». Ce ne sont pas des idées ! Les idées c’est autre chose ! Ce sont des formulations, des formules qui sans cesse lui passent par la tête et qui sont des formules extrêmement typées, puisque d’abord elles sont justement d’une sexualité systématiquement scatologique, et puis d’une agressivité absolument mortifère.
Donc notre brave obsédé vit dans le tourment de ce qui sans cesse ainsi l’assiège, l’obsède. Le terme allemand c’est Zwangsneurose, c’est-à-dire névrose de la tenaille. Zwang c’est une tenaille. Il est pris en tenaille, entre deux formulations. Il est coincé. Et là ce qui parle, eh bien justement ce n’est plus le trou du sujet qui donne abri au sujet hystérique, c’est l’objet a qui lui-même, qui dans le cas de la névrose obsessionnelle est entre autre anal, fécal, et qui ne cesse littéralement, vous me permettrez cette expression, « de l’emmerder ». L’obsessionnel est un type sans cesse emmerdé, et c’est pourquoi il passe son temps à se laver les mains ou les mains sous le robinet.
Ce n’est pas beau tout ça ? Vous n’êtes pas sensibles à la beauté de cette affaire ? Parce que moi, quand je suis arrivé au début dans les hôpitaux psychiatriques, il y avait systématiquement dans les salles les malades obsessionnels qui étaient traités comme des fous ! Ce ne sont pas du tout des fous ! Ce sont des névrosés ! Et en tant qu’obsessionnels, ils reconnaissent parfaitement que ces voix, qui ne sont pas des voix puisqu’elles ne sont pas hallucinées, mais se présentent comme se présentent à nous nos propres pensées : « Tiens maintenant je vais aller chez le boulanger ». Vous ne l’avez pas entendu quand vous vous l’êtes formulée ! Et cependant c’est une pensée qui vous a traversé l’esprit. Ce qui leur traverse l’esprit, et qui leur paraît intolérable ce sont les pensées « qu’il ne faut pas », les pensées où c’est cet objet-là qui parle ! Pourquoi il est là ? Eh bien parce que les obsessionnels ne l’ont pas cédé ! Ils ont refusé de le céder ! Ils ont refusé cette opération de castration ; et c’est pourquoi entre autres, la constipation sera un compagnon traditionnel. Donc ce qui risquerait de vous paraître pure métaphore, ou pure imagination, ou pure invention vous en avez si facilement si je puis dire des illustrations cliniques absolument saisissantes !
Pourquoi n’ont-ils pas voulu le céder ? Cela les regarde ! Pourquoi est-ce qu’ils céderaient l’objet d’un plus-de-jouir ? Pourquoi ils en feraient profiter l’Autre ? Si l’Autre, si la maman semble accorder tellement de prix au cadeau que lui donnera son petit enfant, pourquoi est-ce qu’il accepterait de le céder ? Autant se le garder après tout ! Et puis pourquoi accepter de vivre dans ce monde fait de pur semblant ? Pourquoi ne pas avoir un rapport avec un bout de réel ? Je veux dire aussi qu’il y a donc dans le cadre de la névrose obsessionnelle une jouissance, qui est celle que Lacan appellera celle du plus-de-jouir. Vraiment je vous recommande toujours de reprendre toujours cette lecture de L’Homme aux rats et vous verrez combien dans les rêves ultimes que fait l’Homme au rats et qu’il raconte à Freud confirme ce que je viens de vous exposer.
Vous savez, ce que je vous raconte là, c’est lui qui vous le dit. C’est absolument magnifique !
Ceci étant, j’aimerais vous poser une question. Comment se fait-il qu’un enfant, quatre ans, cinq ans, perçoive que s’il est l’objet de privauté sexuelle de la part d’un adulte, ce n’est pas bien, c’est une faute ! Comment ça se fait ? Qui lui a appris ça ? D’où est-ce que ça sort ? C’est un adulte ! C’est quand même lui qui sait ce qu’il faut faire ! Pourquoi est-ce que ça lui apparaîtra à cet enfant comme quelque chose qui ne va pas ? Qui ne convient pas ? D’où est-ce qu’il a ce savoir ? Mais c’est un savoir qui va beaucoup plus loin ! Parce que s’il assiste à l’adultère d’un de ses parents, l’un ou l’autre, là aussi il pensera que ça ne va pas ! Pourquoi ? Qu’est-ce qui lui permet de savoir ainsi, qui le lui a enseigné ? Il a été à l’école pour qu’on lui apprenne ça ? Et pourtant il le sait que ça ne va pas, que ça ne convient pas. Comment se fait-il que non seulement il s’intéresse tout de suite à la différence des sexes, pourquoi ça l’intéresse ? En quoi est-ce un objet particulier d’intérêt ? Il pourrait s’intéresser à la nature, aux petits oiseaux, à son chat, à ses jeux … Pourquoi ça l’intéresse ? Pourquoi ça lui fait problème ? Il fait plus que s’y intéresser, parce qu’à l’exemple du petit Hans, il va très vite faire la différence entre le fait que celui qui porte l’insigne phallique, l’insigne du commandement, n’est pas nécessairement celui qu’on croirait. C’est quand même fort de la part d’un gosse ! Le petit Hans il a quatre ans, cinq ans à ce moment-là, il s’aperçoit que l’insigne, il n’est pas accroché là où sensément il devrait être. Il cherche à le voir, car Dieu sait s’il se met en peine pour l’apercevoir chez celle dont il a reconnu que c’est elle qui le portait. Eh bien il ne voit rien ! Mais réfléchissez à l’importance que ça a dans notre rapport à la perception. Il voit bien qu’il ne voit rien et il sait que c’est là. Cela peut être là et cependant il n’est pas là !
Donc posons-nous la question : et d’où tient-il ce savoir ? Et d’où va-t-il très vite inventer cet amour pour sa mère en sachant qu’il aura à y renoncer ? C’est-à-dire s’attachant à celle dont il sait déjà qu’il y aura à la perdre. Est-ce qu’on se demande tout ça ? C’est là qu’il faut bien s’incliner devant l’évidence. Il n’a découvert tout ça que, tout simplement, parce qu’il a appris à parler. C’est véhiculé tout ça ! Tout ce savoir est véhiculé par le langage. Pas le langage qui dit que c’est comme ça, pas du tout ! Mais c’est ce qu’il a appris, qu’il a entendu, qu’il a déchiffré ; il a compris que c’est de ça dont il s’agissait.
Pourquoi est-ce, qu’entre autres, ça nous intéresse ? Lacan, à ce sujet, dit une chose que d’ailleurs vous avez peut-être entendue : il dit que le décalogue, les dix commandements : tu ne tueras point, ton père et ta mère quittera etc. il y en a dix comme ça ! Le décalogue ce sont les lois du langage. On en a fait une révélation et on a voulu y mettre la voix pour que ça fasse autorité, comme on vient de le voir là tout à l’heure, c’est essentiel la voix pour faire autorité, faut qu’on l’entende ! Mais Lacan dit que le décalogue, c’est tout simplement les lois du langage, et c’est de là que l’enfant sait à l’avance que son objet chéri il aura à le perdre. Pas seulement parce que sa maman éventuellement elle a peur elle aussi de perdre son objet chéri, ce qui fait qu’elle va vérifier le soir dans son berceau s’il respire bien. Elle sait qu’en outre, et en espérant qu’il respire bien, que de toute façon le petit chéri il va grandir et qu’elle va le perdre.
D’où est-ce que le petit chéri il a compris tout ça ? Parce que pour comprendre tout ça, il faut le langage, mais il faut aussi occuper une certaine place. Et donc j’y reviens à cette affaire de place. Il faut occuper une certaine place. Parce que si le petit chéri est élevé en institution, il n’aura pas cette place qu’il faut pour déchiffrer tout ça et ça peut lui manquer pendant longtemps de comprendre ce qui se passe.
Quelle est la place du petit chéri ? Est-ce que vous avez des propositions à faire ? On a tous été pour l’essentiel des petits chéris, ou presque des petits chéris, ou des moitiés de petits chéris. Alors quelle place ? Je n’entends pas ! Quelle place il occupe le petit chéri ? Pour pouvoir déchiffrer tout ça ? Quoi ? Quelle place ?
Vous brûlez tous, vous n’êtes pas très loin malgré tout mais bon ! Il occupe la place, il est un « mini phallus », tout à fait. Mais sous sa forme mini, c’est-à-dire sous sa forme charmante. Parce que le maxi, lui, il vous commande sans répit et sans pardon ! Il faut y aller hein ! Il faut y passer ! Mais petit comme ça c’est-y pas beau ? C’est-y pas délicieux ? Et puis on le voit grandir, jusqu’au moment où il vous claque la porte à la figure. Eh bien c’est donc de venir occuper cette place, lorsqu’il n’est pas dérangé par la venue d’un frère ou d’une sœur d’ailleurs, car c’est là le grand problème, c’est quand il est évacué de cette place ! C’est le cas du petit Hans justement avec la naissance de sa sœur.
Topologie, topos. Vous voyez l’importance de la géométrie qui rendrait compte de l’organisation de ces places. Aussi bien Descartes que Spinoza ont voulu fonder une philosophie de l’entendement sur le mode géométrique. Bravo ! Sauf que c’est évidemment la géométrie euclidienne ! Et donc l’invitation par la psychanalyse, qui est faite par ce mode de repérage de passer à une forme de géométrie qui ne vous est absolument pas familière, et à moi non plus. Je veux dire qu’il est évident que rien dans nos études secondaires, ou autres, n’est venu nous donner le moindre aperçu de ce que c’est que la topologie.
La topologie, pour ceux d’entre vous qui auront envie d’ouvrir un bouquin, c’est la science du continu. Or il se trouve que le continu, on peut l’entendre intuitivement. Le continu c’est l’organisation de l’inconscient. La topologie joue de ceci, c’est que la coupure vient modifier la structure de la forme ainsi sollicitée. La topologie c’est fait du continu et de la coupure. C’est-à-dire si la coupure est ce qui détermine la place dans le continu, vous voyez immédiatement la tentation d’une homologie entre topologie et organisation de l’inconscient, d’une homologie qui n’est pas analogique. Homologie qui laisse penser que l’organisation de la vie psychique est faite par ce mode de structure, puisque c’est à partir de lui que nous allons saisir enfin, ce qui caractérise la psychose - tout ce que je vous ai raconté ce soir ou repris ce soir, vous le met quasiment à portée de main - le caractère de la psychose, c’est que pour le sujet, dans son rapport au langage, il n’y a plus de place. Mais ce n’est pas seulement qu’il n’y a plus de place, parce que quand je dis « place », il ne faut pas oublier qu’une place fait partie d’un système qui est déjà symbolisé. Tandis que pour le psychotique, la notion même de place fait défaut. De telle sorte que ce qui va le caractériser, c’est que pour lui ça parle de multiples lieux imprévisibles, et dont il ne pourra le moins du monde avoir la préscience de ce que ça pourrait dire, de qui parle, de ce qu’on lui veut, du caractère incohérent entre les diverses formulations qui lui parviennent et qui parfois impliquent les siennes propres, comme si ses propres formulations étaient hallucinatoires. Jusqu’à ce que dans cette organisation de ce que sont les délires, se met en place - se met en place ! - se dessine le fait que ces propos absurdes qui lui viennent de lieux absolument imprévus avec des voix imprévues, lui disant des choses absolument incohérentes mais auxquelles il doit répondre ou ne pas répondre, finalement, ces voix viennent se regrouper autour de cette idée qu’elles auraient toutes en commun de lui signifier qu’il est en trop, qu’il n’a pas à être là, c’est-à-dire qu’il n’a pas de place. Il doit se tirer. C’est bien ce qui fait qu’évidemment il y a des cas où le bonhomme se tire effectivement. Il prend ça au sérieux et puis il se tire pour de bon. Ou bien il va comprendre que s’il se met à l’extérieur du système (pas à l’intérieur mais à l’extérieur), c’est-à-dire dans un lieu qui vaudra comme Autre, l’Autre du système, eh bien là c’est peut-être bien sa place, être dehors, trouver sa place en étant dehors. Et du même coup, pour que ce dehors ne soit pas un lieu d’exil mais soit un lieu Autre, il doit se féminiser. C’est l’histoire dont vous avez déjà entendu parler largement, celle du président Schreber. C’est une question de place. Il a pu par son intelligence, par son génie, par son courage et contre l’avis de tous, il a pu comprendre que sa place était dehors ; et pour que cette place soit habitable, il pouvait la transformer en lieu Autre à condition de se féminiser.
Je ne sais pas de quelle façon vous recevez tout cela. Moi je dois dire à chaque fois, je trouve ça révoltant, car les déterminations sont comme vous le voyez, et comme le dit Schreber lui-même, complétement indifférentes à l’espèce humaine, elles se moquent complétement de celui qui est pris dans l’affaire, dans le système. En même temps c’est enseignant. Et je dirais, c’est d’une rigueur qu’on aurait envie de dire scientifique ! Scientifique parce que quoi que vous en pensiez, ça ne change rien à l’affaire. C’est comme ça !
Et voilà bien pourquoi la psychose est la porte d’entrée dans l’interprétation de la vie psychique, et qu’on ne saurait trop vous recommander justement de vous intéresser aux cas cliniques et aux malades. Chacun d’eux est à part, chacun d’eux est un prototype, aucun ne ressemble à l’autre, et cependant chacun d’eux est une construction qui vaut qu’on s’y intéresse et que l’on cherche, s’il est possible, pas seulement pour des problèmes très généraux, s’il est possible d’y déplacer quelque chose ou pas.
Voilà pour ce soir.
Charles Melman

