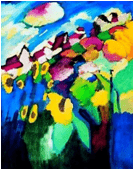
EPhEP, MTh3-CM, 30/11/2017
Nous allons essayer de nous réchauffer avec un sujet parfaitement excitant. On va voir si, effectivement, il vous met de bonne humeur.
Il s’agit donc aujourd’hui de conclure la mise en place des instances déterminantes de la psychose. Et je commencerai par vous rappeler ceci qu’on a déjà dû vous seriner, c’est que nous avons la spécificité dans l’espèce animale de naître sans aucun savoir inné. Vous avez tous eu le bonheur d’observer la naissance d’un bébé poulain. Je vois dans votre regard que oui : vous avez tous assisté à cette naissance. Et en tout cas, vous avez pu vérifier qu’une fois dehors, il se mettait joyeusement sur ses pattes, fragiles, trouvait très vite le pis de sa maman et puis se mettait à gambader. Voilà, il avait tout ce qui faut pour fonctionner. Ce qu’il ne manque pas d’ailleurs de faire.
En ce qui concerne le petit bébé, on a été obligé - les biologistes - de conclure que la naissance du petit humain était prématurée. Prématurée, parce qu’il n’est aucunement prêt d’affronter l’existence et que sa vie se trouve dans un état de dépendance absolue, dépendance de l’entourage, dépendance à laquelle on attribue son aptitude, l’aptitude future de l’adulte à la soumission. On estime que c’est parce que le petit naît dans un tel état de déshérence et de dépendance vitale à l’endroit de l’entourage qu’il sera particulièrement vulnérable, exposé à la soumission. Cette soumission qui faisait dire à Freud que nous restions éternellement des enfants puisqu’il nous fallait toujours aller chercher quelque autorisation pour prendre une décision, pour nous autoriser.
Pour ceux qui n’en auraient pas forcément la connaissance - je n’en sais rien - je vous citerai ce merveilleux travail fait par l’Abbé Itard - c’est au XIXème siècle - sur celui qu’il a appelé l’enfant sauvage. C’est-à-dire cet enfant qui avait été trouvé dans la campagne par des paysans, qui devait avoir (on ne savait pas exactement) peut-être huit, neuf ans. Il marchait à quatre pattes, grimpait dans les arbres et n’émettait que des sons inarticulés. Le bon Abbé Itard le prit en charge – je vous rappelle qu’il est le fondateur de l’Institut des sourds-muets, rue Saint Jacques – et grâce à son travail permit à cet enfant de l’amener jusqu’à l’acquisition d’un langage de signes (mais non pas de signifiants). A la même époque furent découvertes deux petites filles élevées par une meute de loups : celles–ci avaient adopté totalement le comportement des loups (hurlement, nourriture, façon de se déplacer). On tenta de les « humaniser » : mais la tentative d’humanisation et en particulier bien sûr d’éveiller les facultés de leur âme, aboutit à la mort rapide de l’une d’entre elles au bout de dix-huit mois ou deux ans d’hominisation, tandis que la plus grande survécut un peu plus longtemps.
De toute façon, le point qui nous intéresse est de signaler qu’une fois venu au jour, une fois sorti de la maman, si l’on veut que le bébé commence à exister, eh bien la maman sait qu’il faut le stimuler. Ça ne se fait pas tout seul, il ne se met pas comme ça, spontanément, à gazouiller, à plaisanter, à sourire à l’entourage. Pas du tout. Et de telle sorte que s’il n’y a pas dans l’entourage quelqu’un pour l’exciter, pour l’énerver, pour l’embêter, pour être excessif dans les caresses, dans les appellations, dans les frottements, dans les irritations, si on ne l’éveille pas, le bébé va connaître un type de maturation neuromusculaire déficitaire, le conduisant à cet état que l’on n’a plus le droit d’appeler autisme : il paraît qu’on ne peut plus, comme ça, mettre en cause ce qui a été l’empêchement de l’entourage, l’empêchement de la mère d’accueillir son enfant avec ce savoir spontané qu’elle a. Donc on l’appellera, pour ne pas être poursuivi, on l’appellera état de carence maternelle infantile.
D’ailleurs, il y avait des psys autrefois, - c’était dans les années cinquante, dans les années pleines d’espoir qui suivaient ce qu’on appelait la Libération - il y avait trois dames psys qui ont fait un travail sur ce qu’elles ont appelé l’hospitalisme, c’est-à-dire la constatation que des bébés qui devaient en bas âge être maintenus à l’hôpital, séparés de leur maman, ces bébés allaient développer des états absolument analogues à ceux de l’autisme. Autrement dit, ils allaient se désintéresser de l’entourage, avoir un regard qui ne se fixait sur rien ni personne, qui plafonnait, qui ne reconnaissait pas les visages, et s’enfonçait donc dans un état végétatif.
Tout ceci donc pour signaler, pour souligner, parce que cette simplicité de l’évidence n’empêchera aucunement un certain nombre de physiologistes d’aller chercher dans les ressources neuronales, les motifs, les raisons du développement de l’enfant, comme si c’était inscrit dans les neurones ou dans les couches corticales, alors que l’expérience la plus commune montre que ce n’est pas le cas. En tout cas, nous avons, grâce à ce petit préambule qui, j’espère, a retenu votre attention l’introduction à ceci : c’est que pour le bébé, quel est le statut de la mère? Eh bien, elle a déjà pour statut de ne pas être ni le même (il reconnaît très bien un bébé semblable à lui, et dès qu’il en voit un, ça le fait pleurer parce qu’il trouve que ce n’est pas drôle), qu’elle n’est pas, la mère, le même que lui, mais qu’elle n’est pas non plus une étrangère. Pas le même, pas une étrangère. On va donc cesser d’être dans les définitions négatives pour dire qu’effectivement, elle est son Autre.
Et voilà le bébé qui fait l’expérience de cet Autre qu’est la mère pour lui. En effet, il reçoit par les soins et dans le bain de paroles dans lequel elle va le faire voyager, il reçoit d’abord une image de lui-même : il est sûrement un objet merveilleux, compte-tenu de ce qu’elle lui dispense. Il est un petit trésor auquel elle tient beaucoup. Il va en recevoir aussi la notion des devoirs qu’il lui doit, qu’ils soient alimentaires, qu’ils soient de sommeil, et puis autrefois, avant l’invention de la couche-culotte, c’était les devoirs de propreté. De mon temps, se discutait facilement le fait de savoir s’il convenait d’élever les enfants à l’africaine, autrement dit, pour la maman, de ne venir les nourrir que lorsqu’ils en manifestaient le besoin, de ne les laisser dormir que lorsque manifestement ils tombaient de sommeil, etc. Ça a été la mode un certain temps, et puis on en est revenu aux notions classiques, aux notions anciennes. Mais elle lui enseigne aussi, la mère, elle lui enseigne la morale, c’est-à-dire ce qui est bon et ce qui est mauvais et qui dérive très vite pour devenir le bien et le mal. Ce qui va être beaucoup plus délicat à conceptualiser pour nous, c’est qu’elle va lui apprendre une langue positive, et là, elle va avoir le choix entre lui apprendre ce qu’on a appelé le babyish, c’est-à-dire une langue privée qui sera réservée à ce couple-là, et qui envoie à l’enfant le message qu’ils sont destinés l’un à l’autre et seuls destinés à se comprendre et à se parfaire.
Il n’y a pas tellement longtemps, j’ai reçu un enfant de cinq ans, venu avec une maman maghrébine qui, dans la contestation qu’elle faisait de son mari qui avait accompagné les deux à la consultation, avait ainsi inventé pour son enfant une sorte de sabir qui mêlait des termes kabyles, arabes, français, et cela faisait que le gamin à l’école, évidemment, n’avait aucun moyen de se faire comprendre ni de suivre ce qui lui était dit, ce qui donc posait quelques petits problèmes. C’était évidemment passionnant de voir comment un enfant était parfaitement capable d’apprendre ainsi une néo-langue, une néo-langue d’autant plus précieuse qu’elle impliquait un couple exceptionnel et destiné évidemment à durer. Ce qui aboutissait bien sûr, par ailleurs, à quelques difficultés de comportement, comme par exemple le fait que n’étant introduit à aucune notion de limite ou d’interdit, il est bien évident qu’il a rapidement mis mon bureau à sac, retournant tout ce qui lui semblait mobile, et, je dirais, parfaitement insensible aux recommandations un peu inquiètes que sa mère pouvait lui faire.
Car c’est également de cet Autre que l’enfant va recevoir son identité, son identité d’une double façon. D’abord à partir de ce qu’il est pour elle, c’est-à-dire le petit trésor, l’objet exceptionnel qu’il constitue. Puis il sera très vite sensible à cette question de savoir si cette identité l’inscrit ou pas dans la lignée. Autrement dit, s’il est un enfant privé, si sa naissance est une affaire privée entre sa mère et lui, ou bien si c’est une affaire d’emblée publique, c’est-à-dire si l’amour de sa mère pour lui ne va pas d’emblée lui donner à entendre le fait qu’il est un enfant non seulement à elle, mais qu’il est l’enfant d’un pouvoir ancestral dans lequel elle venait l’inscrire, pouvoir dont elle est le serviteur. De telle sorte qu’elle lui adresse ainsi des messages, des messages où le « tu » qui le désigne va être repris par lui comme « je ». Ça mérite au passage d’être souligné, puisque nous avons la tendance, je dirais, à célébrer l’autonomie et la fantaisie du « je », la personnalité. Eh bien, peut-être convient-il de rappeler que le « je » n’est que l’expression inversée, reprise, du « tu », du « tu » dont Lacan dit gentiment, si je puis dire, que c’est toujours un « tu » tuant, tuant puisque c’est ce que je vais reprendre au titre de « je ».
Dans ce que je suis en train de vous raconter, surgit une question qu’il n’est pas facile de trancher mais dont vous reconnaîtrez néanmoins la pertinence. Cette question est la suivante : mais alors, si la mère en tant qu’Autre est la responsable de toutes ces déterminations, est-ce que c’est par elle que se fait la transmission qui sera essentielle pour l’identité de l’enfant, c’est-à-dire, transmission de la lignée dans laquelle il va être inscrit, ou encore les psychanalystes diront la transmission phallique ? Est-ce que c’est du côté de la mère que l’enfant a à aller la chercher ? Il y a comme vous le savez sûrement une religion, fort ancienne puisque c’est la religion juive, où c’est effectivement ainsi que ça se passe, autrement dit l’identification virile du garçon passe par la reconnaissance et le travail maternels. Est-ce que ça a quelque intérêt, cette affaire ?
Ça a un intérêt pour ce qui va nous concerner dans l’étude des psychoses, ça a un intérêt essentiel puisque dans le cas de la transmission maternelle que je suis en train d’évoquer, l’opération est fondée sur une donation. Avec d’ailleurs cette opération bizarre, c’est qu’alors que nous avons tous un vif appétit d’égalité, cette chose extrêmement bizarre a priori qui fait qu’elle ne peut en donner qu’un, un seul. Dans la lignée, il y en aura un qui sera l’élu. Alors ça peut être le fils aîné pour faire plaisir à papa puisque c’est également la tradition biblique, mais dès la tradition biblique, la maman, avec Jacob, a été assez maligne, et tout le monde s’en réjouit, tout le monde trouve ça très sympathique, pour tromper papa et faire que ce soit le fils cadet qui, grâce à elle, soit reconnu comme le destinataire du sceptre.
Or, quand l’opération, la transmission se fait non par la maman, mais se fait du côté du père, le processus n’est aucunement celui d’une donation, et c’est même un processus sauvage, brutal, sévère, et que la théorie analytique a appelé la castration. C’est-à-dire l’opération par laquelle le père va priver l’enfant de sa mère pour son bénéfice personnel, pour son égoïsme grossier et vulgaire. Il va rompre ce couple parfait de la mère et de l’enfant. Et c’est donc par cette opération dont le sens sexuel est avéré, que c’est pour des motifs d’appropriation sexuelle que cette opération se fait, que cet enfant va se trouver privé de sa maman, déchu de son statut privilégié, et avec pour seul gain la promesse que plus tard quand il sera grand, il sera comme papa, bizarrement pas comme maman. Ce qui fait que la petite fille qui va subir la même opération va forcément initialement se confondre avec le statut de petit garçon. Aucune raison pour qu’elle puisse penser autrement.
Autrement dit, cette opération d’identité gagnée là, n’est plus l’effet d’une donation amoureuse mais l’effet d’une privation, toujours attribuée à l’intervention d’un tiers. Alors, j’ai évoqué bien sûr, figuration de l’Œdipe, le papa, mais ça peut être un autre, par exemple, le fils aîné qui va s’avérer à l’enfant le préféré de la mère, ça peut être l’intervention d’un amant, ça peut être la venue au monde d’un autre bébé. Et dans tous ces cas, c’est ça qui est quand même, je dirais, outrageant, rageant et outrageant, eh bien, c’est que le destin du bébé, du fait de la mise en place de cette privation, va s’en trouver radicalement différent. Si c’est le papa, auquel la responsabilité est attribuée, avec la sympathie mêlée de haine, de concurrence et d’agressivité qu’il va ainsi développer - c’est vrai, il faut qu’il se fasse pardonner quand même de ce qu’il fait là - si c’est le papa, on va dire que cette castration est symbolique. Je reviendrai tout de suite pour vous - pour que ce soit bien clair pour vous et que vous n’ayez pas l’impression qu’on se sert d’un mot fétiche - sur le sens de ce mot : castration.
Cette castration, elle est symbolique. Elle est symbolique parce qu’elle n’a rien de réel. Il ne s’est rien passé d’autre que le fait que le couple parental mène sa vie, et qu’il n’y a aucun préjudice physique. Elle est donc purement symbolique du fait de l’identité qui est ainsi promise à l’enfant. Si c’est le fils aîné qui va se révéler le tiers venant séparer le petit chou de sa mère, la conséquence en est complètement différente car, dans ce cas-là, il s’agit pour l’enfant d’un traumatisme, traumatisme parce qu’il n’a aucun espoir d’identification lui permettant un jour d’entrer dans une lignée semblable à celle de son frère aîné.
C’est pourtant fréquent dans les familles méditerranéennes, ce genre de situation, mais ça a des conséquences pour l’enfant déterminantes et en particulier, ça va l’engager dans la conceptualisation d’un dommage illicite dont il a été la victime et qu’il lui faut trouver le moyen de réparer. Autrement dit, il faut qu’il récupère ce dont il été ainsi injustement privé. Dans ce cas-là, c’est une castration réelle, l’enfant n’est promis à aucune destinée sexuelle. Si c’est un amant, ce sont des choses qui peuvent arriver, il est bien évident, que dans ce cas-là, là encore, il n’a rien à attendre pour lui-même de cette frustration, et on dira que dans ce cas, la castration est imaginaire. Et puis enfin, si c’est parce qu’un bébé est venu, dans ce cas-là, ce sont les trois modes de castration qui se trouvent réunis, c’est-à-dire aussi bien symbolique, puisque le rôle du géniteur est déterminant, que réel, puisque le bébé est quand même venu sortir le précédent de ses privilèges, et puis imaginaire également.
Alors, pourquoi ce terme de castration ? Ce terme de castration puisque cela veut dire que l’enfant entre dans un système langagier où le sexe est refoulé, et c’est ce qu’il va apprendre très vite, une fois la période « caca-boudin » passée, où il essaye de résister - il veut qu’il y ait de la cochonnerie, comme ça, qui soit publique, et puis il se sert des arguments, des éléments qu’il peut, qu’il connaît,et puis on fait solidarité avec les petits copains pour dire qu’on est affranchi et qu’on n’a pas peur de dire les gros mots. Mais néanmoins, il se résigne très vite à constater que pour commercer avec les autres, aussi bien les enfants que les adultes, le sexe est à refouler, c’est-à-dire à effacer de sa propre image : on ne se promène pas tout nu. C’est quand même étrange.
Alors, ce qui est fantastique, c’est que toutes ces opérations que je viens de vous rappeler ou de vous raconter, toutes ces opérations sont des mythes. Je raconte souvent comment un illustre philosophe, anthropologue, demandait : les grecs croyaient-ils à leurs mythes ? Mais nous, nous y croyons tout le temps. Ce n’est pas seulement parce que Noël arrive ! Tous les enfants sont des petits Jésus puisque c’est quand même bien vrai que la cause sexuelle est refoulée, et que la maman va s’employer pour son bébé à faire valoir qu’elle est mère avant tout, et peut-être même arrivera-t-elle à lui faire entendre qu’elle n’est que mère. Alors comment l’enfant pourrait-il penser qu’il n’est pas né d’une maman pure, pure, et que seul l’esprit, la colombe ou la cigogne, c’est comme on voudra, est intervenue.
En tout cas, qu’est-ce qu’il y a de parfaitement mythique dans ce que je suis en train de vous raconter ? C’est que le problème de ce qui va faire défaut, ce « radical » qui va faire défaut, ce n’est pas un mauvais tour joué par des esprits biscornus ou par une société mal arrangée, mal faite. Ce fait que quelqu’un qui relève de cette espèce animale ne va jamais trouver l’objet de satisfaction susceptible de le combler, ce fait n’est pas le résultat primordialement d’une histoire, d’un mythe, d’une légende. C’est le fait - je pense qu’à l’Ecole on vous l’a déjà suffisamment ressassé - c’est le fait du langage lui-même puisque ce ne sont jamais que de mots que nous nous satisfaisons. Evidemment, il peut être éventuellement nécessaire qu’ils soient associés à ce qu’il y aurait à saisir : un peu de chair, sûrement. Mais si le mot fait défaut, eh bien comme on le sait, l’objet, la matière, se révélera hors d’usage.
C’est donc une façon, ces mythes, avec leurs conséquences si différentes pourtant - et c’est pourquoi les mythes ne se valent pas, ne sont pas équivalents - ne sont que des modalités, des façons de faire que ce défaut ait un sens qui le mette au service de la jouissance, serait-ce, je dirais, dans le registre de la satisfaction. Mais qu’en tout cas ce défaut soit mis au service de la jouissance. C’est donc un abord, un éclairage qui nous informe sur ce que l’on appelle l’histoire, le roman, le récit. Qu’est-ce qu’un récit ? Quand par exemple on juge un criminel, il est indispensable que soit établi le récit qui l’a conduit à cet acte. On ne peut pas terminer le procès sans qu’on puisse établir la chaîne des causes, des déterminations qui ont fait que ça s’est produit comme ça et pas autrement. Et même, comme on le sait, cette mise en récit est déjà presque une forme d’excuse, une détermination qui a fait que ça s’est joué comme ça.
Nous aimons bien sûr aussi les romans. Alors à quoi sert ce récit et à quoi sert le roman ? Pourquoi aimons-nous le roman ? Le roman, c’est toujours fait pour que ce qui a fait hiatus, ce qui a fait coupure, ce qui a fait séparation, ce qui a fait préjudice, ce qui a fait défaut, que cet espace-là puisse être comblé, suturé. On en a enfin établi l’enchaînement causal. Il suffit de suivre la chaîne, et du même coup on perd ce qu’il y a de profondément irrationnel dans la détermination de cette privation : c’est-à-dire le fait que celle-ci, liée au langage, mette en place cet obstacle que la théorie lacanienne appelle le réel, autrement dit, ce qui fait mur, ce qui fait butée, ce qui fait qu’il y a une limite qui n’est due à aucune malfaisance, à aucun personnage diabolique ou à aucun dieu même bienveillant. Il y a une limite, il y a un empêchement, il y a quelque chose que le langage ne peut pas épuiser qui fait limite à la jouissance et qui s’appelle le réel.
Avec cette opération, cette intervention du tiers, que j’ai évoquée tout à l’heure, l’enfant découvre que le fait que sa mère semblait dans une plénitude parfaite avec lui est un mensonge, qu’en réalité cette plénitude vient s’inscrire dans le manque qu’elle supporte, comme tout un chacun et que l’enfant - elle a l’occasion, l’argument : son enfant chéri - pour ce manque, d’essayer de le combler ; mais que chez elle, c’est-à-dire dans l’Autre, il y ce manque dans l’Autre et que ce manque va être constitutif de l’organisation psychique et factuelle des uns et des autres, qu’il y a donc dans l’Autre, ce type de défaut que la maman essaye de combler y compris bien sûr avec son époux ; c’est dire qu’il y a dans l’Autre, et en tant que ce défaut est au service de la jouissance, une instance sexuelle qui semble - et l’enfant est capable de le piger très vite - qui semble commander tout le monde.
Lui qui n’avait pas de savoir inné, voilà qu’il va faire un apprentissage dont il faut bien reconnaître que les chemins sont parfois tortueux. Tortueux parce que chacun des partenaires auquel il a à faire vient traiter à sa façon ce genre d’impasse. Et l’enfant, ce qu’on appelle l’intelligence de l’enfant, se développe, lorsqu’il pige que des comportements paradoxaux qu’il rencontre chez les uns et les autres, et y compris à l’intérieur d’une même personne, voire chez le même parent, que ces comportements paradoxaux ont quelque chose de commun et qui est leur entame : ils sont tous marqués de la même entame à laquelle ils essayent de répondre, qu’ils essayent de pallier. C’est ça l’intelligence de l’enfant, il comprend que c’est le même truc, c’est le même truc pour les uns, pour les autres, et du même coup, ça va évidemment l’être pour lui-même.
Dans notre culture, cette instance la culture occidentale, mais aussi évidemment proche-orientale (pas africaine) cette instance, du fait de la religion, est appelée « Père ». Quand on est laïc, on l’appelle phallus, mais elle est appelée « Père ». Et voilà donc que ce sera lui, ce père-là, ce « Père qui êtes aux cieux » - et comme ajoutait l’autre : « Et restez-y » - eh bien ce « Père qui êtes aux cieux », voilà le coupable, coupable d’une jouissance à jamais entamée. Voilà, en tout cas le mythe fondateur de nos cultures et de ce que Freud a cru découvrir d’essentiel avec le complexe d’Œdipe, c’est-à-dire que le père, on veut le tuer. Le seul problème, c’est qu’une fois qu’il est mort, c’est là qu’il est éternel.
C’est donc une opération qui, du point de vue strictement économique, n’est pas une excellente affaire. C’est perdant-gagnant : perdant pour le sujet parce que la culpabilité, comme nous le savons, va accompagner son existence, tandis que l’Autre sera gagnant puisque c’est toujours plaisant de voir les gens s’agiter et au fond, passer une bonne partie de leur temps à essayer de trouver des positions favorables, de moins mauvaises, car la dimension de la dette va s’avérer toujours ouverte et insoluble.
Alors, vous me direz : « Attention, attention. ». Parce que justement, il y a des familles où, du père, il n’y en a pas, il n’y en a jamais eu, ou il s’appelle peut-être comme ça, mais il n’a jamais rempli la fonction, il n’a jamais tenu sa place, etc. Alors, il est simplement quelqu’un de plus à table, un peu bruyant parfois, et puis voilà. Donc, comment ça vient néanmoins à tous les enfants ? Parce qu’ils vont se dépêcher de juger leurs parents à partir de l’idéal mis en place justement par la référence paternelle et pour trouver justement qu’ils ne sont pas du tout à la hauteur, ce qui est le sort évidemment commun, parce qu’être à la hauteur d’un mort, ce n’est pas toujours facile. Une fois qu’on est vivant, on est marqué par l’entame, c’est à ça qu’on reconnaît un vivant. Alors, comment va-t-il y avoir accès ?
Je voyais l’autre jour un malade à l’hôpital qui souffrait d’un délire hallucinatoire : jeune homme de trente-cinq ans qui a passé tout l’entretien, au prix d’efforts considérables, à, sans cesse, être avec moi dans la normalité, dans la normalité, c’est-à-dire me répondre à la fois comme un interlocuteur autre, valable, raisonnable, sensé, parfois ayant un certain humour. Et il n’y avait pas besoin d’être très fort pour percevoir tous les efforts que lui faisait pour justement ne pas donner champ, ne pas donner expression à ce qui était en train de travailler son esprit. Il répondait donc lentement, de façon contrôlée et avec ce souci tellement sympathique de ne pas me déranger, de faire bonne figure. Et la question donc qui se posait était : d’où ça lui venait, lui qui était fou, ce savoir de ce qui était justement la bonne mesure dans l’expression, dans le choix des mots, dans la syntaxe, dans la coordination des réponses ? D’où ça lui venait, puisqu’il était fou ? Comment ça pouvait coexister ? Eh bien, ça lui venait du fait que les discours, en tant que tels, les discours - ce que Lacan a individualisé, et auxuels je vous renvoie pour ne pas alourdir cette soirée - les discours, c’est-à-dire la façon de s’adresser à autrui, les places que les discours permettent, les fonctions que les discours engendrent, les discours, implicitement, portent avec eux la référence au Nom-du-Père. Et donc, c’est dans l’articulation possible du discours qui était stimulé, engendré par mon propre questionnement, qu’il trouvait la façon de pouvoir ainsi être civil et courtois. Et sympathique.
Ce que l’on appelle la rationalité, c’est-à-dire, justement, ce qui se présente comme n’ayant aucun rapport avec la référence à un quelconque dieu, un quelconque père, à une quelconque instance phallique, puisque la rationalité, c’est l’établissement d’une chaîne dont chaque élément ne doit sa cause qu’à l’élément précédent dans la chaîne, aucune intervention tierce, aucune intervention à ce qui serait en dehors de la chaîne elle-même. La rationalité, dans la mesure où elle met systématiquement en place un impossible, ce qui ne se peut pas, la rationalité a elle-même le plus grand rapport avec l’instance paternelle, de telle sorte que - et puisque nous sommes ici dans la maison des Jésuites - ceux d’entre vous qui vous intéressez à la religion, verrez qu’il n’y a rien de plus rationnel que les théologiens. Si vous voulez lire des philosophes qui soient rationnels, lisez Saint Thomas. Et les théologiens aux XI-XII èmes siècles ont découvert Aristote, c’est-à-dire la rationalité à sa naissance, et ont été éblouis par le fait que grâce à Aristote, les trois religions issues du monothéisme pouvaient interpréter les textes sacrés en les déchiffrant de la même manière. Autrement dit, le fédérateur commun, c’était Aristote.
Pourquoi est-ce que je fais ce détour par la rationalité que l’on veut spontanément opposer à cette religion révélée ? Parce que dans les deux cas, rationalité ou bien référence faite à ce qui dans le réel serait l’instance Une, organisatrice, dans les deux cas, il s’agit toujours de vérifier que c’est le réel comme impossible et tel qu’il est commandé par le langage, qui commande. C’est à partir du réel de la mère, de ce qui a été pour elle un impossible, celui de combler son propre désir, que l’enfant est susceptible de comprendre que c’est de là que ça commande. Ce n’est pas que parce qu’il y a là un commandant ou un agent de police ou un justicier, mais que c’est de là que ça commande. Et ce qui fait que c’est de là que pour chacun de nous, ça nous parle, de façon évidemment différente selon nos histoires personnelles, mais c’est de là, de ce lieu-là, que pour chacun de nous ça commande.
Pour - je ne sais pas - illustrer peut-être ce que je vous raconte par une anecdote ayant trait à notre contemporanéité : le fait qu’est venu se substituer au discours un nouveau langage qui est le langage numérique. Quand deux internautes sont en contact, ça passe entre eux par un nouveau langage qui n’a plus du tout la même référence, la référence tierce dont je parlais tout à l’heure, et ils n’ont aucune raison de supposer qu’un impossible quelconque vienne brider leur échange. Lorsque la communication témoigne de la prévalence de ce nouveau système de communication qui épargne donc les peines que j’évoquais tout à l’heure, c’est une autre figure de l’autorité, une autre figure de l’Autre qui apparaît et qui n’a plus les traits d’être le gardien d’un impossible.
Ce qui fait - et je ne sais pas si ce que je vais vous dire va vous amuser beaucoup mais c’est néanmoins dans l’intention de vous amuser que je vous le dis, alors si mon histoire n’est pas drôle, ce sera à mes frais - ce qui fait que brusquement, sans qu’on comprenne d’où ça vient, d’où ça sort, ni comment, voilà que brusquement, brusquement, les discours politiques traditionnels s’effondrent et que surgissent pour représenter l’autorité, de toutes nouvelles figures, je dois dire assez surprenantes, quels que soient les grands pays vers lesquels vous vous tourniez, dont la caractéristique de l’une d’elles sera que justement elle ne reconnaît aucun interdit, qu’elle est capable de tout dire, de tout mettre sur la table, qu’elle ne connaît pas de limite, avec du même coup le fait que la dimension de la vérité n’a strictement plus d’intérêt, puisque n’est vrai que ce que « je dis », et si c’est contradictoire, qui a dit que la contradiction n’était pas respectable ? Et alors ! Chacun de nous est contradictoire !
D’autres figures se présenteront comme s’il n’y avait plus dans la cité d’antagonismes, c’est-à-dire de distinction des places, mais comme s’il y avait une égalité de tous devant la similitude des problèmes, comme si les problèmes se posaient de la même façon pour tous. Et donc, la surprise de constater que le changement du moyen de communication, substitution au langage, du numérique, c’est-à-dire d’un système binaire, eh bien voilà, ça change complètement la donne, y compris le fait - alors pour vous amuser complètement, je vais m’arrêter là-dessus - y compris le fait que le sexuel, dans le cas de ce nouveau langage où l’on peut tout dire, où il n’y a plus d’impossible, où il n’y a plus de limite à aucune jouissance, etc. Que le sexuel traditionnel n’a plus sa place : cela devient un abus, il n’est plus présentifié que sous la forme de l’abus. Essayez de voir ce que le sexuel peut avoir à faire avec un système binaire qui est susceptible de franchir, grâce aux moyens fabuleux des ordinateurs, tout ce qui hier paraissait insoluble.
Donc, substitution à la loi, du contrat, c’est-à-dire d’arrangements entre soi, y compris d’ailleurs pour la vie des couples, bien sûr. Puis également le fait que le sexuel, vous allez le voir de plus en plus, va être enregistré comme ce qui était l’abus de papa, et que dorénavant personne n’est forcément tenu par une modalité de jouissance dont on sait qu’elle est compliquée et justement marquée par une entame, tandis que que nos moyens technologiques nous offrent tellement de substitutions plus parfaites, et donc plus encourageantes. On va faire le pari, puisqu’on commence à en voir dans la presse les premiers signes, on va faire le pari que d’ici que votre scolarité soit terminée - parce que ça va aller vite - ça va se transformer. Et comment ?
Ce qui fait donc que sur le radeau sur lequel vous êtes embarqués, vous aurez le loisir de réfléchir et puis de tenter un peu l’analyse de ce qui se produit et qui fait que les psychoses elles-mêmes - mais ce n’est pas le point que je développerai cette année avec vous - les psychoses elles-mêmes changent, et que ceux d’entre vous qui sont amenés à fréquenter des milieux psychiatriques, interrogerez le personnel qui convient pour ça, c’est-à-dire, les infirmiers, les infirmières, qui passent la journée avec les malades et qui vous diront tous que les malades ne sont plus les mêmes. Peut-être qu’avec le numérique, il n’y aura plus de psychoses ou peut-être que tout le monde sera franchement cinglé. Nous allons avoir la chance d’être les observateurs sympathiques et bienveillants de ce qui est en train de s’agiter.
Parce que là, actuellement, vous assistez à la dénonciation du traitement social de la sexualité, des abus du traitement social de la sexualité, mais vous verrez ce qui va surgir quand on va dénoncer les abus du traitement familial de la sexualité. Et à ce moment-là, vous vous direz, il y a eu quelqu’un, là, derrière sa table, un jour de neige, qui nous a raconté des petites histoires. En tout cas, pour le but qui est le nôtre, et toute autre considération mise à part, je trouve que ce n’est pas mal d’être un peu sensible à ce qui se produit et donc, la prochaine fois, grâce à cette mise en place que j’ai faite - j’espère qu’elle ne vous a pas paru trop fastidieuse - grâce à cette mise en place, vous allez voir se disposer les diverses psychoses classiques qui sont répertoriées dans les livres, et telles qu’on les observait jusqu’à présent.
Est-ce que l’un de vous a une question ? S’il vous plaît …
- Bonjour, Monsieur Melman. Vous avez parlé du tiers à propos de la castration. Donc, d’après ce que vous auriez dit, il y aurait trois personnes individualisées, le père, la mère, l’enfant : le triangle, à trois côtés, trois angles. Est-ce qu’on ne peut pas imaginer que cette castration soit simplement une dyade, où le troisième, entre guillemets, soit simplement le désir de la mère.
Le désir ?
- Le désir de la mère et non pas trois personnes : deux, avec chez la mère ce désir du père. Et ça se fait à deux et non pas à trois. Trois, bien sûr parce qu’il y a un désir, mais en même temps, ce n’est pas une troisième personne, il n’y a pas le tiers existant.
Mais le désir lui-même, si je puis dire, pour qu’il se substitue au besoin qui, lui, implique une relation duelle entre le consommateur et son objet, le désir lui-même implique la ternarité du défaut, le défaut comme ternaire engendrant donc la quête de ce qui s’avérera, du fait du langage, du fait qu’il ne s’agit jamais que d’une quête langagière, inatteignable. Donc, dès lors que vous faites intervenir le désir, qui n’est pas obligatoire, puisqu’il y a des organisations duelles, comme on le sait familiales, mère-enfant par exemple, et où le désir est à jamais écarté, maintient dans un état d’enfance prolongé. Ça existe. Eh bien, dès lors que vous vous référez au désir, vous vous référez forcément à l’élément qui fait défaut entre les deux et qui donc s’impose comme ternarité.
- Donc une triangulation avec le désir, et pas forcément avec le tiers existant.
Oui, ce n’est pas le tiers qui est …
- C’est le désir.
… qui est celui qu’il faut mener en accusation.
- Merci.

