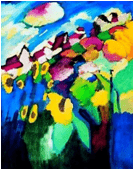
EPhEP, MTh3-CM, le 09/11/2017
Alors, comme vous le savez, vous avez beaucoup de chance puisque nous allons ensemble entrer dans la mise en place de la psychiatrie, qui s’avère non seulement souhaitée par tous ceux qui fréquentent les hôpitaux psychiatriques et qui connaissent son état actuel, mais également par tous ceux qui, formés à l’enseignement de Lacan, prennent la mesure de ce qu’il y a à faire pour que cette psychiatrie existe. Et comme vous le verrez, elle a des conséquences, ne serait-ce d’ailleurs que la première qui est le plaisir que l’on peut prendre à la mettre en place.
Comme vous le savez également très bien, les linguistes distinguent, dans le maniement de la langue, ce qu’il en est de la compétence et de la performance. La distinction est aisée : la compétence, c’est faire tourner le moulin à paroles, ce dont en général nous ne sommes pas tout à fait incapables, et la performance consiste à introduire dans le stock des savoirs constitués des éléments nouveaux, acceptables, et aux conséquences éventuellement utiles.
Donc, comme vous allez le voir, nous allons être nous-mêmes sans cesse entre compétence, c’est-à-dire maniement du moulin à paroles, et puis performance, c’est-à-dire l’introduction de propositions que jusqu’à maintenant vous ignoriez et que vous allez avoir le bonheur de découvrir.
Dans tout enseignement, quel qu’il soit, il y a toujours deux parts : une part dogmatique et une part de démonstration. On ne peut pas faire autrement. C’est une disposition qui est connue depuis les premiers logiciens, il y a deux mille cinq cents ans : vous êtes obligés pour engager la moindre démonstration, de poser des axiomes que vous ne discutez pas et à partir desquels se déroulent quasiment automatiquement un certain nombre de démonstrations. Mais vous ne pouvez pas accéder aux démonstrations, si vous ne commencez pas au départ par poser les axiomes, les dogmes qui vous permettent de les dérouler.
Il en est ainsi dans notre vie : dans notre vie, nous arrivons tous avec un certain nombre de dogmes établis et à partir desquels notre vie s’organise. Evidemment, il pourra se produire que ces dogmes, on veuille les discuter, c’est-à-dire vouloir leur appliquer les lois ordinaires de la démonstration. Par exemple, discuter le fait de savoir si le sexe est un fait de culture, ou bien s’il nous faut reconnaître que c’est simplement l’application d’un fait de nature, avec lequel donc on peut librement disposer. Il y avait jusque-là un dogme, c’est-à-dire que nous naissons tous dans un univers sexué, sexué de la manière que l’on sait, avec la coïncidence du sexe anatomique, du sexe culturel, et du sexe subjectif. Et puis, une évolution : ce qui paraissait jusque-là un dogme va être discuté. Est-ce que vraiment ce n’est pas un principe imposé par la culture ? Et, quant à la nature, eh bien, on peut la régler au gré du souhait que chacun peut avoir quant à sa détermination sexuée, par exemple. Je vous ai donné cet exemple pour vous rendre sensible cette différence entre dogme et démonstration. Les dogmes vont être discutés ; quant aux effets de leur discussion, c’est ce qui va pouvoir vous intéresser, vous passionner : quels sont les résultats, qu’est-ce que cela va produire que de vouloir engager dans la discussion, dans les tentatives de démonstrations, ce qui jusque-là échappait, était accepté comme un fait établi.
En tout cas, retenons que dans tout enseignement, il y aura, quelle que soit la position que l’on voudra prendre sur la question du genre, il y aura nécessairement une part dogmatique, autorisant un certain nombre de démonstrations.
La première question qui se pose pour nous est la suivante : quels sont les éléments cliniques pertinents d’une observation psychiatrique ?
Lorsque j’étais un peu plus jeune, c’est-à-dire étudiant, externe dans le service de Saint-Anne chargé de l’enseignement des maladies mentales, je traînais mes guêtres dans ce service : étudiant en médecine, dans un milieu psychiatrique. J’ai été amené à rencontrer un brave et très vieux professeur qui traînait lui aussi ses guêtres dans un couloir et qui, avec beaucoup d’humanité, m’a demandé si je savais prendre une observation en psychiatrie. Moi, étudiant en médecine, je savais examiner à peu près correctement un corps. Mais en psychiatrie, devant un malade mental : qu’allez-vous retenir comme signe clinique, comme élément pertinent et significatif ? « Non. », lui ai-je répondu, avec une innocence troublée. « Non, je ne sais pas. ». « Venez avec moi. ». Et nous nous sommes assis à la tête du lit d’une malade, et il m’a dit : « Prenez un papier, votre stylo et vous allez écrire très exactement et fidèlement tout ce qui va se passer. ». Il a donc commencé à interroger la malade et, avec beaucoup de diligence, j’étais là à gratter tout ce qui était dit, tout ce que disait la malade.
Au bout d’une heure, ça été terminé. Il a regardé mon papier et il a dit : « Vous voyez, l’observation psychiatrique, c’est ça. ». C’est ça, c’est-à-dire une affaire de paroles et c’est donc dans le recueil scrupuleux des propos de la patiente qu’allaient se trouver les éléments permettant le diagnostic et le traitement. Il est évident que ma formation, médicale, ne me donnait pas un accès particulier à l’examen et au traitement de la parole, pas plus que vous d’ailleurs, sans doute. Mais néanmoins, cette première initiation m’invitait évidemment à m’intéresser à ce qui, à ce moment-là, était établi par la science du langage. Vous vous rendez compte : un médecin, un organicien, un biologiste qui amené à s’intéresser à la science du langage, dont il faut dire que c’était bien peu de temps auparavant que la linguistique était devenue scientifique.
Les études sur le langage, c’est comme la logique et les axiomes dont je parlais tout à l’heure, ont commencé de très bonne heure. Et vous aurez le plaisir de trouver dans un texte de Platon qui s’appelle Le Cratyle, une remarquable étude sur la parole et sur le langage. En tout cas, jusqu’à très peu encore, les études sur le langage se bornaient évidemment au recensement du rapport du mot avec l’objet. C’est comme pour les livres d’enfants : on leur écrit : « Ane ». Et puis on leur dessine un baudet gris à côté : « âne-baudet », « âne-gris », « âne-ça braie ». Voilà. Le mot et l’objet. C’est évident. Ce n’est pas évident ? Si. Ça ressort de l’évidence. Ce qui montre que nous sommes tous encore, à cet égard, plongés dans nos premiers livres de lecture.
Or, il y avait eu peu de temps auparavant, comme vous en avez sûrement déjà entendu parler, ce suisse, de Genève, qui était un curieux personnage, qui s’appelait Saussure, et qui a fondé la linguistique scientifique - scientifique - en montrant que le rapport d’un mot ne se faisait pas à l’objet, mais qu’il ne prenait sens que dans son rapport à un autre mot, par la différence qu’il avait avec lui. Et que le langage n’était fait que d’éléments différentiels qui ne faisaient que renvoyer les uns aux autres. J’ai dit que c’était un drôle de personnage, d’abord parce qu’il avait les plus grandes difficultés, lui le linguiste, à écrire. De telle sorte que sa thèse mise à part, et de rares articles, nous n’avons de ses cours que ce que les élèves ont bien pu en noter. Ils ont noté évidemment en faisant beaucoup d’erreurs, c’est-à-dire que les performances de leur maître rentraient beaucoup plus facilement pour eux dans le langage commun, comme celui de la compétence. C’est obligé, hein ? Ils normalisaient les propos excentriques de leur maître, ça c’est sûr. Et donc, c’était quelqu’un qui, de sa propre plume, a laissé très peu d’écrits.
Par ailleurs, c’était un ivrogne notoire. Je ne me permettrais pas d’établir le moindre rapport entre ce que signifiait ce qu’il découvrait, c’est-à-dire que le mot n’avait pas de rapport avec l’objet et que du fait de la langue, l’objet était perdu. Il était perdu puisqu’un mot ne prend sens que de son rapport à un autre signifiant, à un autre mot, qu’il a donc appelé signifiant et en spécifiant que c’est de ce rapport, de signifiant à signifiant que venait le signifié, pas l’objet : le signifié.
Vous vous doutez combien une telle assertion a pu émouvoir, d’autant qu’il a fait des schémas pour en rendre compte. Ceux, en tout cas, que les élèves ont reproduits. Allez savoir si ce sont les bons. Vous voyez le mot « arbre », un trait, et puis dessous, le dessin d’un arbre. Là, on est un peu déçu évidemment parce qu’on disait que le signifié, ça devait être sûrement plus riche que ce végétal que l’on voyait se pointer au-dessous de la barre. D’autant que l’usage du mot « arbre » est quand même d’une telle richesse métaphorique qu’il y a bien d’autres signifiés au mot « arbre » que ce végétal. Mais ce qui était essentiel, et ce qui l’est encore, c’était la barre établie entre le signifiant et le signifié, spécifiant qu’ils n’étaient pas, signifiant et signifié, dans le même espace. Qu’entre eux, il y avait une barre.
De cette affaire, Saussure donnait en outre un exemple qui est celui de l’express. Qu’est-ce qui se passe quand je parle de l’express ? De l’express Genève-Paris de 8h40. On ne va pas se demander ce qu’il allait faire à Paris en prenant l’express de 8h40. Mais quand je parle de l’express Genève-Paris de 8h40, fait remarquer Saussure, c’est évidemment toujours le même, le même signifié, et cependant à chaque fois le train est différent. Ce n’est pas le même wagon, ce n’est pas la même disposition, il est fait d’éléments différents. Et cependant, c’est toujours l’express Genève-Paris de 8h40.
Mais ceci, vous le voyez, amène le biologiste, l’organicien, le positiviste, - s’il y a un mal quelque part, c’est que la cause est dessous ou à côté - cela amène le positiviste, l’organicien (c’est-à-dire celui qui, sous un mot, sous un signe clinique, met en place, désigne une lésion spécifique, autrement dit, se sert non pas de signifiants mais de signes), cela amène l’organicien à devoir s’intéresser à la linguistique mais aussi, bien sûr, à la grammaire, au lexique, à la syntaxe. Alors, il faut souhaiter que celui-là ait quand même eu quelque appétence dans sa première jeunesse pour les lettres et pour pouvoir ainsi investir, justement, les nuances, les beautés et les distorsions du langage.
Evidemment, chez cette patiente, on pouvait déjà retenir le fait que dans l’expression même il pouvait y avoir des manifestations cliniques indépendantes de la structure du langage comme par exemple le mutisme ou la logorrhée, éléments banaux. Mais si je prenais son observation, ce à quoi j’allais être sensible nécessairement, c’était éventuellement les torsions de la syntaxe, l’introduction de néologismes, l’apparition donc d’éléments poétiques dans son dit, et ces éléments, ces traits personnels, ces productions personnelles dans la langue dont elle se servait allaient être significatifs pour entendre son état, poser un diagnostic et éventuellement être capable d’y répondre.
Lacan allait très loin dans cette affaire puisque pour lui la présence dans le dire de la patiente d’un néologisme, d’un seul, suffisait pour poser le diagnostic de psychose, ce qui était d’autant plus intéressant que, pour vous soulager un peu, du même coup, il lui arrivait aussi de se tromper. Et je me souviens par exemple, ça m’avait - j’ose me servir de ce terme - ça m’avait turlupiné à l’époque, parce qu’il avait examiné une patiente qui avait raconté comment elle avait passé une après-midi à « galopiner ». « Galopiner » : beau néologisme et diagnostic imparable. Et comme ça me turlupinait, ce « galopiner », j’ai eu la faiblesse d’aller chercher dans le Littré, bien sûr, et j’ai trouvé que galopiner était un mot de la langue française, introduit - ce n’est pas par hasard - par un nommé Emile Zola, et je crois bien que c’était dans Germinal. C’était donc une création poétique d’Emile Zola. Je vous rapporte cela pour vous donner à entendre que les signifiants, dans le domaine qui nous intéresse, dans la discipline qui nous intéresse, sont les éléments qui nous permettent, ainsi qu’au patient, de nous entendre ensemble.
Si Lacan s’est trompé pour « galopiner », il a en revanche donné une très belle histoire, un très bel exemple, qui va sûrement vous réjouir, on parlait de l’express Genève-Paris, demandons-nous ce qui se passe quand le train s’arrête en gare, à l’arrêt, à la station, et que le voyageur derrière sa vitre embuée, voit sur le quai de la gare un édicule sur lequel est marqué : homme-dame. C’est intéressant, parce que la question de ce que c’est qu’un homme et de ce que c’est qu’une dame, est une question qui tourmente depuis longtemps ; or voilà que derrière cette façade en bois, cette porte en bois, on va savoir, « homme-dame », ce que ça signifie. Ce qui sera étrange évidemment mais ne traumatise plus tellement, c’est que si on va chercher derrière, on va trouver un dispositif identique pour l’un et pour l’une. Néanmoins, il semble que cette collusion « homme-dame » abrite une instance que cependant on ne voit pas, mais qui fait qu’il y a « homme » et « dame » et qu’ils sont séparés, même si après tout le dispositif de l’un et de l’autre concerne des organes ayant la même fonction. Ils sont séparés et c’est là, je dirais, le plaisir que vous pouvez prendre à lire Lacan, c’est que donc la collusion de ces deux signifiants, - un signifiant renvoie à un autre signifiant : « homme » renvoie à « dame » - de cette collusion quel signifié va s’en produire ? Le signifié qui va s’en produire, c’est cette instance qui n’est pas dans le champ des représentations, qui est donc dans un espace autre, cette instance qui fait qu’ils sont réunis en étant séparés.
Il y a une époque, - j’ai décidé de vous raconter des anecdotes pour être amusant, puisque comme vous savez aux Etats-Unis où les élèves notent le prof, chez nous aussi ça se fait d’ailleurs : il importe donc que le prof soit populaire, un peu démago, quoi - il y a eu une époque où il s’agissait dans l’école que Lacan avait fondée qui s’appelait l’Ecole freudienne de Paris, il s’agissait de faire un dictionnaire de la psychanalyse. Je ne m’étale pas sur les détails, en particulier sur le fait qu’il s’agissait de répondre au vocabulaire de la psychanalyse qu’avaient écrit mon ami Laplanche et mon ami Pontalis. Ecrire un dictionnaire de la psychanalyse consiste donc à prendre des concepts, et puis à raconter au-dessous, par exemple prenons « libido », allez, soyons hardis, et puis vous mettez dessous, je ne sais pas, moi : « dénomination commune des forces psychiques qui animent et entretiennent le désir ; selon Freud, la libido présente la force qui anime l’ensemble des pensées ». Vous allez dire quelque chose comme ça. Vous voyez, je vais rapidement. Ça, vous le trouvez dans le vocabulaire de Laplanche et Pontalis. Mais vous voyez que du même coup, vous démentez ce que j’ai raconté tout à l’heure à propos du signifiant. Si vous faites votre dictionnaire comme ça, vous démentez, dans sa rédaction même, ce qui est l’élément princeps majeur, constitutif du langage : vous fourrez sous le signifiant à peu près le corps de ce qui est susceptible, au mieux, de répondre à son appel.
Et, pour tout vous dire, il s’est trouvé que, faute de compétences plus grandes que la mienne, je me suis trouvé responsable de ce dictionnaire. Et si grande est la force de l’habitude, de la pression que nous subissons tous de la part de l’environnement, que je ne pouvais penser que, comme ça, derrière le concept de Lacan que vous voudrez, celui de grand Autre, par exemple, et donc j’allais substantifier, donner corps, à ce qui justement n’en a pas.
Voyez de quelle manière les meilleurs d’entre nous pensent et je dois dire que, parti de la sorte, je ne pouvais aboutir. Qu’est-ce qu’il aurait fallu faire ? Je ne m’en suis aperçu qu’un peu plus tard. Ce qu’il aurait fallu faire, eh bien, c’était faire pour les concepts de Lacan exactement comme le fait Littré pour les mots, c’est-à-dire, relater quelles sont les occurrences où ce mot est présent, car nous ne savons le signifié d’un signifiant que par ses occurrences, le contexte dans lequel il est pris, et c’est un signifié qui n’a pas forcément de corps.
Je vous raconte quelque chose qu’une école philosophique, il y a deux mille cinq cents ans, avait déjà isolée - vous voyez, nous, comme nous sommes des gens de progrès, ça nous paraît étrange - une école philosophique, les Stoïciens qui avaient parfaitement isolé dans le langage (ils étaient entièrement pour la logique du langage, ces gens-là), un élément qu’ils appelaient le Lekton, qui est à peu près l’équivalent du signifié, et qui est donc l’élément qui, sans aucune objectivation, donne son sens au mot. Sans objectivation, le Lekton. Ça a donné du mal évidemment aux suivants pour comprendre ce que c’était que ce Lekton.
La question suivante, qui ne manque pas de vous tracasser, c’est de savoir, quand vous parlez, d’où vous vient votre parole. D’où vous vient votre parole, parce que vous avez la surprise, évidemment, comme tout un chacun, de constater que vous n’avez pas, a priori, nécessairement décidé de ce que vous alliez dire, et votre propre parole peut vous surprendre, vous étonner, vous blesser, vous engager malgré vous (ce n’est pas ce que vous vouliez dire), et puis vous pouvez également avoir la surprise de constater qu’elle est émise, votre parole, depuis un lieu auquel vous ne saviez pas que vous étiez invité. Ce que je dis, c’est vraiment une clinique banale de ce qui est notre rapport ordinaire à la parole. Et, à ce moment-là, vous dîtes : « Mais, eh ho, attention, qui parle ? Et est-ce que j’entérine ce que je suis en train de dire ? ».
On peut prendre des exemples. Vous êtes assez grands pour qu’on puisse prendre ces exemples banaux mais essentiels. Dans la cour que vous allez faire à une femme, vous pouvez avoir la surprise de la place que vous prenez en la sollicitant : ce n’est peut-être pas du tout celle à laquelle vous pensiez. Et elle-même peut être fort surprise par le type de réponse avec lequel elle accueillera votre propos, et qui n’était pas forcément ce qu’elle voulait. Ce que je suis en train de dire, c’est vraiment la banalité de la conversation. Je l’ai déjà raconté, mais ça m’amuse à chaque fois : il m’est arrivé de discuter avec le spécialiste en France de la communication, celui qui dirige d’ailleurs la revue qui porte ce nom : Communication. J’ai été amené à lui dire : « parler, c’est de ne pas savoir ce que l’on dit à quelqu’un qui ne sait pas ce qu’il entend . C’est ça, la communication ». Il était d’accord, parce que ça ne lui coûtait absolument rien de dire qu’il était d’accord, et ça ne changeait évidement absolument rien à sa façon de penser. La communication, on ne sait pas ce que l’on dit à quelqu’un qui ne sait pas ce qu’il entend.
Ça pose évidemment à chacun la question de savoir d’où lui vient sa parole, en quel lieu elle est décidée, d’autant que cette parole qui lui vient ainsi, elle peut avoir pour lui-même des conséquences lourdes. Je donne souvent cet exemple littéraire, mais parfaitement utilisable : vous lisez dans Si le grain ne meurt, de quelle façon le jeune Gide s’aperçoit que les propos qu’il peut tenir à ses camarades sont eux d’un homosexuel. Il ne le savait pas. Il n’y était absolument pas décidé, et puis voilà qu’il parle avec ses copains, et ce qui lui vient - et ça il l’entend et les copains aussi - ce sont des propos d’homosexuel. Alors, comme c’est un jeune homme décidé et courageux, il va lutter : non, il ne veut pas, il ne veut pas la parole qui lui vient et qui, donc, dit quel est son désir. Dans quel lieu elle s’est formée, cette parole ? Il va lutter jusqu’au moment où il va se rendre compte que c’est une lutte impuissante, qu’il ne peut pas détourner son propos, qu’il ne peut pas l’interdire, qu’ii ne peut pas le barrer. De telle sorte que sa maman, bienveillante comme on s’en doute, va le conduire chez la première psychanalyste de l’époque, celle que Freud avait envoyée en France parce qu’il n’avait pas beaucoup confiance dans les psychanalystes indigènes : elle s’appelait Mme Sokolnika. Et le jeune Gide raconte sa visite chez Mme Sokolnika, qui a dû sans doute lui dire que c’était comme ça ! C’était comme ça.
La question est que cette expérience banale et commune que chacun peut vérifier pour lui-même, cette expérience illustre que ce que Freud a appelé d’un mauvais mot, l’inconscient, est le nom qu’il convient de reconnaître à cet endroit où se forgent nos propos. Et l’inconscient déborde évidemment les lapsus, les actes manqués, les rêves, les manifestations dont Freud s’est servi pour illustrer sa présence, pour venir régir notre subjectivité, y compris, bien sûr, éventuellement, le conflit, le combat que l’on va pouvoir engager contre lui si tel ou tel élément qui en vient est susceptible de nous déplaire. Si je m’aperçois par exemple que j’ai de la haine pour mon meilleur ami, je ne vais pas forcément l’accepter. Si je m’aperçois que j’ai des vœux de mort pour un être cher, ça ne veut pas dire : « allez, du même coup, on y va. ». Pas du tout. Mais en tout cas, voilà cette illustration que notre vie psychique est régie depuis un lieu où s’articule - on en revient à la parole - où s’articule notre pensée, la pensée, et que ce lieu, je n’en ai pas la maîtrise, je ne peux pas le commander. C’est quand même une drôle d’affaire.
Avec en plus une remarque que fera Lacan et qui mérite de nous intriguer : c’est que lorsque je commence une phrase, la conclusion est nécessairement déjà là au moment où je la commence, parce que sinon, ma phrase irait n’importe où. Donc, au moment où je la commence, il faut que la conclusion, le terme, et donc son sens, soient déjà là. Ma phrase commence en réalité par sa conclusion, puisque c’est la conclusion qui va décider de son sens, comme dans la langue allemande où c’est le verbe mis à la fin qui va décider du sens de la phrase.
Donc la présence pour chacun d’entre nous d’un autre lieu que celui où le moi s’expose. Voilà : ma parole se tient depuis un autre lieu que celui où mon moi s’expose, (et ma parole peut venir gravement contrarier et démentir l’apparence que donne ce moi) « originant » donc ce concept essentiel qui est celui d’Autre. Il y a chez moi un autre. Ça a été dit par le poète : « Je est un autre. ». Mais c’est bien différent, à partir de cette situation, d’être amené à diriger son existence, que de simplement, seulement constater que je est un Autre.
Ce n’est pas donc un lieu qui m’est semblable puisqu’il est autre. Je n’ai pas dans cet Autre un petit frère, un petit jumeau. Non. Pas du tout. Mais ce n’est pas non plus - et ça, c’est capital pour nous introduire à la question de la psychose, comme vous le verrez la prochaine fois - ce n’est pas non plus un étranger. Ce qui fait que c’est une catégorie tout à fait singulière puisque ce n’est pas le même, ce n’est pas l’étranger, c’est l’Autre avec lequel donc j’ai des liens tout à fait remarquables.
Pour ce soir, ce qui va nous permettre d’ébaucher la question des psychoses qui va nous prendre cette année, le point que nous allons préciser, c’est que le terme d’aliénation qui est communément utilisé pour désigner la maladie mentale est particulièrement impropre pour cet usage. Il est impropre pour cet usage parce qu’aliénation, étymologiquement, désigne l’autre, alius, comme si donc la maladie mentale était l’altération d’un soi autonome, qui se trouvant aliéné, se trouvait altéré, rendu autre par la maladie mentale. Aliénation dans son sens juridique veut dire comme vous le savez asservissement, soumission, donation : l’aliénation d’un bien, c’est lorsqu’on en est séparé, qu’on l’a vendu, qu’on l’a donné, ce que vous voulez, comme si le soi, le moi, à partir de ce moment, se trouvait donc dépossédé de son autonomie : aliéné. Le terme d’aliénation est particulièrement impropre puisque, comme j’ai essayé très rapidement de vous le rappeler par cette introduction aujourd’hui, on est tous aliénés, c’est-à-dire dépendant d’un Autre. C’est notre statut ordinaire, avec ce caractère scandaleux qui est que c’est depuis ce lieu Autre que je suis régi malgré ce que peuvent être le souci de ma rigueur, ma force de caractère, ma volonté de maîtriser ce qui vient à ma pensée.
Dès lors, - et ce soir, je m’arrêterai là-dessus -, surgit une dernière question qui est aujourd’hui à l’ordre du jour du fonctionnement social, et qui est celle de l’identité. S’il est vrai que je suis ainsi constitué par une aliénation, animé par un Autre que je ne maîtrise pas, quelle est mon identité ? Mon identité, telle qu’elle fonctionne, est évidemment celle de mon idéal, de la représentation que j’ai de moi, de celle que je veux avoir et que je veux faire reconnaître, et qui est susceptible de faire que je m’oppose à ce qui peut me déplaire venant de cet Autre. Je m’y oppose mais, avec une malignité redoutable, il trouve le moyen de s’infiltrer tout le temps, de déjouer mes capacités de défense, ma morale (j’ai le droit d’avoir de la morale, tout de même, non ?). Et puis voilà que me viennent des trucs pas possibles. Et cependant, avec une épreuve d’autant plus remarquable, qui est celle-ci, qui est bien connue de tous les mystiques : c’est que plus je suis moral, plus je suis perturbé par les pensées qu’il ne faudrait pas. Cela a été jusqu’au point - vous le trouverez dans les textes, dans l’observation qu’a faite Freud de L’homme aux rats – au point que Freud en arrive à dire : mais l’inconscient, c’est le lieu de tout ce qu’il y a de mauvais et de méchant en nous, de vicieux. Et donc pour lui, l’importance hygiénique de le soigner, de le curer, c’est le cas de le dire : le terme de cure, là, a vraiment un sens « plombièresque ». On va curer l’inconscient.
Non, mais on est quand même fait de façon bizarre, non ? Il y a des patients extraordinaires pour lesquels j’ai toujours beaucoup d’affection et qui luttent contre leurs pensées (ils s’appellent les névrosés obsessionnels), qui ont des conduites de propreté, d’évitement, des scrupules moraux infinis. Et plus ils luttent, plus ils sont débordés.
Question de l’identité. Où est-elle alors mon identité ? Elle est, comme je viens de le dire, dans ce qui est, par exemple, l’honneur que j’entends voir attacher à mon nom. Mais il y a cette autre identité, cette identité Autre, ce sujet dans l’inconscient. Alors lui, il n’a pas de nom propre, ce qui ne veut pas dire qu’il est anonyme puisque je le reconnais comme animé par ma voix, par ma parole. Ce n’est pas un autre, là, qui parle en moi, bien qu’il vienne de l’Autre. Je suis bien obligé, lui, venant de l’Autre, de le reconnaître comme mien. Et on verra pourquoi. Alors, est-ce que mon identité finalement est du côté de l’idéal que je défends, est-ce qu’elle est du côté de l’Autre qui m’embête, qui m’obsède, qui me gêne ?
Pour conclure ce soir, une dernière remarque : si le progrès culturel faisait qu’il soit reconnu que cette identité propre à chacun, et qui peut lui être chère pour toutes les raisons que l’on voudra, ou pas chère (cela dépend de la façon dont il est venu au monde), mais si cette identité est reconnue comme étant systématiquement doublée par un autre, par l’Autre, qui, elle, n’a pas de nom, n’a pas de référence à une origine, ordinairement, (sauf évidemment si sa propre origine a dû être refoulée), et que chacun est ainsi à la fois porteur de son identité, de sa généalogie, de son appartenance (nationale, linguistique, religieuse) et qu’il n’est pas moins doublé par cet Autre qui, lui, n’a pas de nom, n’a pas d’origine, est un effet de son rapport au langage, qu’il le veuille ou pas, avouons quand même que cette reconnaissance par la culture de ce qui est la complexité de l’identité - et avec le fait qu’au-delà des différences liées à ce que nous savons : la généalogie, la langue, l’origine, la religion, etc. - l’Autre en revanche est le même pour tous. Mais oui, tout le monde a le même Autre qui dit chez tout le monde la même chose, les mêmes conneries, les mêmes sottises, qui exercent chez chacun les mêmes tensions, les mêmes effets. Eh bien, est-ce que - voyez, je veux terminer avec vous sur une note pratique - ça changerait quand même le rapport avec autrui ? Parce que chacun pourrait quand même reconnaître dans celui qu’on appelle autrui le fait que pour ce qui en est de l’autre, eh bien, il strictement semblable et que la question sera donc posée de savoir ce que l’on estime devoir être décisif, déterminant pour chacun dans la constitution de l’identité, considérée dans son ensemble, dans son intégralité. Pour ce qui est de l’Autre, on est tous foutus de la même manière.
La prochaine fois, on entrera dans le fait que justement, ce qui distingue le psychotique, c’est qu’il n’est pas aliéné, il n’a pas d’Autre, et que c’est pour lui tout le problème : c’est une autre instance que celle que je viens de reprendre pour nous, que je viens de préciser, que c’est une autre instance qui va se trouver commander sa parole et sa conduite, et c’est celle dans l’étude de laquelle nous rentrerons la prochaine fois.
Donc, vous avez pu vérifier qu’effectivement j’ai constamment voyagé entre compétence et performance, entre ce qui est banal, ce que peut-être d’ailleurs vous savez déjà pour une bonne part, ou peut-être des éléments nouveaux.

