- PRÉSENTATION DE L'EPhEP
- L'École
- Les enseignements
- Un Cursus Général, un Cursus Spécialisé
- Le Cursus Général et ses modalités de contrôle
- Le Cursus Spécialisé
- Les Modules de formation Théorique (MTh)
- Le Module de formation Pratique (MP)
- Obligations de volume horaire
- Le Stage Seul
- Le Practicum Seul
- Modalités de contrôle des connaissances du Cursus Spécialisé
- Les enseignants
- Inscriptions
- Politique qualité de l'EPhEP
- Exposé des motifs
- Introduction au travail de l'année
- Livret des Enseignements
- Édito
- Bibliothèque Recherches
- Les dossiers de l'EPhEP
- Cours et conférences : extraits
- Conférences récentes
- Théorie / concepts
- Psychopathologie des névroses
- Psychopathologie des psychoses
- Psychopathologie de l'enfant
- Psychopathologie de l'adolescent
- Questions féminines
- Cognitivisme
- Neurosciences
- Psychothérapie institutionnelle
- Linguistique - signifiant - discours
- Philosophie
- Logique et topologie
- Anthropologie
- Histoire
- Lien social - institutions
- Droit
- Vidéothèque
- Vidéos récentes
- Théorie / concepts
- Psychopathologie des névroses
- Psychopathologie des psychoses
- Psychopathologie de l'enfant
- Psychopathologie de l'adolescent
- Questions féminines
- Cognitivisme
- Neurosciences
- Psychothérapie institutionnelle
- systemie
- Linguistique - signifiant - discours
- Langue - lalangue - la lettre - littérature - arts
- Philosophie
- Anthropologie
- Logique - topologie
- Histoire
- Lien social - Institutions
- Droit
- Parutions
- Dialogues
Agenda
Actualités
Grande Conférence de rentrée
12/09/2024 - 21:00
Parutions
Yorgos Dimitriadis & Anne Videau
Pierre-Henri Ortiz

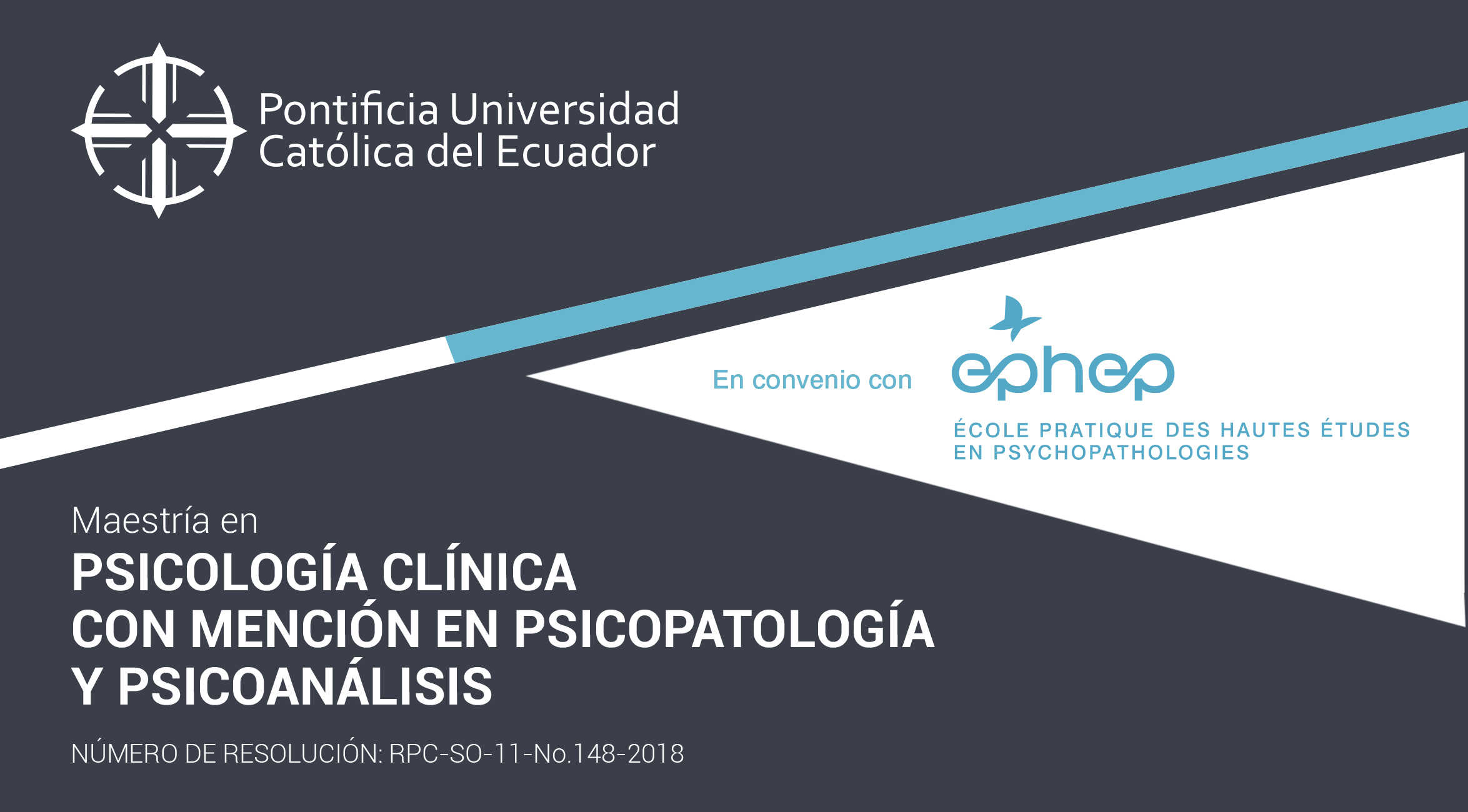



Les pathologies de l'imaginaire
par Claude Landman, doyen de l’EPhEP
L’Imaginaire, le corps du miroir, au même titre que le Symbolique, les mots, et le Réel, ce qui du corps résiste à la prise par l’image et par les mots, est une catégorie qui, nouée aux deux autres, désigne de ce que l’on appelle depuis Homère et faute de mieux, la psyché.
Le nouage entre ces trois dimensions dont nous étudierons cette année la structure topologique, est néanmoins susceptible de se montrer parfois défectueux.
Les différentes modalités de ratage d’un tel nouage entre les trois consistances RSI se déclinent en autant de structures psychopathologiques dans lesquelles celui ou celle qui s’y trouve pris tente, dans le lien social ou amoureux qu’il établit avec l’autre par la voie du discours, de trouver sa place de sujet désirant. Cette tentative ne va pas sans produire le plus souvent ce que nous appelons des symptômes plus ou moins gênants et dans lesquels l’Imaginaire se montre soit en défaut soit en excès. C’est la présence douloureuse de ces symptômes qui peut amener ceux qui en sont affectés à nous consulter et à nous demander de les alléger de leurs souffrances.
Nous travaillerons donc plus particulièrement cette année ce qui a trait aux pathologies de l’Imaginaire, c’est-à-dire un très large éventail clinique qui, outre les délires paranoïaques que nous avons étudiés l’an dernier, va de la phobie aux délires psychotiques d’imagination nommés également paraphrénies.
En passant par la pauvreté de l’imaginaire dans la dépression, l’amnésie d’identité et les affections dites psychosomatiques, ou au contraire sa richesse apparente dans la mythomanie, les addictions aux jeux vidéo, à la pornographie ou aux univers virtuels ; mais également dans le mentisme, avec ou sans consommation de produits toxicomaniaques, qui se définit comme le défilement permanent
de représentations projetées sur un écran intérieur, en résonance avec la dimension continue et sans limite de la consommation capitaliste.
Devons-nous situer dans le cadre de ces pathologies les différentes perversions, tant individuelles que sociales ? C’est une question à laquelle nous tenterons de répondre. Comme à celle des limites entre les pathologies de l’Imaginaire et certaines productions artistiques de type fantastique, notamment picturales ou cinématographiques.