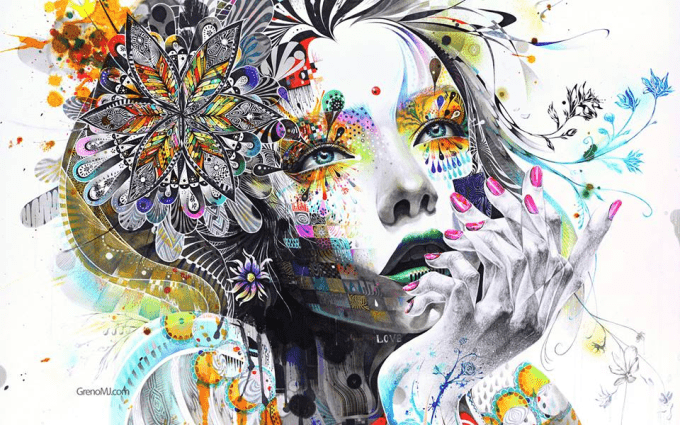
EPhEP, MTh3-CM, le 7/12/2017
Aujourd’hui je vous propose de traiter du traumatisme au sens du traumatisme psychique. Certains d’entre vous m’ont fait part de leur souhait d’aborder ce sujet complexe, qui est malheureusement d’actualité depuis la série d’attentats terroristes qui ne cessent de s’abattre à tour de rôle sur nos pays occidentaux depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York, et qui ont frappé durement nos pays depuis trois ans.
Cette vague d’attentats terroristes, ainsi que tous les conflits armés engagés par de nombreux pays sur la planète, a fait repenser la question des névroses traumatiques. Ce terme est remplacé par le vocable PTSD, selon la nomenclature nord-américaine en vigueur: Post Traumatic Stress Deasese (état de stress post traumatique). Nous reviendrons sur ce glissement sémantique entre névrose et état de stress.
L’actualité a fait repenser la clinique du stress post-traumatique car il s’est agi de définir des critères de diagnostic précis, ainsi qu’une sorte d’échelle d’évaluation des dommages encourus par les victimes de ce stress, de manière à les soigner, à prévenir l’apparition de certains troubles, et ce qui est encore plus fondamental, de manière à évaluer, à quantifier, à établir des barèmes de dédommagements financiers dont ils doivent bénéficier.
La clinique des états de stress post-traumatiques s’accompagne obligatoirement de l’établissement rigoureux du statut de « victime ». Ça c’est fondamental.
Ces vagues d’attentats posent donc un problème clinique, psychopathologie compliqué, thérapeutique, sociétal et socio-judiciaire.
Je suis venue aujourd’hui avec deux ouvrages, le premier que je vous recommande vivement, est un numéro du JFP consacré au traumatisme, numéro 36, qui date du 2011, donc d’avant les attentats. Je suppose que les statistiques changeraient un peu. L’autre que je ne vous recommande pas du tout, est devenu un best-seller : le livre de Caroline Langlade, Sortie de secours, préfacé par François Hollande. C’est le témoignage d’une jeune femme rescapée du Bataclan, qui décrit son ressenti lors de l’attentat, mais surtout elle va insister sur son combat à l’aide d’une association qu’elle va contribuer à créer, afin de dédommager en conséquence de nouveaux types de préjudices qu’elle isole : le préjudice d’attente et d’angoisse de mort d’abord, et le préjudice encouru par les familles, qui pendant un certain laps de temps, ne savent pas ce que sont devenus leurs proches, et les ont vus ou crus morts. Elle cite l’expérience traumatique vécue par son père, qui pendant un certain temps, l’a crue morte et en quelque sorte l’a enterrée, tuée, et en a ressenti un énorme sentiment de culpabilité, d’où son traumatisme. Pour elle, ces proches de victimes d’attentat sont des victimes par ricochet.
Donc c’est l’attente immense dans cette angoisse de mort, dans cette impression de mort imminente, qu’elle veut faire valoir comme préjudice.
Un Secrétariat d’Etat à l’aide aux victimes d’attentats terroristes a été créé après les attentats du 13 novembre 2015. On se souvient tous du discours de François Hollande ce jours là qui déclare notre pays en guerre, ce qui justifie que les victimes d’attentats terroristes soient considérées comme des victimes de guerre et prises en charge et dédommagées par l’Etat comme il se doit. Un fond de garantie des victimes d’actes terroristes a été créé en 1990 sous la pression d’associations de victimes d’attentat et par une modification du cadre de la procédure pénale, ce fond de garantie à le pouvoir d’établir et de dédommager les victimes d’actes terroristes. Si je vous parle de tout cela, c’est que le statut de victime est un volet essentiel de la clinique des traumatismes psychiques. La définition, le statut de la victime est l’objet d’un foisonnement de travaux et publications, qu’ils soient victimes de guerre, de génocide, de dictature ou d’attentats terroristes.
Pendant longtemps ce statut n’a pas été reconnu, ni même évoqué malgré les deux conflits mondiaux, l’holocauste, un nombre incalculable de génocides. On n’a pas parlé de “victimes” mais juste de témoins, tel le fameux texte de Primo Levi que tout le monde connait : Si c’est un homme . Il ne se porte pas comme victime mais comme témoin. En France, les travaux récents de Fassin et Retchman permettent d’établir une généalogie de la figure de la victime. Leur ouvrage s’intitule L’empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime, édité chez Flammarion en 2007. D’après ces auteurs, c’est dans le cadre d’une procédure judiciaire, tels les procès Barbie ou Papon, suite à une reconnaissance médicale, que la victime devient une figure légitime dans un espace social. Les auteurs évoquent également la notion de « victimes mobilisées », qui se regroupent au sein de collectifs et/ou d’associations. Par ce mouvement d’entraide spontanée, elles peuvent se traiter en quelque sorte entre elles, en évoquant une expérience, un vécu commun qui leur permet une reconnaissance, et cela constitue le début d’une thérapeutique. On peut également faire valoir cette reconnaissance auprès du public, des médias et des tribunaux. Les auteurs évoquent également une pente dangereuse qui serait le revers de la médaille, à savoir une tendance à la victimisation de nos sociétés (mais cet aspect du problème n’est pas le sujet d’aujourd’hui).
Les auteurs constatent que c’étaient surtout les historiens américains, qui avaient repéré que le traumatisme psychique, le PTSD, n’a valu son existence dans la clinique psychiatrique et a vu son apparition dans le DSM3, que lorsqu’il s’est agi, sous la pression d’associations d’anciens combattants, de dédommager les vétérans de la guerre du Vietnam, qui revenaient délabrés, abîmés psychiquement de ces années de combat.
Donc il est important de savoir que la clinique des séquelles psychiatriques du traumatisme, n’a valu son existence que par l’établissement du statut de victime.
Tout d’abord un petit peu d’histoire de la psychiatrie sur la notion de traumatismes psychiques et les séquelles psychiatriques d’un traumatisme.
Traumatisme : ça vient du grec trauma, qui signifie blessure et on retrouve déjà dans le dictionnaire Bailly, le dictionnaire grec-français, l’utilisation du terme pour qualifier les dommages causés par les guerres et également les soucis de dédommagement pénal des blessures provoquées par un tiers. Dans une acception antérieure au grec classique, la racine «trau » » signifie trouer, ce qui justifie pleinement le néologisme de Lacan de «"troumatisme"» pour indiquer que le symbolique vient trouer le réel. Il reprend la métaphore du potier consignée dans les travaux de Levi Strauss.
L’effroi : traduction de l’allemand «Shrek », comme le petit personnage des bandes dessinées de gamins. Le terme est créé par Oppenheim en 1884, pour décrire ces états émotionnels étranges observés à la suite d’accidents de chemin de fer. C’était le début du trafic ferroviaire. Il remarquait que certains accidentés, bien qu’apparemment indemnes physiquement, présentaient pourtant des troubles psychiatriques très sévères.
Freud conservera ce terme, effroi, Shrek, dans sa description de sa névrose traumatique, pour qualifier cet affect ou émotion, différente de l’angoisse ou de la peur, qui elles, supposent une anticipation. C’est extrêmement important. !
L’effroi, dira Freud, est un état suscité par un danger auquel on n’est pas préparé, donc sans objet, à la différence de la peur et sans attente à la différence de l’angoisse. Donc le sujet n’y est pas préparé, il est pris par surprise. C’est un réel qui laisse le sujet sans recours ni protection, sans les mots pour dire, ni même un imaginaire pour narrer, dira Jean Jacques Tyzler. Freud donne à l’angoisse, on le voit, un rôle protecteur. Celle-ci inexistante n’a pu préparer l’appareil psychique au danger, elle ne peut pas générer de névrose, cela vaudra aussi pour ce qu’il en est de la contrainte de répétition. !
La peur maintenant : furcht, en allemand, définit l’émotion ou l’affect défini par un objet ou une situation, bien circonscrite, perçue comme menaçante, en fonction de laquelle le sujet peut organiser un comportement de défense, attaque ou fuite. Ceci vaut pour un danger réel, aussi bien que pour un danger perçu, imaginé ou fantasmé comme menaçant.
Pour désigner l’angoisse, l’allemand n’a qu’un seul vocable : « angst », l’anglais également n’en a qu’un, c’est « anxiety » ; en français en revanche nous en possédons deux : ce sont les termes angoisse et anxiété. Il est classique dans les manuels de psychiatrie de différencier l’angoisse de la peur. On a peur de quelque chose tandis que l’angoisse est intransitive : on n’a pas l’angoisse de… quelque chose, on est angoissé. Cela désigne un affect sans objet extérieur déterminé. On dit classiquement que l’angoisse est sans objet, ce qui bien évidement n’est pas le cas, mais il ne s’agit pas tout simplement du même objet, il n’a pas cet objet-là, la même topographie, la même topologie. On parle d’anxiété plutôt que d’angoisse dans les cas un petit peu moins intenses, alors que le terme angoisse signifierait un degré de plus dans la gravité ou également on dirait qu’anxiété servirait plutôt à décrire la dimension physique neurovégétative de l’affect. Il s’agit donc d’un sentiment d’attente inquiétante, d’une anticipation menaçante !
Le stress, enfin : puisqu’il y a depuis le DSM3 un glissement sémantique entre névrose post-traumatique et état de stress post-traumatique. Le stress c’est un terme anglo-saxon, c’est un anglicisme, qui signifie pression, tension et qui met l’accent sur la dimension physiologique de l’émotion, les symptômes qualifiés de neurovégétatifs. C’est un éternel débat qui oppose les théories émotionnelles et idéiques des troubles psychiques. Déjà en 1893 deux physiologistes du nom de James et Lang, soutenaient la thèse que l’émotion n’était que la prise de conscience des réactions viscérales et glandulaires, antérieures au fait mental. Ainsi les symptômes organiques de l’émotion, loin de suivre l’état affectif le précèdent et le déterminent. Les symptômes organiques donnent naissance à l’émotion et l’intelligence n’intervient que secondairement, non pour la produire mais pour constater l’état émotionnel. Ils disent « Nous sommes affligés parce que nous pleurons, irrités parce que nous frappons, effrayés parce que nous tremblons », Théodule Ribot, un psychologue français de la même époque, dans La psychologie des sentiments écrira : « la conscience de ces troubles organiques est l’état psychique que nous appelons l’émotion ».Actuellement on en est exactement au même débat.
Si je fais tous détours en précisant cette terminologie, c’est qu’elle a une importance considérable pour comprendre les phénomènes psychopathologiques.
L’histoire de la névrose d’angoisse : la question du traumatisme se pose dès la naissance de la psychanalyse. En novembre 1892, Freud écrit : « C’est un traumatisme psychique souvenir qui est à l’origine de l’attaque d’hystérie ». Sa célèbre formule « l’hystérique souffre de réminiscences » postule que l’origine des symptômes est un traumatisme subi dans l’enfance ou à l’adolescence, qui a été oublié ou refoulé ». L’hypnose et ensuite la technique des associations libres permettent de reconvoquer le souvenir de ce traumatisme, mais la guérison du ou des symptômes consistera en son rapatriement dans la conscience. Freud ajoute en 1895 « il ne faut pas s’attendre dans l’hystérie à découvrir un seul souvenir traumatique issu d’une unique représentation pathogène mais au contraire toute une série de traumatismes partiels d’association d’idées pathogènes ». Il ira même plus loin en octobre 1895 où il écrit : « Nous ne manquons jamais de découvrir dans l’hystérie, qu’un souvenir refoulé ne s’est transformé qu’après coup en traumatisme ». Cette notion « d’après coup » très rapidement associée à la notion de traumatisme refoulé est absolument fondamentale. Dans la névrose, la question du traumatisme, lie celui-ci au sexuel et il pointe l’importance de la puberté comme tournant de la vie. En octobre 1895, Freud dit encore « l’hystérie a une étiologie sexuelle pré pubertaire liée à l’effroi et au dégoût ». La question de la surprise est importante et la définition du traumatisme est donc économique, il s’agit de l’économie psychique.
Comme vous le savez également il laissera tomber cette notion de traumatisme liée à une scène de séduction réelle par un adulte sur l’enfant et il élaborera par la suite le concept de fantasme. L’enfant n’a pas vécu dans le réel une scène de séduction par un adulte, mais l’a fantasmé, ce n’est plus un fait historique qui va guider la naissance de la subjectivité, mais une construction fantasmatique, telle qu’elle est décrite dans le célèbre article de Freud « Un enfant est battu » ou « On a battu un enfant », en fonction des traductions qui datent de 1919. C’est une scénette masturbatoire avec sa propre grammaire qui masque la position masochiste d’être battu par un représentant paternel. C’est la condition d’entrée dans la sexualité.
En ce qui concerne la névrose traumatique , l’histoire commence avec un allemand Oppenheim en 1884, qui décrit le premier, des réactions hystériformes chez les accidentés des chemins de fer, bien qu’il n’aient, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, aucun trouble physique. C’est le début du chemin de fer, il est vécu, par la population, comme une espèce de machine diabolique, comme un engin dangereux, qui met la vie des gens en danger par sa vitesse que l’homme ne supportera pas, etc.
C’est à partir de cas analogues observés cette fois chez des victimes d’accidents du travail, que Charcot a décrit ensuite des cas d’hystérie traumatique chez l’homme, confirmant ainsi la thèse de Pierre Briquet que la névrose hystérique n’a rien à voir avec l’utérus mais avec une certaine partie de l’encéphale, propre à recevoir les émotions. Cette partie du cerveau pourrait être plus sensible chez certaines personnes que d’autres et notamment chez les femmes qui ressentiraient plus violemment les effets des traumatismes. C’est ce que Pierre Briquet écrit dans son Traitéclinique et thérapeutique de l’hystérie de 1859. Briquet ne fait pas de grandes différences entre les traumatismes physiques et psychiques dus à la misère et aux mauvais traitements subis pas les hystériques, qu’il traitait dans son service de la Charité. C’est le cas de le dire, le terme était bien choisi.
Dans le DSM3 américain, la dénomination de névrose hystérique est abandonnée, au profit de celle du dissociative disorder (troubles dissociatifs), les auteurs américains ont proposé le terme de « Briquet Syndrom », histoire de faire la peau définitivement aux apports freudiens et à la psychanalyse.
Il faudra attendre néanmoins le désastre de la Grande Guerre de 14-18, pour que la névrose traumatique fasse vraiment son apparition. La violence des combats engendre frayeur et effroi. Les combattants hébétés, hagards, souffrant de troubles confusionnels sont décrits sous l’appellation d’« hypnose des batailles ». Plus tard, la stabilité du front inaugure la guerre des tranchées, marquée par le pilonnage incessant d’obus. Il engendre des manifestations d’hyper-expressivité, d’incoordination motrice, telle que « l’astasie-abasie ». Ce sont des troubles moteurs, les personnes ne peuvent pas garder de position stable, ni assis, ni debout, ils sont sans arrêt en déséquilibre. Astasie-abasie, on en a vu d’ailleurs des extraits sur les films de traumatisés de guerre. On va trouver également des déficits moteurs des membres, des phénomènes de conversion. Ces manifestations là vont être dénommées « hystérie de guerre ».
Freud, devant l’une des caractéristiques des phénomènes psychiques post-traumatiques, en reconnaît leurs spécificités sous l’appellation de « névrose traumatique ». Ces phénomènes de répétition, considérés comme le noyau dur de la symptomatologie des traumatismes, se manifestent par des reviviscences diurnes de la scène traumatique, des cauchemars répétés avec une charge affective extrême, sans catharsis, et ce constat va amener Freud a élaborer le concept de pulsion de mort. Le fameux article Au-delàdu principe de plaisir de 1920.
Cette compulsion de répétition est due, d’après Freud, à la recherche constante du psychisme a trouver une résolution à ce qui s’est passé, même si le plus souvent elle échoue, ce qui entraîne une chronicité de l’état post-traumatique. La répétition du traumatisme, plutôt des réactions de sauvegarde mises en œuvre au moment de l’événement traumatique, est la seule façon de résoudre ce traumatisme, puisqu’il n’en reste aucune représentation. Ceci est fondamental : aucune représentation qu’elle soit consciente ou inconsciente.
C’est ce paradoxe que Ferenczi tente d’expliquer, à savoir que ce qui ne peut être représenté, ce que LACAN va nommer le réel justement, ce qui ne peut être représenté donne lieu à une répétition de représentations riches qui sont parfois aussi destructrices pour le sujet que l’événement traumatique lui-même. Ces représentations peuvent être l’objet de refoulements secondaires avec oubli, dont le sujet peut être extrait dans certaines conditions, par exemple au cours de psychothérapie, pour divers troubles ou après un nouvel événement traumatique, que les anglo-saxons appellent « stressor ». On a vu ce phénomène après les attentats du 13 novembre 2015 se produire, quand sont survenus de nouveaux attentats extrêmement meurtriers, tel l’attentat d’Orlando, l’attentat de Berlin, puis évidemment celui de Nice, qui re-frappe à nouveau notre sol. Le problème de la levée du refoulement conduit à un débat extrêmement animé voire houleux entre Freud et Ferenczi. Pour Ferenczi, le traumatisme est resté en souffrance, en attente de remémoration, de représentation et il ne peut accéder à ce statut, qui engage à la fois les représentations symboliques et l’image du corps, qu’à la condition d’être à nouveau souffert par le sujet, c’est-à-dire revécu. Mais cela entraîne le problème du contre transfert qui va l’opposer violemment à Freud. Le psychanalyste, en effet, pour Ferenczi, doit sortir de sa neutralité et doit accompagner le patient dans une reconstruction, comme un puzzle de ce qui a été vécu. Le patient doit pouvoir s’étayer sur l’empathie du psychiatre, ou du psychothérapeute, il doit à tout prix croire à ce qui est arrivé au patient et sortir de la réserve habituelle du psychanalyste qui hésite toujours entre une expérience réellement vécue ou fantasmée. Certaines techniques, largement utilisées aux USA et dans d’autres pays, sont basées sur ce type d’argutie et ont pu donner lieu à de véritables épidémies de remémoration d’abus sexuels de l’enfance, auxquelles nous ne manquons pas d’assister actuellement, surtout quand il y a des injonctions et quand ces injonctions se pratiquent sous hypnose, il y a eu de véritables épidémies d’abus sexuels chez l’enfant, donc c’est dangereux qu’on puisse induire un souvenir traumatique.
Un autre auteur apporte un témoignage intéressant sur les séquelles psychiques des traumatismes de guerre. Il s’agit d’un psychanalyste anglais très connu pour ces travaux de psychanalyse, qui est un élève de Mélanie Klein, Bion. Bion a vécu la guerre de 14-18 et en a gardé des séquelles traumatiques. Il avait 19 ans quand il avait été engagé dans les combats. Et il décrit dans ses carnets de guerre, Mémoire de guerre qui est un ouvrage posthume, édité et préfacé par sa femme, il décrit ce qui se produit dans la mémoire traumatique elle-même , c’est extrêmement intéressant : il dit : « vous pouvez vous souvenir seulement des choses que vous pouvez oublier, mais où peut se situer l’inoubliable? ». Il va perdre ce carnet sur lequel il inscrivait quotidiennement les événements qui s’étaient déroulés et il précise que tout ce qui s’est passé hors du front ne peut pas être précis mais qu’en revanche tout ce qui s’est passé au cours des actions menées, est imprimé comme sur un support matériel, comme des photos, comme des instantanés et qu’elles sont conservées comme des documents inaltérables. Ce sont des images de cadavres, des enregistrements de sons, d’odeurs, etc. Toutes ces impressions, dit-il, ont la qualité de présence d’une hallucination. Nous pourrions qualifier ces événements de réels sans possibilité de les symboliser.
Autre point qu’il évoque, et qui est commun à de nombreuses victimes de traumatisme, c’est l’impression de n’être plus vivant, d’être mort. Il dit « je suis mort le 8 août 1918 », c’est la date de la bataille d’Amiens, et ailleurs il dira « je suis mort à Cambrai en 1917 », une autre bataille ou presque tous ses amis sont morts brûlés dans leurs tanks. C’est de fait une expression curieuse, on ne peut pas dire « je suis mort », on peut dire « je meurs » ou « je vais mourir » ou « j’ai peur de mourir » ; « je suis mort » est quelque chose de l’ordre d’une aberration. On retrouve pourtant ces témoignages, cette expression « je suis mort, je suis mort ce jour-là », on retrouve cette expression dans les témoignages de victimes d’attentats terroristes.
C’est cette impression que Lacan dénomme « entre-deux morts » ; un espace entre deux morts, la première mort marquant la simple cessation de vie biologique. Dans l’expérience de Bion, quand son camarade Smith est frappé d’un éclat d’obus dans le cerveau et que Bion dit « nous ne pûmes rassembler ses membres proprement pour les mettre dans sa tombe ».
Anéantissement de la vie et de la subjectivité réduite à l’état de morceaux de chair, c’est la première mort. La deuxième mort est symbolique, c’est quand on peut mettre un nom sur cette tombe. C’est ce qu’il cherche désespérément à faire à toute allure, avec Smith. Rassembler les morceaux, les mettre dans une tombe et mettre un nom. A savoir pouvoir de nouveau le nommer, passer de « ça » à Smith.
Lacan, en 1964, dans son séminaire Les quatre concepts de la psychanalyse s’intéresse au problème des rêves traumatiques. Quelque chose répète et répète à l’identique, mais rien n’est créé, rien n’est rajouté, inventé comme c’est le cas dans la notion de répétition. Si d’après Freud, le rêve est un accomplissement de désir, quels sont alors ces rêves répétitifs d’effroi qui réveillent invariablement le sujet au même moment de la scène traumatique ? C’est réel qui revient toujours à la même place et fait fracas. Lacan précise alors que, s’il n’y a pas de fantasme, c’est-à-dire si le sens sexuel ne vient pas recouvrir le traumatisme initial, le sujet reste soumis sans mot pour le dire, sans imaginaire pour en parler ; il reste soumis au non-sens du traumatisme. Chez Freud la question du sens est une question majeure et Lacan la reprend à sa façon, le sens est un sens toujours sexuel. Donc Lacan précise que le fantasme couvre ainsi la place du traumatisme, c’est-à-dire que le fantasme est l’écran qui dissimule la place d’un réel indialectisable. La dialectique se nourrit nécessairement d’une opposition et ce réel, à partir du moment où il est indialectisable, ne passe pas, insiste et on le retrouve toujours à la même place.
Cette question-là a mis Freud dans l’embarras ; il introduit une dichotomie entre névrose dite de transfert, que sont les névroses hystériques et les névroses obsessionnelles entre autres, et les névroses dites actuelles qui incluent la névrose d’angoisse et la névrose traumatique. Il est embarrassé par cette différenciation parce qu’il tenait à élaborer un mécanisme commun à toutes les différentes névroses. La psycho-névrose, ou les névroses psychogènes, dépendent de complexe de représentations inconscientes refoulées et sont accessibles à la cure analytique. Les névroses actuelles quant à elles, qu’il qualifie de toxiques, auxquelles d’ailleurs il associe la toxicomanie, s’apparentent et leurs genèses ne portent pas sur des signifiants refoulés mais sur un facteur essentiel, qui est actuel, qui est dans le présent, qui donc n’est pas refoulé. Par conséquent, ces névroses dites actuelles, ne sont pas accessibles à la cure analytique puisqu’il n’y a pas de refoulement.
Charles Melman donne la définition suivante du traumatisme, il dit : « c’est une stase d’une pensée positivée et rebelle à toute dialectique… que c’est ainsi que le répétitif, avide à retrouver la frappe causale … désintérêt à l’égard du champ perceptif ». Pensée positive, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de refoulement. Rebelle à toute dialectique, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de parole. Désintérêt à l’égard du reste du champ perceptif, c’est-à-dire que c’est moins la scène traumatique qui s’impose que le sujet qui se dégage du champ perceptif. Melman évoque une subversion du fantasme, en précisant que ce type de subversion se produit à chaque fois que la rencontre avec l’Autre, le grand Autre, n’est pas médiatisé par le père. Ce même père qui dans l’article de Freud On bat un enfant porte le coup et le sens sexuel.
Il s’agit d’un article de Melman intitulé Déontologie du traumatisme qui se retrouve dans le n°1 du JFP de 1994, qui s’intitulait Le traumatisme et ses incidences subjectives.
Si les séquelles post traumatiques avaient déjà été décrites, ce n’est que dans le dernier quart du 20ème siècle, qu’elles ont figuré comme telles dans la nosographie psychiatrique, dans le DSM3, pour des raisons, je vous l’ai dit, politiques. Il s’est agi pour les Etats-Unis d’Amérique de dédommager les victimes de traumatisme psychique occasionnés par la longue et coûteuses guerre du Vietnam. C’est sous la pression d’associations de vétérans de la guerre du Vietnam, que les médecins militaires nord-américains ont établi les critères diagnostic précis du PTSD, afin d’évaluer les séquelles, leurs natures, leurs degrés de gravité. Il s’agissait de dédommager les anciens soldats.
Lors de la première guerre mondiale, bien que les symptômes de la névrose traumatique aient été repérés, leur signification pathologique était rarement reconnue. Les soldats étaient renvoyés au front après quelques traitements extrêmement violents, comme des chocs électriques, ou alors passés directement devant le peloton d’exécution sous l’accusation de traîtrise ou de désertion. Freud au demeurant était intervenu comme expert après la première mondiale dans un procès qui avait opposé un lieutenant qui portait plainte contre d’un médecin, qui était pourtant un ami de Freud, qui avait infligé au dit lieutenant un traitement très violent par chocs électriques et qu’il avait immédiatement après, renvoyé au front. Freud, malgré toute l’amitié qu’il éprouvait pour son confrère, s’était insurgé contre ce type de sévices. Donc on peut s’étonner que malgré tous les conflits armés auxquels on a assisté, les génocides, l’holocauste, qui ont eu lieu pendant ces décennies, malgré les connaissances du trouble et les conclusions des cliniciens lors des conflits armés, ça n’est qu’au moment où un mouvement associatif spontané, celui des vétérans de la guerre du Vietnam, que la nosographie psychiatrique prend en compte le syndrome de PTSD.

