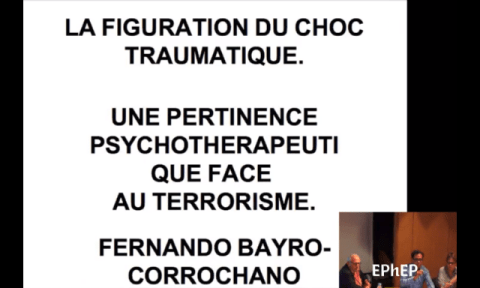M. Bellet : Ce soir, c’est Omar Guerrero qui nous fait le plaisir de venir nous parler sur ce titre qu’il nous a proposé. Alors, pourquoi le traumatisme ? Parce que Omar travaille d’une part au Centre Primo Levi et pour une ONG également, EliseCare. Il est un peu au premier rang vis-à-vis de ces questions du traumatisme, donc il va vous préciser un peu les institutions pour lesquelles il travaille et il développera son sujet. Voilà, je lui passe la parole.
M. Guerrero : Merci, Alain, effectivement ; je vais d’abord me présenter très rapidement pour dire d’où je parle et ensuite vous proposer trois axes de réflexion à partir de ce titre que j’ai donné à Alain comme proposition. Je travaille principalement à mon cabinet à Paris, mais je fais quelques vacations au Centre Primo Levi, centre qui reçoit des personnes qui ont été victimes de violences politiques et de torture, où je reçois des adultes et des enfants ce qui est aussi l’une des particularités de ce centre. J’interviens aussi ponctuellement pour cette ONG qui s’appelle EliseCare et donc j’ai été en Irak pour coordonner un peu ce qui concerne la santé mentale pour cette ONG, notamment les enfants des familles yézidis suite au passage de Daesh. Et donc il y a beaucoup de choses à dire et à travailler concernant le traumatisme et les séquelles de toutes ces violences. Je suis psychanalyste, psychologue clinicien de formation. Je le dis parce que j’ai assisté aux quelques minutes d’échanges tout à l’heure où Pierre-Yves Gaudard disait très rapidement quelque chose sur le statut que vous avez quand vous finissez l’EPhEP, le fait de travailler en institution, ça fait partie je pense aussi de ces questions qui m’ont travaillé longtemps car j’interviens en institution en tant que psychologue clinicien. C’est alors l’une des questions par rapport au traumatisme : est-ce que vous êtes psychanalyste en institution ? J’espère que vous allez vous poser cette question après. Aujourd’hui je vais juste dire que c’est possible, bien sûr, mais comment ?
Alors, les trois axes que je vais vous proposer sont très simples, très schématiques et je laisserai le temps pour qu’on ait un échange que j’espère riche à la fin.
Le premier point serait le traumatisme, vous donner quelques, non pas références, mais une piste de travail, une orientation sur ce qu’est le traumatisme. En deuxième point, les effets du traumatisme. Et le troisième, comment soigner, quelles sont les difficultés ou les pistes éventuellement pour travailler, pour le soigner, le guérir, le traiter.
Le traumatisme, qu’est-ce que c’est ?
Souvent on confond les termes, on utilise indifféremment traumatisme, trauma, traumatique. Et c’est un terme que vous lisez aujourd’hui dans les journaux tous les jours, il faut croire que chacun est traumatisé de quelque chose. Il y a beaucoup d’associations de victimes, contre lesquelles je n’ai rien, mais qui témoignent de combien la place de la victime est devenue centrale aujourd’hui. Si on a le temps, je pourrai peut-être en dire un peu plus sur la victime et tout ce qui concerne la jouissance de la victime. Mais déjà, pour ne pas les confondre, je vais vous proposer de distinguer ce que c’est que le trauma et le traumatisme.
Le trauma était initialement un terme médical qui voulait dire blessure, lésion, rupture. C’était un terme médical qui impliquait des conséquences, les effets dudit trauma, et ce sont ces effets-là qu’on appelle traumatisme. Quand j’insiste sur le côté médical au départ, c’est que cela concernait le corps, c’est-à-dire que le trauma, c’était la jambe cassée, la coupure, la blessure béante qu’il fallait soigner médicalement et j’insiste sur le réel du corps parce que, très vite – c’est là, comme je le disais à Alain il y a quelques minutes, que j’aimerais faire quelques liens avec l’intitulé du cours, c’est-à-dire le social, particulièrement le social – ils se sont rendu compte qu’une jambe cassée ne guérissait pas aussi bien et aussi vite si la personne s’était cassé la jambe en glissant sur une peau de banane ou bien si c’était le voisin qui l’avait agressé par exemple. Et j’irais même plus loin : si ce voisin avait été puni ou pas, les effets n’étaient pas non plus les mêmes. Et donc là vous voyez qu’il y a cette dimension, je vais d’abord l’appeler psychique, du traumatisme, c’est-à-dire les effets au niveau de la psyché mais aussi les effets au niveau du social.
Socialement il y a eu une rupture, parce que c’est à ça que je veux vous amener sur ce premier point sur le traumatisme, c’est-à-dire que le traumatisme a cette composante sociale, d’un ordre social qui est rompu. Si mon voisin m’a cassé la jambe, l’a-t-il fait sans faire exprès ? C’est la question de l’intention qui est en jeu : avait-il l’intention ou pas ? Nous avons un appareil judiciaire, des lois qui nous permettent de justement déterminer s’il y avait intention ou pas. S’il n’y a pas intention de nuire, nos lois, en France, parlent de responsabilité. On peut avoir blessé quelqu’un, voire plus avoir tué quelqu’un, sans le faire exprès, par mégarde, parce qu’on a été distrait, parce qu’on a mal mesuré tel ou tel geste, on conduisait, on a été distrait, peu importe. S’il n’y a pas l’intention de nuire, on est responsable seulement, mais dans le cas où l’enquête déterminerait que vous aviez une intention de nuire, à ce moment-là vous n’êtes pas responsable, vous êtes coupable. Et donc la peine n’est pas la même, le prix à payer n’est pas le même, et c’est ce prix à payer qui permet de rétablir quelque chose d’un ordre social. C’est-à-dire cette petite frustration que vous apprenez dès la crèche, quand vous commencez à vous confronter au social, quand vous voulez arracher le doudou à votre petit voisin et que vous avez les puéricultrices qui arrivent et disent : « non, non, pas comme ça, pas celui-là… », qui vous proposent des options, vous êtes obligés déjà d’encaisser une certaine frustration. Et c’est cette frustration qui nous permet de cohabiter, de partager un espace social avec les autres. Cette frustration on va l’avoir avec nous tout au long de la vie et si vous avez déjà entamé un petit peu la lecture du séminaire de Lacan sur La relation d’objet[1], vous savez que ce n’est pas seulement la frustration, vous savez qu’on peut décliner le manque avec trois termes différents : castration, frustration et privation. Mais c’est juste un clin d’œil, qui peut être intéressant si on échange après, ou bien pour vos propres lectures.
Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c’est que justement, cet ordre social étant rompu, il existe des leviers pour le rétablir, d’une manière ou d’une autre et c’est à ça que servent aussi nos lois, notre système de peines, de « tarifs », parce que selon ce que vous avez infligé comme « traumatisme » à l’autre, eh bien il va falloir payer plus ou moins, il y a un « tarif ». Je parlais de la crèche, mais on peut vieillir un peu notre exemple et évoquer l’école ou au collège : si vous faites une petite bêtise, vous aurez un mot ou une croix dans le cahier, selon les différents codes de l’établissement, mais si c’est quelque chose de plus grave ou de sérieux, eh bien vous serez peut-être exclu deux ou trois jours, voire définitivement. Cela permet à l’enfant d’apprendre qu’il y a un tarif, que cette frustration est là en permanence, qu’on doit se tenir, qu’on ne peut pas aller jusqu’au bout de notre geste, de notre envie, de notre caprice. Ce qui alors est intéressant, c’est que cette composante que j’appelle sociale du traumatisme est très importante. C’est-à-dire qu’un accident, ça peut arriver, le principe d’un accident c’est que précisément on ne contrôle pas et donc ça peut arriver, on ne décide pas mais l’important ça va être comment cet ordre social va être rétabli. Aussi l’impunité empêche le rétablissement d’un ordre social et dans ce cas on va traîner les effets de ce traumatisme pendant longtemps. Le voisin qui m’a cassé la jambe, par exemple, je risque de rester dans une position d’objet, de penser que je reste à sa merci pendant encore longtemps à moins que le voisin reçoive un avertissement, une punition ou autre qui, psychiquement, me permette de dire : « ah, c’est vrai, il n’a pas le droit, personne n’a le droit, il a été puni, cette loi est toujours présente, est toujours valable ».
En parlant de traumatisme et de rupture de l’ordre social, vous avez peut-être travaillé ce qu’on appelle les quatre discours chez Lacan, mais que ce soit à partir des quatre discours, ou avec des formules plus réduites comme celle du fantasme, ou encore des conceptions plus larges comme celle du signifiant, on a toujours affaire à un discours, à quelque chose qui tourne, à une dissymétrie des places dans le social. Parce que vous savez que notre social est ainsi organisé : il y a deux places, deux côtés. Il y a ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Tout social est organisé comme ça. Et comment on supporte ça ? Comment on supporte le fait de ne pas toujours être celui qui commande ? Eh bien, on a ce signifiant qui s’appelle le phallus, qui est celui qui va nous départager – on peut prendre un exemple, le plus simple, au niveau de la parole, de la prise de la parole, si pour ce soir on vous avait dit : « on va parler pendant 1h30, personne du public n’aura le droit de parler après », vous auriez été probablement un peu refroidis, vous auriez dit : « mais qu’est-ce qui lui prend ? c’est un tyran, un dictateur ! ». Parce que c’est ce qui se passe quand il y a une tyrannie, une dictature, les citoyens n’ont pas le droit de s’exprimer. Nous, on a le droit de râler, d’enfiler un gilet jaune éventuellement, d’arborer une pancarte et dire qu’on n’est pas d’accord, et même, si rien ne se passe, au bout de cinq ans, on peut dire qu’on n’en veut plus de celui-là, et déléguer notre pouvoir de décision à quelqu’un d’autre. Et l’on peut même réduire ça à l’échange au sein d’un couple, ça peut être un couple d’amants, mais ça peut être aussi un couple en famille, entre amis. Quand on est deux, on parle souvent de dialogue, mais justement le dialogue c’est l’alternance de cette position dissymétrique de celui qui parle, de celui qui tient le micro.
Je vais terminer cette partie-là sur le traumatisme en parlant justement d’une rupture au niveau du discours, ce qui arrive dans ces contextes de tyrannie ou de dictature, et qui sont quand même très nombreux, ce que je vois au Centre Primo Levi, avant de vous parler de ce que je vois en Irak.
Au Centre Primo Levi, je vois des patients, des adultes et des enfants qui ne viennent pas de deux ou trois pays, mais de beaucoup de pays où il y a une dictature – qu’elle s’appelle comme ça ou non. Il y en a qui viennent de République Démocratique du Congo, où d’ailleurs il y a une guerre civile qui se prépare, parce qu’à la fin du mois il y a des élections qui se préparent, qui ont été reportées d’année en année, tout le monde se demande si c’est une démocratie. Si vous dites que vous n’êtes pas d’accord, que vous sortez avec une pancarte contre le président, on ne va pas vous laisser marcher sur les avenues de Kinshasa, vous serez arrêtés bien avant, vous serez arrêtés très très vite. Mais il n’y a pas que le Congo. Au Centre Primo Levi, nous avons des patients qui viennent aussi de Turquie, de Tchétchénie, du Sri Lanka, de Colombie, de beaucoup de pays de tous les continents pratiquement, et ce qui fait pour moi un trait commun entre ces différents patients, c’est que tous témoignent de cette rupture, c’est-à-dire du fait que ça ne circule plus (au niveau du discours, du social), ce qui devait tourner dans un discours – cette alternance dont je vous parlais, qui nous permet de supporter l’autre qui parle, parce qu’on se dit : « bon, après, lorsqu’il aura fini sa phrase, je vais lui dire ce que j’en pense », on tisse comme ça un échange. Eh bien, il y a certains pays, en Afrique par exemple, il y a des présidents qui sont au pouvoir depuis 30 ou 40 ans, il y a une génération, parfois deux, qui n’ont connu que ça. Alors je disais, ce que je vois comme trait commun chez ces patients-là, c’est justement une sorte de discours verrouillé, ça ne bouge pas, ça ne circule pas, il n’y a pas d’alternance, il n’y a pas de promesse de parole, de tour de parole par exemple.
Je voudrais terminer sur la question du traumatisme en ajoutant que ça constitue quand même un problème au niveau social et ça a des conséquences même au niveau de la langue. Il y a des contextes dans certaines dictatures, les études les plus intéressantes ont été faites par rapport aux nazis, avec les travaux de Victor Klemperer [2], dont vous avez sûrement entendu parler, qui a fait une étude sur la simplification de la langue allemande, par les nazis, mais c’est quelque chose qu’on trouve dans tous ces contextes dont je vous ai parlé. Cela s’est retrouvé aussi dans les années 1970 en Amérique latine, quand il y a eu des dictatures, au Chili et en Argentine par exemple, ce n’est pas seulement une question de lexique, mais même la syntaxe de la langue qui a été modifiée. Comme si tout d’un coup, on se mettait d’accord pour transformer un mot, transformer un verbe, lui faire dire autre chose. J’ai des patients qui viennent aussi du Chili, qui ont été torturés il y a 50 ans, 40 ans, et ce qu’ils viennent me dire c’est que c’est un mot qui pose toujours problème, 40 ans plus tard ! Il y a une phrase, un mot qui coince, qui ne passe pas. Les bourreaux leur avaient dit : « ce mot, désormais, il signifie telle ou telle chose ». L’exemple me vient, relaté par plusieurs patients pour qui « l’heure du café » était le nom donné par les geôliers à une séance de torture. Vous imaginez leur réaction quand, peu de temps après la libération, un ami ou une épouse, prononçaient en les retrouvant « c’est l’heure du café ». On peinait à comprendre pourquoi s’en suivait une crispation, pourquoi des manifestations parfois impressionnantes au niveau même de son corps.
C’est important que ce soit entendu comme cela, cette composante que j’appelle sociale au niveau de la langue, du symbolique, qui va pour moi au-delà des blessures du corps. C’est une découverte que l’on doit à Freud qui s’est beaucoup intéressé à la guerre et aux effets de la guerre. Il y a par exemple ce tournant chez Freud – si ça vous intéresse allez reprendre ces lectures – qui avait une conception de l’appareil psychique et, après la guerre, il a constaté qu’il y avait des rêves, qu’on peut appeler traumatiques, des cauchemars, qui se répétaient : le même cauchemar, encore une fois, alors qu’il avait dit, quelques années auparavant, que le rêve ne servait qu’à une seule chose, à protéger le sommeil, à faire que le corps puisse se reposer. Eh bien là, il disait : « je ne me l’explique pas ! » Vous pourrez retrouver dans « Au-delà du principe de plaisir » quelques explications de Freud. Je vous en donne une, sans vouloir vous spoiler ce joli texte de Freud : il évoque la manière dont, par la répétition, le sujet essaye d’attraper quelque chose qui lui a échappé, quelque chose qui lui a été dérobé. La personne violentée a subi ce que j’appellerais – parce que ça s’approche de ça – une espèce de mort subjective, c’est-à-dire que le bourreau ne lui a pas demandé s’il était d’accord avec quelque chose, ou si il voulait… Non, sa volonté a été réduite à zéro, sa place est devenue une place d’objet pur, ou impur si vous voulez, mais de pur objet, réduit à ça, c’est-à-dire que son sujet, la subjectivité de cette personne-là, n’a aucune chance, aucune possibilité d’expression, c’est ça que j’appelais à l’instant cette sorte de mort subjective. Eh bien quand on connaît cette expérience-là, on a l’impression que quelque chose nous a été dérobé. Souvent ces personnes-là le disent même au niveau de la temporalité : quand il y a une procédure de demande d’asile, par exemple, qui dure, pour certains patients ça fait 4, 5, 6 ans qu’ils demandent l’asile, ils disent : « mais qui va me rendre ces quatre années ? ces quatre années pendant lesquelles je n’ai pas le droit de travailler, pas le droit de faire des études, pas le droit de gagner de l’argent, pas le droit de voyager… c’est comme une prison ! » Et même quand ça se passe bien et qu’ils obtiennent par exemple un statut de réfugié – dont je vais vous dire à tout à l’heure un peu la portée qu’on peut supposer à ce statut – même là, vous allez voir que ceux qui étaient médecins, professeurs, ou d’autres métiers dans leur pays, ne peuvent pas exercer en France. Ils sont alors ce qu’on appelle déclassés et cette perte cristallise parfois ce qu’ils ont perdu et qu’ils ne peuvent pas rattraper.
Les effets du trauma
On pourra peut-être revenir sur ce point, mais j’aimerais quand même décrire un peu avec ce deuxième point ce que j’appelle les effets du trauma et comment ils se manifestent. Vous avez sûrement entendu parler du PTSD, ce sont les initiales en anglais de l’état de stress post-traumatique, qui est en fait un syndrome, j’imagine que vous connaissez ce qu’est la définition d’un syndrome, un syndrome c’est un ensemble de symptômes. Je pourrais vous en faire la liste pour le PTSD mais vous avez sûrement des références bibliographiques pour ça, il y a les symptômes les plus présents, des troubles du sommeil par exemple, de la mémoire, de l’humeur, des comportements phobiques, des crises d’angoisse et d’autres manifestations un petit peu différentes chez les enfants ; chez les enfants je pourrais rajouter énurésie, encoprésie et quelques autres symptômes que j’ai constatés avec une répétition très étonnante, comme le strabisme divergent. Il ne s’agit pas de ces symptômes-là, que vous connaissez certainement, mais de voir ce que montrent ces symptômes, qu’est-ce qu’ils manifestent ?
Pour commencer et pour faire transition entre le traumatisme et ces manifestations-là, je dirai qu’il y a une différence importante à faire entre séparation et rupture. Ce n’est pas du tout la même chose. Une séparation ça se travaille, ça se traverse, il y a un deuil – c’est un autre mot pour dire ce que j’appelais tout à l’heure cette frustration –, il y a une perte, mais ça se travaille, ça se traverse et on fait avec. La rupture, c’est un peu différent, la rupture ce n’est pas forcément voulu, elle peut nous être imposée et il n’y a pas le travail que j’évoquais lors d’une séparation, il n’y a pas ce travail qui permet d’élaborer, un peu comme le disait Freud dans ce texte-là, qui permet de s’approprier de quelque chose. La rupture est un arrachement et ces patients dont je vous parle, utilisent quelques fois ce mot en parlant de leur pays, parce que ce n’est pas la même chose de dire : « voilà je pars pour travailler avec un cousin en banlieue parisienne » ou bien « je pars faire mes études en France ». Vous avez là un projet. Et puis ce n’est pas du tout la même chose si vous devez quitter le pays, la famille, la maison, vos affaires, que l’on vous dit : « vous avez trois heures pour ramasser vos affaires et partir », parce que votre vie est en jeu. Alors ces patients-là parlent justement de ces effets de rupture par rapport au pays, par rapport à la famille, par rapport à la langue, par rapport à la nourriture.
C’est intéressant de voir, surtout quand on suit des familles, des enfants et des familles, de voir l’importance que prennent la langue, la nourriture, la religion. Je ne nomme que ces trois-là mais c’est très très intéressant de voir que – quand il y a eu un travail de séparation – l’on peut plus facilement passer de l’une à l’autre (langue, nourriture, religion) ou cohabiter. Et concernant la nourriture, si on a le temps, on pourra y revenir tout à l’heure, sur les enjeux au sein d’une famille. Comment une famille, dont le rôle est entre autres de transmettre des valeurs, de transmettre un refoulement, c’est-à-dire d’indiquer à l’enfant comment il doit refouler. Ces familles-là qui se retrouvent très souvent dans des cantines (parce qu’elles n’ont pas le droit de faire à manger dans les hébergements), à manger quelque chose qu’elles ne connaissent pas, des parents qui disent à l’enfant qu’il doit manger, mais qui se retrouvent un peu sur le même plan que l’enfant, c’est-à-dire « comme toi mon enfant j’ignore le nom de ce plat et ses ingrédients ». On pourra peut-être y revenir tout à l’heure, mais pour moi il y a quelque chose là, allez du côté de Ferenczi (cf. « Confusion de langue entre les adultes et l’enfant »).
J’évoquais la question de séparation et rupture, parce que les symptômes ou les effets les plus importants du traumatisme sont justement peut-être deux plus un. Le premier : il y a un effet que j’appellerais de déliaison, c’est-à-dire rupture des liens. Parce que, contrairement à ce que l’on croit, et c’est curieux parce que même des psychologues y croient, la croyance générale est de se dire que la torture a été inventée pour faire parler, pour obtenir des aveux, mais, ça a été prouvé, vous pouvez lire les textes de Michel Terestchenko[3] par exemple, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez aussi lire la presse et voir la déception des psychologues qui ont conseillé la CIA, aux États-Unis, et d’autres travaux qui prouvent que justement la torture ne vise pas à obtenir des aveux. Elle n’obtient pas un contenu, la torture ne vise qu’à humilier, qu’à écraser cet autre, et l’une des manières, puisque nous sommes des êtres de parole, c’est de rompre les liens, de l’isoler.
Il y a une autre psychologue qui s’appelle Yolanda Gampel, qui travaille en Israël, elle était venue dans ce même amphithéâtre, il y a une quinzaine, non, une douzaine d’années, et elle avait expliqué une métaphore qu’elle utilise souvent pour le traumatisme : elle avait parlé de radioactivité. Elle disait que le traumatisme était radioactif, c’est-à-dire que les effets de ce traumatisme, et là par exemple je vous parle de rupture de liens, étaient comme des cercles concentriques qui s’éloignent et qui atteignent toutes les personnes concernées. L’exemple qu’elle utilisait, et c’est souvent un exemple très cru, c’est celui du viol. Le viol évoqué par des hommes et des femmes, par exemple le cas de viol de femmes au Congo ou de femmes Kurdes en Turquie. Quand une femme a été violée – on commence à éloigner ces cercles – l’un des premiers effets, c’est que, la plupart du temps, elle est rejetée par son mari (je parle encore du Congo, de la Turquie puisque j’ai pris ces deux exemples). Mais ce n’est pas simplement son mari, ça va être aussi les enfants, les enfants de cette famille, puisque la lignée n’est plus assurée (pour ça aussi vous avez une autre référence, les travaux de Lévi-Strauss[4]) les autres familles vont exclure – je parlais d’isolement il y a quelques instants – cette famille où cet acte est arrivé. Puis on continue à éloigner ces cercles, le village même va être stigmatisé, connu, par les villages voisins. C’est peut-être le dernier que je vais mentionner mais, nous aussi, en tant que thérapeutes, on est atteints par ces cercles, parce que très souvent, on est – je vais parler de ces effets-là aussi sur nous — on est neutralisés, d’où mon titre provocateur pour ce soir : très souvent je reçois des patients qui viennent déjà avec une présentation, soit une lettre d’un médecin, ou soit d’un compatriote ou de quelqu’un d’autre, une présentation très réductrice, une lettre qui dit : « Je vous envoie cette patiente parce qu’elle a été violée et donc elle est traumatisée ». Très souvent, par facilité en tant que thérapeute, on va dire : « Ah oui, le traumatisme est là ! ». Alors qu’elle n’a pas encore ouvert la bouche, elle n’a pas encore dit où était pour elle cette rupture qui est d’ordre psychique, et donc social, pour que vous puissiez opérer.
Je parlais donc des déliaison, rupture de ces liens. Il y a un autre effet qui est très intéressant, c’est la sidération. Quand vous recevez ces patients, il n’est pas rare qu’ils soient hébétés, dans un état d’insensibilisation pourrait-on dire, mais le terme qui me convient le mieux, c’est sidération. Par rapport à la pudeur, qui est pour moi un outil de travail, ce sont des personnes qui peuvent se dévoiler complètement ou pas du tout, mais sans attacher d’importance à la pudeur. Et pas seulement dans les gestes ou dans ce qu’elles vont montrer physiquement, bien que ça peut arriver, que des personnes cherchent à vous montrer des cicatrices ou d’autres choses qui ont pour moi un rôle presque d’holophrase, c’est-à-dire : « Je ne peux pas vous dire ce qu’ils m’ont fait mais regardez la cicatrice et vous allez comprendre ». Du coup, si vous regardez, vous êtes en train de faire l’économie des mots que cette personne aurait pu mettre sur cette cicatrice, le récit qu’elle aurait pu faire.
Il arrive que l’on vous dise : « Oh vous, en tant que psychanalyste, vous êtes quand même un peu dur parce que vous dites toujours que la personne est responsable ». Bien sûr, mais on n’est quand même pas extrémistes pour dire que la personne est responsable de ce qui lui est arrivé. Bien sûr qu’on pourrait pousser le bouchon très loin et dire : « Eh bien si, elle avait le choix, soit elle disait non et elle recevait les coups, soit elle acceptait ». Mais ce serait un peu violent de le dire comme ça, pour moi, la responsabilité, c’est au présent que je l’interroge, c’est-à-dire, « cela vous est arrivé, vous avez été victime d’abus, d’un abus de pouvoir, tout ce que vous voulez comme acte potentiellement traumatique, qu’est-ce que vous en faites aujourd’hui ? ». C’est là que je cherche la responsabilité du sujet.
Alors je parlais de pudeur – je reviens un peu à la question de la sidération et donc à cette pudeur – quand je disais que la pudeur était un outil de travail. C’est qu’il nous revient justement, puisque notre outil de travail passe par la parole, de faire un récit, que la personne puisse faire un récit. Et ce mot a une importance pour l’administration – et je ne demande pas à l’administration d’être psychanalytique, que ce soit l’OFPRA[5], en première instance, ou la CNDA[6], en deuxième instance, je ne leur demande pas d’être lacaniens ou d’être psychanalytiques – puisque les patients doivent y présenter un récit et ils se confrontent à une demande, on leur demande de dire la vérité.
Et en même temps, quand ils viennent nous voir, nous, de quelle vérité s’agit-il ? Il y a un jeu de mots qu’avait fait Lacan, vous l’avez sûrement entendu dire que la vérité a une structure de fiction, mais le jeu de mots dont je parle c’est qu’il lui est arrivé d’écrire fixion (avec un x), cette fixion c’est justement comme les patients qui viennent nous voir, au départ, avec une histoire qui coince quelque part : « Je viens vous voir parce qu’il m’est arrivé quelque chose que je n’arrive pas à résoudre, parce que la famille, parce que le couple, parce que le travail… parce que dans mon enfance… ». Il y a quelque chose qui coince. Eh bien, pour les patients qui ont subi des traumatismes comme ceux dont je vous parle, il y a quelque chose qui s’est figée et ils viennent avec ce discours-là. Quand je parle de traumatisme, c’est qu’il s’installe pour eux une sorte de fonctionnement binaire : il y a un avant et un après, et ils sont accrochés à cet événement, justement comme quelque chose qui est fixé, qui ne bouge plus. Si vous essayez d’interroger le sujet : « Qu’est-ce que vous en pensez ? ». Vous constaterez qu’il n’y a rien à penser : « Ils m’ont fait ça, et l’avant n’existe plus, maintenant je n’existe toujours pas, mais je sais pourquoi », et ils s’accrochent à cet événement traumatique.
Et quand je disais que notre outil de travail était la parole – ou la pudeur, en passant par la parole –, c’est justement accompagner, pousser, insister, avec le style de chacun, pour qu’une histoire s’écrive par rapport à ce qui est apparu au patient comme impossible à inscrire. Parce que c’est une autre définition, que je ne voulais pas vous donner comme ça d’emblée, du traumatisme, avec ce jeu de mots de Lacan, qui l’a écrit comme trop-matisme, c’est-à-dire quelque chose qui débordait de la chaîne signifiante, quelque chose qui était en trop et qui ne pouvait pas s’inscrire. J’ai le souvenir d’une patiente qui venait de Guinée, qui était très jeune, et qui avait été victime de sévices par des militaires ou des policiers dans un commissariat. Elle me disait : « Je ne sais pas comment ça s’appelle ce qu’ils m’ont fait ». J’ai trouvé que c’était très pur, très juste ce qu’elle disait, parce que justement, pour elle, c’était inscrit comme une brutalité, des actes, et elle venait demander comment ça s’appelait. Mais ce n’était pas à moi de les appeler. Il s’agit de l’accompagner pour voir comment elle, elle peut les nommer et ce qu’elle en fait, la manière de les inscrire quelque part, d’attraper ce qui a débordé, pour que ce soit pris à nouveau dans une chaîne.
C’est là, pour ces patients, dès les premiers entretiens, l’intérêt d’interroger par exemple leur vie d’avant. Qu’est-ce qu’ils étaient avant ? Qu’est-ce qu’ils faisaient avant ? Quels étaient leurs investissements signifiants ? Métier, hobby, difficultés quotidiennes… Évidemment, très souvent, ils me regardent et se demandent peut-être sur qui ils sont tombés, ils se disent : je suis venu lui parler de mon traumatisme, mais il ne me questionne pas comme les autres. Parce que très souvent ils ont vécu comme des répliques de séisme avec des cliniciens qui, je vous ai dit que j’allais évoquer la question de la jouissance, mais des cliniciens qui ont joui, alors que nous sommes payés pour ne pas jouir justement du patient. Il y a des cliniciens, j’en évoque un, celui qui me révolte le plus peut-être, qui me donne le plus la nausée : il y en a un qui a fait des photos de ses patients, qui a écrit les récits dans le détail, évidemment pour que ce soit croustillant, il a publié sous forme de livre. Ça n’accompagne pas beaucoup un travail de reconstruction ou de pudeur pour nos patients. Alors que justement, j’essaye de me placer non pas d’un côté moralisateur – vous avez cette différence fondamentale entre morale et éthique – non pas à partir de la morale, qui ferait injonction, mais plutôt à partir de l’éthique, de tenir bon et de pousser le plus loin possible, d’aller avec mes patients même quand ils me disent : « ce que je faisais avant n’a plus aucune importance ». Ça en a une ! Vous voyez un petit bourgeon qui apparaît et qu’il faut saisir parce que c’est par là qu’on peut nouer, renouer quelque chose.
Le troisième aspect par rapport à ces effets du traumatisme, c’est ce que j’ai glissé tout à l’heure et qui nous concerne nous aussi, c’est ce que j’ai appelé la neutralisation des opérateurs. Pourquoi les appeler comme ça ? C’est un terme que j’ai forgé un peu en travaillant avec les enfants, parce que nous recevons des enfants qui parfois n’ont pas vécu les événements traumatiques en première ligne, parfois ils étaient même ailleurs quand c’est arrivé. Mais ce que l’on constate, c’est qu’ils viennent très souvent – envoyés quand ils sont tout petits par la crèche, la PMI, ou plus tard par l’école – parce qu’ils ont des comportements qui interpellent : soit ils sont très violents, soit ils sont dans un repli et ils ne parlent à personne… Il y en avait un, dès que les copains disaient : « Eh viens, viens jouer avec nous ! », il en attrapait le premier, le plaquait par terre et criait : « Passeport ! Passeport ! » C’étaient les seuls mots qu’il connaissait en français. Il avait traversé plusieurs frontières, il avait déjà entendu ça. Mais, ces enfants-là, on pourrait se dire qu’il ne leur est rien arrivé. Pourquoi présentent-ils quand même ces symptômes ? Et c’est là, quand vous grattez un petit peu, quand vous écoutez l’histoire de la famille, d’un des parents ou des deux, que vous constatez qu’il y a eu effectivement quelque chose qui s’est figé, quelque chose qui a coincé, et comme effet, ce sont les parents qui sont neutralisés. C’est-à-dire que, comme ils ont eu affaire à la violence, ces parents ne s’autorisent plus à faire coupure, ce qui est tout de même leur rôle. Je vous parlais de refoulement tout à l’heure, pour transmettre un refoulement, il faut dire non à l’enfant à un certainement moment, il faut lui dire ce qui est bien et ce qui n’est pas bien. Je vous parlais aussi de nourriture, il faut lui dire ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Et là, si l’aspect culturel vous intéresse, vous savez que d’une culture à l’autre, il y a des nuances. Quand il y a eu colonisation, invasion, guerre, etc. ce dont il s’agissait c’était d’imposer le refoulement à l’autre et les différences sont parfois intéressantes. Un patient qui venait d’un petit pays des Andes, invité chez des amis, a aperçu que l’un de ses amis avait un cochon d’Inde, il lui a paru normal de lui demander s’il comptait le manger – puisque dans son pays c’est possible – mais il va sans dire qu’il ne fut plus jamais invité chez eux !
On parle de nourriture, mais c’est le découpage qui m’intéresse : comment d’une culture à l’autre on va découper ce réel différemment. Alors quand je nommais ça la neutralisation des opérateurs, ce sont ces parents-là qui se retrouvent neutralisés, incapables de dire non, incapables de mettre des limites, incapables de remplir leur rôle. Quelques fois – je vois ça quasiment toutes les semaines – l’école met un mot sur le cahier de l’enfant pour dire qu’il a fait telle ou telle bêtise, qu’il faut le reprendre à la maison, et ces parents-là disent : « Non, je ne peux pas… après ce que j’ai vécu, je ne peux pas ». Les enseignants insistent, la CPE au collège ou peu importe le niveau de l’enfant et il arrive que ces parents passent de l’autre côté : violence extrême, coups, enfermement ou d’autres choses… et, à ce moment-là, les mêmes professionnels font un signalement, une IP (information préoccupante) et les parents qui viennent me voir et me disent : « Mais, mettez-vous d’accord, qu’est-ce que je dois faire ? Je préfère ne rien faire parce que ça me coûte beaucoup ».
Alors, en ce qui nous concerne – et je ne dis pas seulement nous, psys, mais professionnels, les travailleurs sociaux ont un rôle très important là aussi –, comment accompagner ces parents à opérer à nouveau ? Comment ne pas les exclure aussi ? Parce que ceux que l’on voit souvent, ce sont des parents qui démissionnent, en disant : « Je ne comprends pas le système français », qui ne signent jamais le cahier, qui ne se sentent pas impliqués par l’école par exemple. Une école qui peut dire : « Oh non, c’est que ceux-là, ils ne parlent que russe, donc on ne peut pas s’adresser, on a arrêté de s’adresser à eux ». On a, quand on travaille avec des enfants, je pense, un rôle à jouer là aussi, d’être peut-être des connecteurs, de permettre qu’il y ait cette connexion, ce lien à nouveau, je le dis rapidement, de permettre que ces parents soient à nouveau considérés comme des parents, comme des adultes, que l’enfant voie que les adultes de l’école ou du collège considèrent ses parents comme des adultes aussi, c’est-à-dire que, ces adultes qui ont le pouvoir, qui représentent le S1 du social, associent les parents à ce S1 et, du coup, si papa ou maman doit signer mon cahier, que le psy m’a dit que je n’avais pas le droit de gribouiller dans ce cahier, que c’était un document qui circulait entre les adultes d’un côté et de l’autre, eh bien, je ne peux plus réduire mes parents à des géniteurs qui ne comprennent rien à rien. Ils sont pris dans un circuit signifiant et ça a des effets, c’est très important de savoir par où ça passe et de pouvoir les prendre dans ce circuit pour qu’ils en fassent partie et qu’ils puissent à nouveau opérer. C’est-à-dire que leur opération soit validée par l’extérieur (hors famille) et qu’ils puissent jouer ce rôle au quotidien. Vous allez me dire : « Oui, mais là vous parlez de cas idéaux, il y a des situations où ils sont tellement mal qu’ils ne peuvent pas ». C’est possible, il y a des situations où ils ne peuvent pas, mais à ce moment-là, il faut des étais, il faut des soutiens. Il y a des mesures, parfois des mesures éducatives, il y a des parfois des professionnels ou d’autres personnes qui peuvent prendre le relais. Ça m’est arrivé d’inviter – un peu comme faisait Dolto, de venir dans la salle d’attente et voir qui se lève pour le faire entrer –, il m’est arrivé d’impliquer un autre membre de la famille, par exemple un grand frère ou un parrain, qui pouvait jouer ce rôle, ne serait-ce que le temps que les parents se remettent en fonctionnement pour ainsi dire. Il y a des choses à inventer et je pense que nous avons tous un rôle à jouer.
Comment soigner le traumatisme
Je passe donc en troisième point, le dernier : comment soigner ces personnes-là ? C’est une façon pour moi de répondre à cette question : est-ce que le traumatisme nous empêche de soigner ? Alors, je vous parlais de ces cercles concentriques qui nous atteignent et c’est la première plainte que j’entends chez les professionnels, quand on fait des supervisions pour des professionnels, ou quand on les reçoit dans le cadre d’un suivi particulier, la première chose que vous voyez, ce sont des professionnels qui, au lieu de faire ce pour quoi ils sont payés, sont devenus des professionnels « guimauve ». Ils n’ont plus aucune tenue, et, de quoi ils vous parlent ? Ils vous parlent de compassion, de sympathie, de pitié, mais pour moi aucun de ces trois termes n’est thérapeutique. C’est quelque chose que j’ai appris il y a longtemps à l’hôpital Sainte-Anne, dans les présentations de malades, dans les séminaires. Il y a une vingtaine d’années, j’avais été choqué, je crois que le premier chez qui j’avais entendu ça, c’était Marcel Czermak, qui répondait à quelqu’un du groupe : « Si vous croyez qu’en étant sympathiques, vous allez soigner qui que ce soit ou que vous allez avoir des effets thérapeutiques, vous pouvez toujours vous brosser, ça ne se passe pas comme ça, le psychanalyste n’est pas là pour être sympathique, ce n’est pas avec ça qu’il va soigner ».
Je fais exprès de les mettre dans le même sac : la sympathie, la compassion, la pitié. Alors, parfois ces professionnels me disent : « Vous ne pouvez pas m’enlever ça, c’est mon ressenti, mon côté humain, j’ai fait travail social – ou j’ai fait psycho – parce que justement je suis dans l’empathie pour l’autre, je me mets toujours à la place de l’autre, je veux lui faire du bien, etc. » Je force un peu le trait, mais je leur dis que justement, quand on est dans la référence à la psychanalyse ou, a fortiori quand on est psychanalyste, il peut nous arriver d’être antipathique s’il le faut pour opérer, c’est-à-dire pour faire coupure là où il le faut, dans cette visée d’un effet thérapeutique. Il s’agit de pouvoir questionner la ponctuation avec laquelle vient le patient. Pensez à un patient lambda, qui ne vient pas avec un traumatisme tatoué sur le front, qui arrive au premier entretien et qui vous dit : « Je viens vous voir parce que je suis le dernier de la fratrie et qu’on m’a toujours mal considéré, je suis toujours celui à qui on demande en dernier, on ne donne pas d’importance à mon métier, etc. » Voilà, ça, c’est la ponctuation à laquelle il s’est accroché, à laquelle il s’est habitué, qui lui sert de carte de présentation, et vous, avec des petites coupures, vous allez interroger cette ponctuation. Vous allez peut-être lui faire entendre des choses qu’il n’entend pas ou qu’il n’entend plus tellement il s’est fixé de la sorte. Vous voyez pourquoi je rappelais « le côté fixé » de la fiction tout à l’heure, parce que la clinique du traumatisme nous concerne tous, ce n’est pas seulement pour des patients qui ont vécu des situations extrêmes à 10 000 km de chez nous. Non. Ça nous concerne tous. Les patients que je vois dans des situations extrêmes me renseignent beaucoup sur les patients que je vois au quotidien et ces allers-retours, entre ces deux cliniques un peu différentes, me font justement opérer, quelques fois de manière plus aiguë dans les différents contextes.
Alors, s’il ne s’agit pas de compassion ou de sympathie, comment travaille-t-on avec ces patients-là ? Je vais vous proposer deux axes pour terminer, quelques propositions et peut-être revenir sur certains points grâce à vos questions. Le premier point, qui n’est pas du tout une injonction que je vous fais, c’est ce que j’ai constaté, c’est ce que j’appellerai des rythmes ou des temps différents. Le premier, ce serait de créer ou de recréer du lien, c’est-à-dire que ces personnes qui viennent et qui se présentent comme isolées, pour qui la parole ne veut plus dire la même chose, qui ont été bannies par un mari, par une famille. Je pense à un homme, par exemple, qui a refusé d’être corrompu par la police, du coup la police est venue le chercher, il n’était pas là, ils ont agressé sa sœur et d’autres personnes de la famille. Il a fui avec sa femme et ses enfants en France. Vous pourriez me dire : « Mais lui-même, il n’a rien vécu de grave, de quoi il se plaint ce Monsieur ? Il est en bonne santé, physiquement, tout va bien ». Mais il vient consulter avec la culpabilité, il vient dire que c’est à cause de lui que tout est arrivé et qu’il n’a plus personne, pas d’amis, aucun lien, il ne parle à personne. Alors quand je dis, créer ou recréer du lien, ce n’est pas seulement ce lien que je vais appeler thérapeutique, avec vous, qui est un lien qui doit être codifié. Quelques fois on ne se le dit pas comme ça, on ne le nomme pas comme ça, mais c’est important de le savoir, il est codifié, c’est-à-dire, il y a un lieu, ce n’est pas n’importe où, il y a une durée, il y a une heure pour le rendez-vous. C’est aussi comme ça qu’on fait payer nos patients en institution, dans des lieux comme le Centre Primo Levi, parce que vous imaginez bien qu’ils ne peuvent pas payer les consultations. Mais l’une des façons de faire payer, parce que ça a un sens – c’était peut-être l’une des questions que vous vouliez poser tout à l’heure – bien sûr qu’il faut payer sa séance chez le psy, et eux, ils payent aussi. L’exemple que je peux évoquer serait le retard qu’un patient en institution banaliserait, à qui vous pourriez légitimement répondre : « Qu’est-ce qui vous a retardé ? Ça a son importance, et j’ai quelqu’un après, donc je ne peux pas vous recevoir, votre temps, le temps de cette séance a une valeur. Et éventuellement l’institution paye un interprète, par exemple, ce qui implique un coût, une valeur aussi, il faut que vous le sachiez, et puis si vous ratez des rendez-vous et que vous ne le justifiez pas, eh bien vous savez qu’à trois rendez-vous ratés, quelqu’un prendra la place, ça a une valeur, etc. » Et une fois que vous dites quelque chose comme ça, elles savent le prix, enfin la valeur.
Alors je parlais de créer du lien et ça passe aussi par ces codes-là, de dire : « Je suis là pour vous », mais tout en rappelant les limites de l’action de l’un et de l’autre. C’est peut-être un peu bizarre de le dire comme ça mais c’est que j’avais en tête des polémiques auxquelles j’ai pu assister, où des collègues – c’était il y a une quinzaine d’années mais ça devient très actuel avec #Metoo et autres – soutenaient qu’une femme qui avait été agressée devait être suivie par une femme. Elle n’avait encore rien demandé la dame, peut-être que si elle l’avait dit qu’elle préférait parler à une femme, on aurait pu prendre en compte. Un homme et une femme vont travailler peut-être des choses différentes, ou passer par des chemins différents pour obtenir ces effets thérapeutiques. Et c’est ce que j’ai pu voir avec des patientes qui avaient été agressées, c’est que justement, parmi ces points que j’ai appelés, ce code qui permet de refaire lien, il y a le fait que, oui je suis un homme, mais dans ce code, dans ce discours, je suis le thérapeute. Et que pour la première fois depuis ce qui lui était arrivé, la patiente se confrontait à un thérapeute qui, en tant qu’homme, s’arrêtait là, qui s’arrêtait à lui serrer la main et à constater une évolution, à lui faire quelques remarques, à lui dire : « Tiens ! Vous avez mis des boucles d’oreilles » (alors qu’avant elle venait presque déguisée en soldat, avec un treillis, avec un manteau, même l’été, etc.) Voilà, vous allez travailler justement avec ça, avec la pudeur. C’est pour ça que je vous parlais de pudeur tout à l’heure.
Créer du lien, c’est un premier temps, créer du lien qui va passer aussi par d’autres références ou d’autres thérapies voisines qui peuvent accompagner la prise en charge d’un enfant ou d’un adulte, comme des activités culturelles, sportives ou autres. C’est très intéressant d’en voir justement les effets. Au Centre Pour Primo Levi, il y a eu des propositions, du théâtre par exemple, même pour les patients qui ne parlaient pas français. J’ai été voir une des représentations et c’était très intéressant de voir un patient qui ne parlait pas français et qui faisait comme du mime mais il était présent et c’était peut-être celui qui prenait le plus de place. Pourquoi ça aide ? Rien que dans le théâtre, remarquez qu’il s’agit de jouer, c’est-à-dire que là où le traumatisme a collé la chaîne signifiante (je préférerais même le terme médical collabé), produisant, je ne l’ai pas dit comme ça tout à l’heure, mais parmi ses effets, il y en a beaucoup qui font que ces patients ressemblent à de la psychose. D’ailleurs quelques fois ils sont hospitalisés dans des services où le diagnostic différentiel est compliqué à faire. Le théâtre en tous cas remet quelque chose en jeu, remet un petit peu de distance, de dire « Je ne suis pas seulement celui que vous voyez, je peux à nouveau avoir d’autres casquettes, je peux être aussi une chaise, je peux être aussi docteur alors que je ne le suis pas, je peux… », c’est-à-dire jouer du signifiant. Il y a des effets très intéressants. Je vous parle de théâtre mais il y a aussi d’autres possibilités, autour de l’écriture, autour de la peinture, ou même du sport. Les adolescents par exemple, pour des enfants soldats qui ont vécu des horreurs, de dire, voilà, c’est du sport, il ne s’agit pas de supprimer celui qui vous a regardé de travers, mais il s’agit de marquer plus de points que lui, et pas n’importe comment, le ballon, il faut le mettre là-bas et si l’on transgresse… et ben on est exclu du jeu. Pensez aux règles, non pas du foot, mais du hand qui est très strict par rapport à ça, et c’est très intéressant de voir justement des enfants qui se prennent au jeu. Parce qu’il y a là quelque chose d’un signifiant maître mais symbolisé, et c’est ça qui est nouveau, qui est remis en jeu.
Je termine donc avec le deuxième temps du soin que j’appellerai comme ça, après la création, ou re-création de liens, il faut accompagner une séparation. Et c’est pour ça que je vous ai parlé tout à l’heure de la différence entre rupture et séparation, ça se travaille. Et c’est aussi un enjeu transférentiel : il arrive avec certains patients en institution, qui ont vécu des évènements traumatiques et qui vont mieux, vous proposez d’espacer les rendez-vous… je pense à un homme tchétchène d’une soixantaine d’années, qui s’est mis à pleurer et qui m’a dit :« Ne me laissez pas tomber ». C’est quelque chose qui se travaille justement, espacer les rendez-vous ne veut pas dire arrêt brutal, abandon. Or c’est ce qu’il craignait, il disait clairement : « Ne m’abandonnez pas ». Et accompagner la séparation est un moment très intéressant, parce qu’il s’agit d’une séparation d’ordre symbolique. C’est ce que j’ai vu notamment chez des enfants issus de viol où il y a ce premier moment, de créer un lien – c’est pour ça que j’hésitais à chaque fois quand je vous le disais de créer ou recréer, parce que parfois il s’agit de créer le lien entre cette maman qui vous amène un bébé et qui vous dit : « Je ne sais pas ce que c’est, je n’ai rien demandé, dans ma culture on ne peut pas avorter, mais qu’est-ce que je fais de cet objet-là ? » Il y a alors tout un travail, qui ne concerne pas seulement le patient, ou la patiente dans ce cas, et le bébé. Il m’est arrivé de rencontrer des équipes de professionnels, en maternité aussi, où des sages-femmes se disaient que, vu le parcours de la patiente, elle accoucherait certainement sous X et qu’il ne faudrait peut-être pas que la maman allaite parce que, justement, cela rendrait la séparation compliquée. Mais laissez-la parler ! Non ? Voyons déjà entre nous, entre professionnels, pour voir comment on accompagne ce moment de création de liens, ce lien entre cette mère et cet enfant, grâce à des signes justement par rapport à l’allaitement, par rapport aux siestes, au sommeil. Vient ensuite ce moment de bascule où le clinicien peut faire ponctuation, dire : « Bon, maintenant, comment on va se quitter ? Comment vous, vous allez vous séparer déjà de votre enfant ? » Et j’ai pu voir, cette même maman qui, 4 ou 6 mois auparavant, me disait qu’elle songeait laisser son bébé à l’église voisine, eh bien cette maman a pu me dire : « Mais vous rigolez ! Je ne vais jamais dormir sans mon enfant, il faut qu’on soit ensemble ! ». Là encore, pour des situations comme celles-ci, il m’a été très utile de m’appuyer sur d’autres professionnels, comme les crèches par exemple, avec un travail d’adaptation, accompagner tous ces mouvements d’angoisse qui peuvent apparaître à ce moment-là. Cela se travaille, s’accompagne et je pense que ça fait partie aussi de notre travail. C’est pourquoi je parlais de neutralisation d’opérateurs, nous, en tant qu’opérateur de cette coupure, on risque d’être neutralisées. Donc je terminerai avec cette idée que justement, il faut aller au-delà du traumatisme, de ne pas réduire le sujet à son traumatisme, sous peine de jouir avec lui, de cette jouissance Autre de la victime dont il est très difficile de sortir.
Merci beaucoup.
(Applaudissements)
M. Bellet : C’est nous qui te remercions bien sûr. Bon, il y aurait multitude de questions à poser. Personnellement, j’ai travaillé il y a une dizaine d’années dans un centre médico-psychologique dans une région qui était très sollicitée par ces problèmes et donc périodiquement j’avais des patients de ce profil. Mais ça m’embête de prendre tout de suite la parole, je préférerais qu’il y ait d’abord des réactions dans la salle et que on vous passe le micro pour que vous puissiez réagir à ce que vous a amené Omar Guerrero.
Question : La dernière fois, quand je vous avais suivi lors de la grande conférence[7], vous aviez déjà abordé la question de la différence entre responsabilité et culpabilité. Vous faites une différence entre être responsable et être coupable en vous basant sur la question de l’intention de l’acte, disons, lorsqu’on pose l’acte, si c’est un acte intentionnel ou non intentionnel. Je ne sais pas si en psychanalyse ça a d’autres conséquences, mais moi je suis juriste de formation et, d’un point de vue à la fois philosophique que juridique, on ne peut pas séparer la responsabilité et la culpabilité parce qu’entre les deux il y a l’imputabilité. Et de toute façon, l’intention, on peut être responsable sans justement avoir eu l’intention de poser l’acte. Ce qui compte, c’est le fait d’avoir posé l’acte, c’est répondre de ses actes être responsable et la responsabilité est liée à la culpabilité, en tout cas, on ne peut pas vraiment les séparer. Donc je n’arrive pas bien à comprendre, dans le cas par exemple du traumatisme, comment vous arrivez à séparer la personne qui est responsable de la personne qui est coupable. Alors que pour moi les deux vont ensemble. Soit on est responsable et on répond de ses actes donc on peut être coupable, ou on n’est pas responsable et on n’est pas coupable de quoi que ce soit et on est plutôt peut-être une victime ou, je n’en sais rien, une personne victime.
M. Guerrero : Alors, je vais essayer de vous répondre un tout petit à côté et je fais exprès, surtout si vous avez été à la conférence du 17 novembre dernier, et je suis désolé d’ailleurs s’il y a des choses qui vous ont semblé répétitives ou redites. Lors de cette conférence, il me semble que j’ai développé ce que j’entendais par les quatre types d’événements potentiellement traumatiques, là évidemment c’est un peu court pour les développer, mais ce qui m’intéressait, c’était de me placer justement du côté de la victime, parce que c’est la victime qui fait la demande de suivi, de thérapie, de prise en charge. Le Centre Primo Levi ne s’occupe pas des bourreaux. Si vous êtes un bourreau et que vous vous sentez tout d’un coup coupable, que vous avez des remords etc., on va vous donner une adresse et vous allez consulter ailleurs. Mais pas dans ce centre. Vous constaterez d’ailleurs que la convention de Genève – 1951 si je ne me trompe pas – ne fait qu’une seule exception, ce sont les enfants soldats, parce que les enfants soldats, ce qu’on dit, c’est que justement, quand ils ont été enrôlés de force, ou même volontaires, ils étaient mineurs et, en tant que mineurs, on ne peut pas dire qu’ils étaient conscients à 100 % de leurs actes.
Alors les quatre types d’évènement potentiellement traumatiques, pour les nommer rapidement : un attentat, une catastrophe naturelle, un accident ou la violence politique, impliquent chacun une relation différente avec un grand Autre. Et la question de l’ordre social, parce que ce qui m’intéresse par rapport à ces quatre-là, c’est que pour le sujet l’ordre social soit rétabli ou pas, de vérifier qu’on ait des moyens – juridiques notamment et le juridique est justement un appui très important du symbolique – pour pouvoir restaurer cet ordre social et diminuer les effets traumatiques.
- Quand il y a une catastrophe naturelle, par exemple, il y a des assurances qui nous permettent… et puis il y a aussi le social qui dit : « On a dû faire quelque chose pour que Dieu se fâche de la sorte et alors on n’a qu’à labourer la terre et continuer à vivre » :
- Dans un accident, c’est pareil, c’est le juridique qui va nous permettre de dire « Monsieur avait consommé tel ou tel produit, c’est pour ça qu’il ne m’a pas vu, donc, il avait l’intention, oui ou non, le juge tranche, l’avocat a gagné, bon, il paye, il ne paye pas, mais, il y a quelque chose qui est restauré.
- Et c’est pareil pour les attentats, ça mélange un peu les deux registres précédents, c’est-à-dire, ce sont des hommes, des semblables, mais qui se réclament d’un Dieu, qui veulent imposer quelque chose et on ne peut pas les juger ou c’est très rare qu’on le puisse, mais là encore, comment restaurer le social ? Le social est témoin de ce qui est arrivé, donc ça aide. Je ne suis pas seul, je ne suis pas isolé, je ne suis pas fou, c’est paru dans les journaux, ce sont des petites choses qui permettent qu’il y ait un tissu de quelque chose.
- La violence politique et la torture, c’est l’exemple le plus difficile, parce que là, en général, c’est l’impunité qui règne et il y a très peu de moyens de restaurer quelque chose d’un social.
Je pourrais encore déployer tout ça mais j’espère que je vous réponds, ne serait-ce qu’un peu, mais avec quelques éléments.
M. Bellet : En tout cas, ce qui me paraît, moi, important dans ce que tu développes là, effectivement, c’était la première partie, la répercussion sociale finalement du traumatisme, c’est le fait que quelque chose du discours a été désorganisé en quelque sorte, toute la structure du discours. Le discours c’est un lien social et c’est ce lien social qui s’est trouvé atteint, des réponses à ce niveau-là peuvent prendre une valeur thérapeutique immédiate.
M. Guerrero : Elle a justement cette valeur ; je parlais tout à l’heure de l’OFPRA ou de la CNDA, ces personnes qui ont été victimes de violences s’y rendent pour dire : « Le social de mon pays n’a pas fonctionné puisqu’il y a eu impunité, alors, de deux choses l’une, soit je suis fou – je suis devenu l’objet de l’autre, soit on me protège ». Et c’est ce qu’ils viennent demander, un abri symbolique, c’est le nom que je donne toujours à cette réponse, à ce statut qu’octroie ou pas l’État français, c’est ça qu’ils viennent chercher. Quand l’État français dit : « Je vous reconnais ce statut, c’est-à-dire que votre social, votre pays a dysfonctionné et sur notre sol, on vous garantit que cet ordre social va tenir », ça a des effets thérapeutiques, on le voit tout de suite, alors que ce ne sont pas des thérapeutes qui sont là-haut dans les bureaux, mais ça a un effet de restaurer quelque chose. Et c’est intéressant en tout cas de remarquer même la temporalité : vous voyez des symptômes qui s’apaisent et, dès qu’on s’approche d’une convocation, d’une audience ou d’une réponse probablement négative, il y a à nouveau tous les symptômes qui flambent.
Question : Je trouve que ce que vous avez dit, ça touche à la forclusion, dans les deux sens, du côté du droit et de la psychanalyse. J’ai l’impression que, chez les patients qui ont vécu ces espèces de sévices, il y a forcément une espèce de rejet, de refoulement, du côté du pays d’origine et du côté du pays d’accueil. Je ne sais pas si je suis très clair.
M. Guerrero : Non (rires), mais je vais quand même répondre quelque chose. Je n’ai pas la prétention d’être plus clair que vous mais ce que je vais essayer d’attraper dans votre remarque, c’est que ces personnes vivent comme forclusion l’impunité dans leur pays, parce que l’impunité leur dit que ce qui est arrivé n’a jamais existé. Ça n’a pas eu lieu et alors, l’alternative qu’il leur reste c’est de se dire, si ce n’est pas arrivé, j’ai rêvé, j’ai halluciné, je suis donc fou. Et la réponse négative de l’État français peut avoir quelquefois ce même effet, s’il dit : « Non, pas assez de preuves », ou « un discours stéréotypé », ou d’autres réponses possibles, qui font que la personne se dit : « Donc c’est normal que ça arrive, ils ont tué la moitié de ma famille, ils ont mis le feu au village… ce sont des choses qui arrivent ». C’est ça l’ordre – ou le désordre – social, je l’attraperai de ce côté-là, c’est pour ça d’ailleurs que vous donnez le nom de forclusion : c’est vrai que c’est un terme qui vient du droit, mais les effets qu’on voit chez ces patients ressemblent, en effet, à la psychose pour ça, parce qu’il y a quelque chose qui a été comme forclos, qui fonctionne comme une forclusion. On peut appeler ça du « psychose like », mais ce n’est pas de la psychose.
M. Bellet : La distinction que tu faisais entre rupture et séparation. Dans le champ de la rupture, ça produit aussi des refoulements massifs à valeur forclusive, ne serait-ce que du fait de l’écart culturel, dans la transmission des générations dans les familles, il y a également quelque chose de forclos de la culture d’origine par rapport à la culture d’accueil.
Question : Quel le lien faites-vous entre le symptôme de sidération et la notion de pudeur. L’absence de pudeur ou la pudeur que vous utilisez comme moyen de travail ?
M. Guerrero : Oui, c’était un peu rapide et ce n’est pas un lien que je voulais faire, vous l’avez bien entendu, il n’y avait pas de lien direct. Vous en avez sûrement entendu parler, ou peut-être l’avez-vous lu dans la presse – et je vous encourage à lire la presse parce qu’il faut savoir quel est le social dans lequel nous opérons, savoir ce qui opère dans ce social ou ce qui n’opère plus –, à propos des violences sexuelles ces dernières semaines, ces derniers mois ou peut-être même bientôt deux ans avec les affaires Harvey Weinstein et #Metoo. Je fais référence à la question de la mémoire traumatique et la sidération, ça a été travaillé, entre autres, par une psychiatre qui est très médiatique, qui s’appelle Murielle Salmona, qui est dans les journaux, interviewée très régulièrement et qui a récemment parlé de cet état de sidération, elle a rappelé qu’il fallait comprendre pourquoi souvent la victime ne réagissait pas.
Il y a donc la sidération d’un côté et pour moi la pudeur est d’un autre ordre. Pour ceux qui ont travaillé avec des enfants, par exemple des enfants autistes, vous avez entendu parler des travaux de Geneviève Haag : parle de l’œil bec pour signifier un peu cette espèce d’intrusion que fait le regard de l’autre. Chez ces patients, je retrouve quelquefois un peu cet état de méfiance par rapport à un regard qui voit tout. Ils disent : « Je suis allé acheter le pain et j’ai eu l’impression que le boulanger savait que j’ai été victime de violences sexuelles. Ça se voit dans ma façon de parler, dans ma façon de marcher, il y a quelque chose et les autres le savent, ils se rendent compte ». Ils ont l’impression d’être transparents, sans filtre. Cette patiente, que j’évoquais tout à l’heure, qui venait avec son treillis, son manteau fermé jusqu’au cou, elle cherchait à cacher, à s’envelopper comme le feraient des pelures d’oignon qu’elle mettrait sur elle pour cacher justement ce regard qui restait pour elle à jamais intrusif. La pudeur passe par le regard, mais surtout par la parole. Quels sont les mots pertinents ? Une patiente qui avait subi une excision, commençait à me détailler l’opération de reconstruction chirurgicale. J’ai dû luire dire à un moment donné : « Écoutez, vous n’avez pas besoin de me décrire avec autant de détail, dites-moi le contexte dans lequel cette opération est prise, pourquoi la faire, pourquoi ne pas la faire… » C’est une façon de remettre un voile en fonctionnement.
M. Bellet : Mais est-ce que, quand tu as parlé de sidération, d’un état d’hébétude post-traumatique, tu as aussitôt parlé, moi j’ai marqué – mais ce n’est pas ce que tu as dis – la « monstration du corps blessé », c’est-à-dire que, sous cet état un peu d’hébétude, il y a une certaine… on peut être confronté à quelque chose d’assez cru ?
M. Guerrero : Tout à fait. C’est pour ça que je disais holophrase en parlant de la cicatrice, c’est comme si la parole avait été vidée de son sens. C’est pour ça aussi que j’ai parlé de LTI ou de ses effets au niveau de la langue, ou de « l’heure du café ». Les mots ont été vidés de leur sens, il y a quelqu’un qui a décidé d’un autre sens, ça n’a plus aucun sens, aucun intérêt de passer par la parole. Ma parole n’a plus aucune valeur et donc c’est mon corps qui peut parler et quelquefois, des patients viennent vous dire : « Je n’ai rien à vous dire, regardez ».
Question : Est-ce que auprès de l’OFPRA ou de la CNDA, vous êtes appelé à témoigner parfois ? Parce qu’il arrive souvent, dans le cadre de décisions de l’OFPRA ou de la CNDA, de dire que le récit est peut-être vrai mais qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour pouvoir accorder le statut de réfugié. Or pour quelqu’un de traumatisé, un peu fermé, est-ce qu’on fait appel à votre expérience pour dire que la personne ne peut pas apporter d’autres preuves ?
M. Guerrero : Oui et non. On ne vient pas dans les audiences, mais quelquefois on nous demande une attestation, que ce soit au médecin, au psychiatre, au psychanalyste, au psychologue. On nous demande d’expliquer, pourquoi cette personne ne peut pas s’exprimer ou d’expliquer pourquoi on demande un report d’audience. À ce moment-là oui, on peut dire : « Elle n’est pas en état, elle est encore en état de choc, elle vient d’arriver, ou il y a eu un événement au pays… ». Mais c’est davantage une attestation, une attestation qui est un exercice de rhétorique, ce qui est très intéressant. Aujourd’hui je ne vous en ai pas parlé, mais quand vous m’avez entendu à la conférence l’autre jour (17 novembre), j’ai évoqué ce livre de Philippe-Joseph Salazar qui s’appelle Paroles armées[8], qui est un petit bijou, comme je l’ai dit l’autre jour, c’est de 2015, c’est un professeur de rhétorique, justement. Et l’exercice de faire une attestation pour ces patients-là, c’est un exercice de rhétorique. Je ne peux pas dire : « Monsieur a été victime… », parce que, comme me l’ont dit les premiers avocats, qui lisaient mes premières attestations : « Mais qu’est-ce que vous en savez ? Vous n’étiez pas là ! » Et j’ai dû reformuler, pour justement me placer plutôt en expert – même si je n’aime pas m’appeler comme ça, ou me mettre dans cette position-là –, et me dire que je ne suis que psychologue clinicien, psychanalyste, alors je ne peux que constater les symptômes qu’ils présentent, qui sont éventuellement cohérents avec le récit qu’ils font. À ce moment-là, oui, c’est un papier considéré valable, pouvant aider tel patient.
M. Bellet : Merci beaucoup, on va mettre fin à cette réunion qui était très très intéressante, on remercie encore très largement Omar.
(Applaudissements)
M. Guerrero : Merci pour votre attention.
Retranscription réalisée sous la responsabilité des étudiants de l’EPhEP
Retranscription faite par : Najman Laurence
Relecture faite par : Silvana CARUSO
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La relation d’objet et les structures freudiennes, Paris, 1956-1957.
[2] Victor Klemperer, LTI, la langue du IIIe Reich. Carnets d’un philologue, Paris, Albin Michel, Agora, Pocket, 2003 (réed.).
[3] Michel Terestchenko, Du bon usage de la torture. Ou comment les démocraties justifient l’injustifiable, La Découverte, Paris, 2008.
[4] Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Mouton & Cie/Maison des sciences de l'homme, 1971, 580 pages. Réédition de l'ouvrage de 1967, lui-même réédition, avec seconde préface de l'auteur, de l'ouvrage de 1948.
[5] Office français de protection des réfugiés et apatrides.
[6] Cour nationale du droit d’asile.
[7] Conférence « Parce que la guerre », EPhEP, le 17 novembre 2018 au Centre Sèvres, Paris. Lien : https://ephep.com/fr/content/texte/journee-ephep-parce-que-la-guerre-la…
[8] Philippe-Joseph Salazar, Paroles Armées. Comprendre et Combattre la Propagande Terroriste, Paris, Lemieux Éditeur [archive], 2015 (ISBN 978-2-37344-029-4).