EPhEP, MTh2-ES6, le 18/03/2017
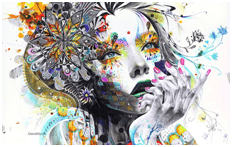
Bernard Vandermersch avait souhaité que je traite la première heure des paranoïas, et la seconde heure des autres psychoses.
Je me suis permis d’organiser les choses un peu différemment, parce que cette succession de chapitres (la paranoïa, les autres psychoses) pourrait laisser penser que tous les auteurs sont d’accord sur ce que c’est que la paranoïa — par exemple la limite entre paranoïa et schizophrénie — alors qu’à vrai dire pour qu’aujourd’hui des psychiatres puissent se mettre d’accord sur les diagnostics, il a fallu que ces diagnostics soient réduits, hélas, à leur plus simple expression — et encore, parce que si c’était leur plus simple expression ce serait au contraire une réussite. Les diagnostics sont réduits aux catégories les plus floues. J’ai apporté l’abrégé de la classification CIM-10 — c’est la classification internationale des maladies mentales numéro 10 — et donc cet abrégé est mis à la disposition des psychiatres de l’établissement où je travaille, pour qu’ils puissent coder le diagnostic des patients qu’ils ont eu à traiter (c’est une démarche obligatoire), et donc ce que ce document nous permet de voir, c’est que pour la schizophrénie il y a une quinzaine de sous-catégories, et pour ce qui ne relève pas de la schizophrénie, les choix proposés sont les suivants : « Troubles délirants persistants » et, pour ceux qui ne seraient pas satisfaits par ce diagnostic, est également proposé « Autres troubles délirants persistants » ; et si ça n’allait pas encore, le troisième diagnostic proposé est « Troubles délirants persistants, sans précisions ». Donc c’est dire l’estime dans laquelle on tient les connaissances auxquelles éventuellement les praticiens auront fait l’effort de se former. Il faut aujourd’hui à peu près cela pour que tout le monde puisse penser qu’on s’entend, c’est-à-dire que quand un collègue parle, utilise un mot comme « paranoïa », eh bien on puisse avoir une idée de ce qu’il désigne par là. Donc vous voyez, en fait j’utilise, moi, l’exemple de paranoïa, alors que ce mot ne figure pas dans le CIM. Donc, il convient de vous dire un mot sur justement la question de la nosographie, c’est-à-dire la façon dont on pourrait identifier un certain nombre de catégories, et qui mises côte à côte constitueraient une nosographie de la pathologie mentale. Dans la correspondance Freud-Bleuler, cela apparaît assez clairement, par exemple dans la distinction entre l’école allemande, l’école de Vienne. Et c’est un problème analogue pour ceux qui essaient de rassembler une pathologie autour d’un concept, c’est-à-dire de ne pas simplement être descriptif, mais d’essayer d’utiliser un concept qui permettrait de rassembler en une même catégorie différents patients. Par exemple Sérieux et Capgras qui, dans leur ouvrage Les Folies raisonnantes (1909), ont essayé, à partir du concept d’interprétation délirante, de proposer cette catégorie des psychoses délirantes dont le mécanisme de construction du délire ne serait qu’interprétatif. Or il se trouve, quand on lit leur texte, que l’on doit bien se rendre à l’évidence que bon nombre, si ce n’est la plupart des patients dont ils parlent, semblent présenter des hallucinations en plus du phénomène d’interprétation. Donc c’est dire la difficulté encore aujourd’hui de mettre une délimitation entre la paranoïa et la schizophrénie, sur laquelle tout le monde pourrait être d’accord. Par exemple une de ces limites, certains auteurs ont été tentés de dire : « Eh bien voilà, dans la paranoïa, il n’y a pas d’hallucination » ; alors évidemment, la clinique quotidienne nous montre toute le contraire. Donc c’est le premier point dont je voulais vous parler, la délicate question de la nosographie. Notre nosographie n’a pas l’exactitude d’une botanique : ce que nos mots désignent ne sont pas des espèces naturelles.
L’autre point dont je voulais parler avant d’arriver à la paranoïa et à la schizophrénie en tant que telles, c’est du concept de Spaltung. Spaltung c’est un terme allemand qui est traduit en français curieusement, selon les auteurs par « clivage » : par exemple l’article de Freud autour des années 1930 « Spaltung der Ich » (« Le clivage du Moi dans le processus de défense »), c’est traduit par « clivage » ; et chez Bleuler, Spaltung est traduit par « dissociation ». Et donc la Spaltung c’est un concept important parce qu’évidemment, on n’en retrouve pas l’incidence uniquement chez les patients schizophrènes. Le mot « schizophrénie » a été construit par Bleuler en 1911, dans une démarche critique, en tout cas avec un souhait de se distinguer de Kraepelin, qui lui avait gardé pour la schizophrénie le terme classique jusque-là de « démence précoce » ; et donc voulant se démarquer de Kraepelin, Bleuler construit le mot « schizophrénie » ; et donc la « schize », dans schizophrénie qui est un radical grec qui renvoie à Spaltung, le clivage.
Ce terme de Spaltung, Bleuler n’est pas le seul à l’employer, c’est un terme que l’on rencontre notamment chez Freud tout au long des différentes époques de son élaboration. La première incidence du mot Spaltung chez Freud, c’est lorsque Freud dans ses Études sur l’hystérie, a été amené à constater qu’il y avait deux groupes psychiques différents : une vie psychique consciente (on peut avoir le sentiment de bien la connaître), et puis une vie psychique inconsciente, qui nous détermine tout autant, mais à notre insu. Première incidence du mot « clivage » chez Freud. Ensuite Freud remarque le clivage, la Spaltung, chez le mélancolique, dans Deuil et mélancolie, et il remarque que le mélancolique porte plainte contre lui-même. C’est-à-dire qu’il y a une place qu’il occupe quand il porte plainte, et il porte plainte contre cette autre place, il se désigne quand il porte plainte contre lui-même. Vous voyez, c’est quelque chose d’assez différent du mécanisme de la honte, du mécanisme commun de la honte, où là celui qui éprouve la honte se trouve divisé, partagé, mais sur un autre mode. C’est-à-dire que Freud remarque que le mélancolique, quand il se dénonce, le fait sur un mode sans gêne, sans humilité, sans discrétion. Il ne semble pas affecté lui-même, c’est le monde autour de lui qui est affecté de ce dont il s’accuse. Vous voyez la distinction être ce qu’on pourrait appeler la division subjective commune, qu’on peut effectivement repérer dans la honte, et puis ce type de dispositif où il y a une distribution des places et où un patient peut occuper les deux places, mais des places, je dirais, qui ne sont plus articulées les unes aux autres : c’est ça, la différence entre division subjective et clivage.
La troisième occurrence du mot Spaltung chez Freud, c’est un article autour de 1925 qui s’appelle « La décomposition de la personnalité psychique ». Décomposition. Et dans cet article, Freud part de la clinique de ce qu’il appelle les « délires d’observation » pour proposer que ce qui se présente comme regard, chez le patient qui se sent observé, eh bien Freud nous propose de considérer que ce regard qui est la première phase de ce qui pourra ensuite être le jugement, c’est-à-dire la conscience morale, eh bien que ce regard chez un psychotique semble avoir pris toute son autonomie, toute son extranéité — je reviendrai sur ce terme, c’est-à-dire que c’est un regard qui lui semble être le regard de l’autre, pas du tout le sien sur lui-même. Eh bien ce regard, chez le délirant pris dans un délire d’observation, Freud nous propose de considérer qu’il s’agit de ce qui serait chez l’homme bien-portant le Surmoi, mais que dans ces cas de psychose, ce qui en principe est articulé — qui compose la personnalité, mais en étant articulé — dans la psychose, on le trouve complètement diffracté, c’est-à-dire qu’il y a là un clivage, une fracture entre ses instances différentes qui composent la personnalité et Freud nous dit une fracture à la façon dont un cristal se brise, c’est-à-dire en suivant les lignes que lui offre la structure. Vous voyez, à chaque fois la question de la Spaltung, du clivage, vient solliciter quelque chose de l’ordre d’une articulation qui serait celle que l’on trouve comme un sort commun (nous tous, tout ce qui est humain) : il n’y a pas de subjectivité qui ne se constitue d’une division subjective.
Donc le sort commun, l’homme bien-portant, lui-même est animé, sa subjectivité est animée par cette multiplicité d’instances ; et la psychose nous montre une Spaltung, c’est-à-dire un clivage entre ces instances. La dernière occurrence chez Freud du mot Spaltung, c’est celle que j’évoquais tout à l’heure, à savoir Spaltung der Ich, la division du Moi comme processus de défense. C’est un des articles les plus tardifs de Freud, c’est la dernière période, et cette fois-ci Freud nous parle d’un clivage qui ne passe pas entre des instances différentes, mais qui se produit au sein du Moi lui-même : c’est-à-dire que le Moi, qui a cette fonction d’assurer l’unité par un travail de synthèse, de conciliation, eh bien lui-même se trouve divisé. C’est-à-dire qu’il y a des propositions qui sont incompatibles, et que pourtant il adopte sans qu’il y ait entre les deux d’élaboration dialectique. Freud présente ça comme façon de se défendre contre la castration ; et alors de tenir en même temps, de considérer en même temps deux choses qui pourtant devraient donner lieu à un choix, c’est-à-dire « c’est ou ça, ou ça » eh bien non, là, ça sera les deux. Ce mode de défense contre la castration est quelque chose, là aussi, d’assez commun : dans les programmes politiques, nous avons l’occasion de voir ce processus de la synthèse qui conduit parfois à se mettre d’accord sur l’association de décisions qui auraient pu être bonnes si on avait su faire le choix qu’elles appliquaient, c’est-à-dire ne pas les associer, les considérer comme « ou bien on fait ceci, ou bien on fait cela ».
La plupart des auteurs, enfin des auteurs intéressants, réfléchissent à cette question de la Spaltung que la clinique illustre. Alors évidemment, on a parlé de Freud, Bleuler, qui ont beaucoup correspondu ensemble, et puis également un auteur dont je vous parlerai qui s’appelle Clérambault, qui est on peut dire quelqu’un qui internationalement est malheureusement aujourd’hui tout à fait méconnu, mais qui lui — je vous en parlerai parce qu’il nous propose d’organiser ce qu’on peut observer dans la psychose de telle façon que ça permet un petit peu de faire la part des choses, c’est-à-dire de voir comment il peut y avoir des cas de paranoïa pure, des cas de schizophrénie typiques, et puis entre les deux ce qu’il appelle une forme composite, à la façon d’un granit. Clérambault c’est quelqu’un qui a décrit des cas purs ; on a même pu le lui reprocher, certains ont contesté l’existence-même de ces cas : par exemple l’érotomanie pure. Il y a des collègues qui n’en ont jamais rencontré et qui considèrent que ça n’existe pas ; moi j’en ai rencontré quelques-unes. Et donc Clérambault a décrit des cas purs, et puis des cas non pas impurs mais complexes, c’est-à-dire dans lesquels les syndromes qu’on peut trouver chez certains patients exprimés de façon pure, eh bien chez ces patients-là sont mélangés à la façon des roches dans le granit. Vous voyez, la métaphore minérale, chez les psychiatres, revient souvent pour parler de la façon dont un cristal se brise, et puis là pour parler du granit.
Clérambault n’utilise pas le terme Spaltung évidemment, puisqu’il écrit en français, mais il utilise le terme de « scission », ce qui évidemment, si on devait traduire en allemand, serait Spaltung. Clérambault intitule un de ses articles « Automatisme mental et scission du Moi ». Donc tous les auteurs intéressants ont rencontré cette question. Et ce qui distingue les psychanalystes de ceux qui ne sont pas psychanalystes c’est que les psychanalystes considèrent, comme Freud nous l’indiquait tout à l’heure, que cette division du Moi a quelque chose de partagé, de commun entre les êtres humains ; la façon dont nous pouvons interroger la clinique à laquelle nous sommes confrontés, c’est justement d’essayer de comprendre comment cette division, qui fonctionne assez bien chez l’homme bien-portant, prend cet aspect dans la pathologie psychotique.
Les psychiatres qui ne sont pas psychanalystes comme par exemple Bleuler ou Clérambault, estiment eux qu’au départ il y quelque chose d’organique, et que donc, si c’est d’un patient psychotique dont il vient nous parler, ça ne nous permet pas de nous interroger sur ce qui serait notre propre expérience. Il y a là une cause organique. Ça aussi, la question de la cause est tout à fait intéressante, mais sûrement ce que je vous raconte doit vous apparaître comme très décousu, je suis désolé… Je m’expose à illustrer moi-même un des chapitres dont nous parlons, la schizophrénie, puisque par exemple il y a parmi les signes de la schizophrénie ce qu’on appelle le discours « diffluant », ou digressif : voilà, un patient qui va de digression en digression, et puis au bout d’un moment on se rend compte qu’on ne nous a apporté aucune des informations que l’on attendait. Je suis en train justement de faire une digression : Bleuler avait proposé d’expliquer ça comme ça, par le défaut d’une « représentation de but » [Zielvorstellung]. Et représentation de but, c’est aussi un terme qui est partagé entre Bleuler et Freud : c’est ce qui permettrait à quelqu’un de parler de telle façon que ceux qui l’écoutent pourraient avoir une idée de là où il veut en venir, par exemple. « Représentation de but » apporte en principe une certaine unité au discours, entendu comme la parole, mais aussi les actes.
Je reviens à la question de la cause de ce qui fait qu’un patient délire… C’est une question intéressante, les auteurs ont échangé là-dessus, ont fondé des points de vue différents. Il y a d’abord chez Bleuler et chez Freud en même temps, l’idée qu’il convient de distinguer deux choses : la cause du déclenchement de la maladie, qui elle éventuellement se rencontre dans le cours d’une existence — parce que vous savez que Freud proposait que la cause de la paranoïa pouvait se trouver dans le refus d’une homosexualité ce sur quoi Bleuler n’était pas d’accord, pour lui la cause de la psychose était organique - Freud lui-même, à partir de son travail sur les mémoires du Président Schreber [Mémoires d’un névropathe], a fait tout un travail compliqué pour montrer effectivement qu’on pouvait repérer deux temps dans la psychose : le temps du déclenchement, où la maladie s’exprime sous les caractères que nous lui connaissons ; mais un temps précédant, qui est celui de la Ververfung première — Ververfung c’est un terme allemand qui a été traduit par Lacan par « forclusion » — et donc forclusion d’un signifiant, c’est-à-dire qu’un signifiant est au départ rejeté ; et donc cette forclusion initiale peut avoir lieu extrêmement précocement. Extrêmement précocement, on terminera là, je reprendrai un petit truc de Freud, un petit truc de Lacan, et vous verrez que ça peut survenir avant l’enfance, même : c’est précoce. Tout ça pour dire que quand on commence à ouvrir la question de la cause, eh bien il y a beaucoup de travail, il faut vraiment se donner du mal pour essayer d’articuler quelque chose qui soit un peu, comment dire… un peu rationnel. C’est la grande confusion dans les débats entre organogenèse et psychogenèse : la grande confusion tient dans le fait que ceux qui défendent l’organogenèse prêtent à leurs adversaires l’idée que la psychogenèse serait simplement une réaction psychologique qui reviendrait à l’âge adulte au moment du déclenchement de la maladie. Pas du tout : la psychodynamique est à l’œuvre, comme je vous l’ai dit, extrêmement précocement.
Partant de l’idée que les choses ne sont pas si simples que nous aimerions qu’elles soient, et que donc on peut difficilement se contenter de parler d’un côté des paranoïas, de l’autre des schizophrénies, j’ai fait le choix de vous parler dans un premier temps, pour terminer notre première heure, des grands syndromes. Des grands syndromes au sens où ils peuvent être rencontrés dans tout le champ de la nosographie : toute psychose est susceptible dans son évolution, à un moment, de s’exprimer sur le mode d’un de ces syndromes.
Je commence par le syndrome de Cotard, dont vous avez probablement déjà entendu parler : Cotard est, comme Freud, et un certain nombre d’autres, un élève de Charcot, et le syndrome de Cotard est un syndrome qui internationalement est reconnu, qui figure dans la CIM-10 dont je vous parlais tout à l’heure. Un psychiatre français dont vous avez dû entendre parler aussi, qui s’appelle Jules Séglas, a donné son nom au syndrome de Cotard, puisque le psychiatre qui avait décrit ce syndrome l’avait appelé autrement : Jules Cotard l’avait appelé le « délire de négation », ce qui est aussi une bonne nomination. Donc le « délire de négation », c’est un délire hypocondriaque (qui porte sur le corps) qu’on rencontre dans les formes graves, très graves de mélancolie anxieuse ; et parmi les idées délirantes, il y a à la fois des idées d’immortalité, d’éternité — les patients se disent à la fois déjà morts, et qu’en même temps, comme ils sont morts et qu’ils continuent à vivre, ils sont immortels — et également ils affirment qu’ils n’ont pas certains organes, comme par exemple pas de cœur, pas d’intestin, ou bien que ces organes sont pourris, bouchés… Donc syndrome de Cotard, et c’est l’occasion d’évoquer au passage ce moment particulier que décrit le Président Schreber, dans sa biographie, le moment où il se croit déjà mort parce qu’il croit lire dans un article de presse qu’on annonce sa mort. C’est ce que Lacan reprendra comme « la mort du sujet », qui est un événement qui peut se produire dans le cours d’une psychose. Une des formes de mélancolie, qui serait un état apparenté à la mélancolie, peut être considéré comme un carrefour des psychoses, ainsi que Freud le propose : à partir d’un état mélancolique ; ensuite un patient peut s’orienter vers les différentes formes distinctes de la clinique. On peut tout de suite évoquer certaines formes de catatonie mortelle, qui en principe appartiennent aux champs de la schizophrénie, catatonie, où certains patients, s’ils sont atteints de cette pathologique psychomotrice massive, eh bien se trouvent mourir de telle façon que les réanimateurs perdent les moyens de les ramener à la vie, même les moyens de la réanimation moderne ne permettent pas de les ramener à la vie. Il y a un excellent numéro du Journal Français de Psychiatrie[JFP] qui traite de la catatonie, qui a été coordonné par Stéphanie Hergott, dans lequel il y a un article de Walter Bradford Cannon qui s’appelle « La mort “vaudou” . Et donc Cannon n’était non pas ethnologue ou ethnographe, il était physiologiste à la Harvard Medical School ; et comme physiologiste, il s’était intéressé au fait que la vie pouvait s’éteindre en quelques jours, après que des paroles d’exclusion du groupe aient été prononcées. Comment la vie dans ce cas-là, la plus organique, peut tenir pour un être humain au destin de son appartenance à un groupe, dans lequel se joue son rapport à la parole, donc sa vie psychique. C’est cela que Lacan désignait par « mort du sujet », c’est comment à un certain moment la vie psychique peut s’éteindre.
Autre syndrome, le syndrome érotomaniaque. Celui-là nous le devons à Clérambault justement, qui a décrit le discours érotomaniaque d’une façon magistrale, au point que dans les présentations de patients qu’on peut lire dans ses œuvres complètes, on peut constater qu’il sait tellement à l’avance ce que le patient va dire, il connaît tellement la structure de son discours qu’il est même capable de le formuler avant lui, et donc de lui proposer ; le patient n’a plus ensuite qu’à valider. Ce syndrome érotomaniaque, Clérambault nous dit que c’est « une caricature de la forme normale de l’espoir » : vous voyez là aussi encore une fois, il ne s’agit pas de Freud mais de Clérambault ; et pourtant il nous renvoie au sort commun. Donc on a une espèce de caricature qui vient nous montrer comment finalement ce qui chez nous est forme de l’espoir peut parfois prendre un tour parfaitement délirant, puisque dans ces structures érotomaniaques, toute déception, quelle que soit la manière dont l’homme qui est censé aimer la femme érotomane, quelle que soit la manière qu’il prend pour l’éconduire, eh bien ce sera perçu comme une mise à l’épreuve. Ça viendra comme une preuve au contraire, du fait que cette femme érotomane a été élue par le personnage en question, parce que justement elle considérera que le fait qu’il repousse l’officialisation de leur union, c’est pour mettre à l’épreuve son amour à elle. Si vous avez en mémoire le texte, vous connaissez l’histoire de Job dans la Bible ? Alors il est vertueux et puis il ne lui arrive que des tuiles. Donc voilà, il comprend qu’il s’agit de continuer à espérer, que finalement toutes ces tuiles qui lui arrivent c’est une forme de mise à l’épreuve… Cette façon dont un érotomane considère que celui qui — enfin, son objet — l’aime, c’est ce que Clérambault appellera le « postulat fondamental » : c’est quelque chose qui est postulé, qui est absolument incritiquable, à partir de quoi tout le reste découle.
Ce qui est intéressant dans cette structure érotomane, c’est que le thème initial est celui des rapports amoureux, mais que cette structure que dégage Clérambault peut parfaitement se passer du thème, et qu’on peut trouver des délires érotomanes par exemple chez un employé : un employé, ou quelqu’un qui souhaiterait être recruté et qui va considérer que le patron, justement, l’a déjà élu depuis longtemps, est déjà extrêmement intéressé par tout ce qu’il serait capable de lui apporter et, s’il ne le recrute pas encore, c’est là aussi pour le mettre à l’épreuve, pour l’inciter à « fendre l’armure » comme on dit aujourd’hui, à montrer vraiment qu’il en veut et ce qu’il est capable de faire.
Il y a aussi des érotomanies divines : où les sujets attendent une élection de Dieu et qu’en attendant ils sont dans l’épreuve.
Classiquement, je vous le dis pour votre culture, le syndrome érotomaniaque est décrit en trois phases : phase d’espoir, ensuite phase de dépit et ensuite phase de rancune — enfin c’est surtout la phase d’espoir qu’on observe le plus souvent.
Autre syndrome encore, intéressant à connaître. Tous ces syndromes, je répète ils existent sous des formes pures, et Clérambault insiste pour dire que plus ces syndromes sont purs, plus ils sont complets (c’est-à-dire qu’on y trouve tous les éléments qu’il a décrits), et plus ils sont stables et durables. Mais ces syndromes on les rencontre aussi dans le cours des psychoses, et là mélangés à d’autres éléments.
Maintenant je passe au syndrome d’illusion de Fregoli. C’est un syndrome qui a été décrit plus tardivement, en 1927, par deux psychiatres, Courbon et Fail, et ils lui ont donné le nom de Fregoli, qui était un transformiste célèbre, quelqu’un qui, dans son spectacle, changeait très très rapidement de costume scénique ; et donc on voyait des personnages parfaitement différents se présenter sur scène, alors qu’au fond il s’agissait toujours du même. Ce syndrome de Fregoli a été étudié en particulier par Stéphane Thibierge, et montre quelqu’un qui identifie toujours le même, sous les apparences les plus diverses.
On peut d’ailleurs tout de suite évoquer la façon dont ces syndromes peuvent coexister, on peut les retrouver chez un même patient. Il n’est pas rare par exemple qu’un érotomane identifie toujours le même, comme ça. Par exemple une voiture va passer, évidemment elle était conduite par l’objet, par celui qui l’aime : évidemment, c’était lui..
Autre syndrome encore, le syndrome de Neisser (Clemens Neisser) — je crois que Bernard Vandermersch vous en a parlé il me semble, puisqu’il considère que ce syndrome a une signification personnelle — est le phénomène élémentaire qu’on retrouve systématiquement dans la paranoïa. « Signification personnelle », il ne faut pas se méprendre sur ce que ça désigne : ça ne veut pas dire que quelqu’un interprète de façon très personnelle ce à quoi il a affaire ; mais ça veut dire que c’est lui à quoi se réfère tout ce qui se passe autour de lui : il est ce qui donne leur signification aux événements qui se déroulent autour de lui. On a appelé ça aussi « sentiment de référence » ; Grivois a parlé de « sentiment de centralité ». Enfin, tout cela désigne exactement la même chose que ce que Neisser avait fait valoir. Et c’est intéressant, c’est l’exemple-même de l’instauration, pour un sujet psychotique, d’un point de vue extérieur à lui-même, d’un savoir sur lui qui serait viendrait des autres. Là encore évidemment, ça nous invite à nous poser la question : et alors, est-ce que les bien-portants ne sont pas intéressés par le regard, hein ? Ce qui est intéressant, ce qu’on peut remarquer chez ces patients qui présentent un délire de signification personnelle — enfin, une expérience de la signification personnelle —, c’est que là aussi il n’y a pas de division ; ils ne participent pas au savoir dont il serait question sur eux, ils n’ont pas la moindre idée de ce dont il s’agirait. Et radicalement, un savoir de l’Autre ; et ce point de vue extérieur dont je vous parlais, ça n’est pas simplement de l’ordre du regard et de la phénoménologie du regard. Je vais vous donner un exemple qui m’avait beaucoup surpris et beaucoup intéressé : une jeune femme, dans la file d’attente pour accéder à une bibliothèque est persuadée que tous ceux qui sont dans cette file d’attente sont… je ne vais pas dire sont là pour elle, mais en tout cas qu’elle est au centre de leur attention. Et c’est intéressant parce que voilà — toujours les digressions — le terme de « délire d’observation » que Freud avait utilisé tout à l’heure, en fait il l’avait trouvé chez Meynert, qui était un psychiatre de la génération d’avant Freud, et c’est justement Meynert qui a utilisé un mot en allemand qui ne veut pas dire « observation », qui veut dire « attention » : ce serait à proprement parler un « délire d’attention ». Et donc cette jeune femme, à moment, j’ai dû lui demander, enfin l’inviter à parler un petit peu du rapport de ce qu’elle éprouvait avec le regard : ce qui était surprenant, c’est que les gens dans cette foule qui attendaient avec elle ne la regardaient pas. À la limite, c’était là où elle trouvait quelque chose de l’ordre d’une preuve, c’est que s’ils ne la regardaient pas, il y avait bien une raison. Mais elle n’en avait pas la moindre idée, ce que tous ces gens-là savaient sur elle, elle ne savait pas de quoi il s’agissait. Vous voyez, cette instauration d’un point de vue qui n’est pas immédiatement rapportable au regard, à l’extérieur peut surgir dans toutes les psychoses.
Enfin, le syndrome d’automatisme mental. C’est un syndrome là aussi très important et dont la description par Clérambault permet vraiment d’éclairer la clinique des psychoses et à mon avis la façon dont nous pouvons les distinguer, ces psychoses. Dans le syndrome d’automatisme mental, quelqu’un qui reçoit ce qui l’anime comme étranger à lui-même : ça se présente d’une façon un peu insidieuse, ce n’est pas massif d’emblée. Là aussi ça révèle un statut particulier que cette Spaltung dont nous parlions tout à l’heure peut prendre dans la psychose, puisqu’il s’agit de quelqu’un qui va par exemple, concernant le registre idéo-verbal (c’est-à-dire de la pensée), va recevoir cette pensée qui lui vient comme étrangère. Et c’est là où Clérambault utilise le terme d’« extranéité », qui est terme intéressant qui n’appartient pas au vocabulaire courant : extraneus, en latin, je crois que ça désigne le caractère, le statut d’étranger — mais pas l’étranger à l’étranger, l’étranger quand il est dans un pays donné.
Donc Clérambault nous dit qu’il y a trois formes — il le dit et c’est vrai — d’automatisme mental : idéo-verbal, dont on parlait, l’automatisme affectif et l’automatisme moteur. Et il nous dit que pour comprendre ce que c’est que l’automatisme mental, pour essayer de se faire une idée de quoi il s’agirait, lui-même proposait cela : il ne considérait pas à l’époque où il écrivait qu’il avait déjà réglé l’affaire, donc il invitait ses collègues à essayer de réfléchir, et il disait que pour essayer de se faire une idée de ce qu’est l’automatisme mental, il faut impérativement prendre ensemble ces trois automatismes. Il ne s’agit pas simplement de dire que quelqu’un a des hallucinations, qu’il a des voix, il faut aussi prendre en compte la dimension affective et la dimension motrice pour essayer de se faire une idée de cette physiopathologie, où se trouve le mécanisme qui viendrait perturber en même temps ces trois registres.
Concernant le registre idéo-verbal, Clérambault croit devoir préciser — c’est au départ un sujet d’étonnement — que la pensée qui devient étrangère le devient dans la forme-même de la pensée normale : ce n’est pas une pensée pathologique, ce n’est pas une idée délirante. Je poursuis : après l’idéo-verbal il y a l’affectif. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu’est un automatisme affectif : c’est par exemple quelqu’un qui va être envahi d’une colère, au point qu’il lui sera impossible de na pas hurler tellement il est envahi par cette colère, et qui ne reconnaîtra pas cette colère comme sienne, qui ne s’estime pas du tout en colère, s’estime au contraire animé par quelque chose qui est parfaitement étranger à lui-même. Ça c’est l’automatisme affectif.
L’automatisme moteur, par exemple — un exemple qui vous permettra de l’illustrer —, c’est un patient qui va dire : « Mes yeux se tournent vers le pantalon d’un monsieur alors que je voudrais qu’ils regardent mon chemin ».
L’automatisme mental commence donc par des petits phénomènes tout à fait discrets, qui touchent essentiellement le registre de la pensée (phénomènes d’écho de la pensée), et classiquement il est censé évoluer vers ce que Clérambault a appelé le « grand automatisme », c’est-à-dire des voix à proprement parler, sont sonorisées, avec une vocalisation, c’est-à-dire pas simplement des phénomènes intrapsychiques.
Que ce soit dans le registre idéo-verbal ou affectif, ou moteur, vous aurez remarqué ce caractère particulier que l’on désigne par le nom de « xénopathie », c’est-à-dire « ressentir comme étranger ». Et c’est important de distinguer cela de la persécution : ce n’est pas parce que quelque chose est xénopathique que c’est nécessairement persécutif ; alors qu’intuitivement on pourrait le considérer comme tel, puisque dans le mot « xénopathie » ce qui vient du radical grec concerné, en français « pâtir », évidemment c’est connoté de façon négative. Mais enfin, dans le mot « sympathie » par exemple, il n’y a pas de connotation négative. Donc xénopathie, il faut l’entendre comme ça, ce n’est pas du tout persécutif, mais bizarrement, c’est étranger.
O a fait le tour des différents syndromes. Je reprendrai après davantage en parlant de la paranoïa et de la schizophrénie, et donc éventuellement, si vous avez quelques questions, quelques points que vous souhaiteriez approfondir un peu, ou simplement prendre une petite pause. On pourra discuter après la deuxième heure également. Oui ?
