EPhEP, Mthx-CM, le 23/03/2017
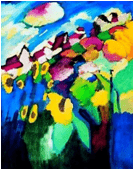
Ce que j’ai à vous raconter ce soir est très amusant mais assez difficile à exposer. Ce que je vous propose donc, c’est que si vous avez quelques difficultés en cours de route, eh bien vous vous signalez, puis je m’arrêterai et j’essayerai d’expliquer ce qui fait problème. Car comme vous le verrez, il y en a quelques-uns, qui ne sont pas tout à fait inintéressants, puisque nous allons essayer ce soir de voir de quelle façon on se névrose ou on se psychose. Voyez, ça peut avoir quelque intérêt.
Je commencerai par un souvenir ancien, très ancien, puisqu’il concerne ce qui se passait dans les villages de la Grèce, il y a quelques temps de cela, où la vie des habitants était rythmée par le passage des aèdes qui venaient raconter - quoi ? Ils venaient raconter les voyages d’Ulysse. Il est intéressant pour nous de voir la précocité de l’intérêt des Grecs pour ce qui pouvait bien se passer au-delà de la ligne d’horizon. Qu’est-ce qu’il y avait là derrière ? Si on allait plus loin, qu’est-ce qu’on allait rencontrer ? - puisque comme vous le savez leurs navires pouvaient difficilement mieux faire que de la navigation plus ou moins côtière.
Ils se rassemblent donc (ce sont tout de même ces récits qui les rassemblaient), pour découvrir ce qui pouvait bien se dérouler au-delà de la ligne d’horizon, c’est-à-dire sur ces terres inconnues, peuplées de gens parlant des langues bizarres, animées par des mœurs bizarres, exerçant éventuellement leur pouvoir de séduction et d’attraction, mais qui étaient également des régions où, du même coup, il fallait sans cesse se rassurer sur sa propre identité, puisque le message qui venait de ces zones, de ces terres, n’était pas déchiffrable, et qu’on risquait fort, si l’on voulait s’y faire bien recevoir et assimiler, de perdre son identité.
Cette remarque, que je suis en train de vous faire, a le mérite de nous signaler la précocité de cette distinction qui s’est trouvée faite entre l’environnement familier et puis l’au-delà : ce qui est étranger, ce qui ne fait pas accueil, voire ce qui peut se révéler dangereux. Vous remarquerez bien sûr que cette différence entre l’environnement familier et puis ce qui se trouve au-delà de l’horizon n’anime pas moins aujourd’hui l’intérêt d’un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens qui vont ainsi explorer au-delà de leur environnement familier, comme si celui-ci au fond avait fini par leur paraître trop habituel, trop fastidieux, et qu’il fallait aller se frotter à l’étrange.
Ce qui caractérise notre environnement familier, celui des oliviers que nous connaissions bien, c’est évidemment son aptitude à servir notre jouissance, à répondre à nos besoins. Et les éléments qui peuplent cet environnement familier sont évidemment les symboles de notre maîtrise exercée sur lui. Vous voyez qu’à le présenter de la sorte, je suis forcément et heureusement amené à situer dans cet environnement familier – et contrairement à l’espace étranger – les femmes. Les femmes qui attendent.
Alors ce sera l’occasion pour nous de faire remarquer que ceux qui, je dirais, sont sensibles au caractère esthétique de cet environnement familier, vont le peindre de deux manières. D’abord bien entendu la façon la plus simple, élémentaire : le paysage. Et puis il y a la seconde façon, c’est de peindre, comme représentatif de cet environnement familier, un corps de femme. Comme si finalement – vous voyez comme je suis bizarre tout de même, mais néanmoins ça semble bien exact – comme si finalement ce que l’on était amené à lire dans ce paysage familier et qui le représentait tout aussi bien (j’évoquais tout à l’heure la maîtrise exercé sur lui), c’était un corps de femme : corps symbolique, prometteur de la jouissance espérée de cet Autre, avec un grand A, nom que l’on peut donner à cet environnement familier.
Pourquoi l’appeler Autre ? Eh bien c’est que justement il est représentatif, cet espace, de celui qui est le lieu de recel des éléments propres à satisfaire éventuellement nos besoins (quand il s’agit d’un paysage), mais en tout cas, sûrement, nos désirs. Il y a un point qui est, je dirais, étrange : c’est que je parle donc de corps féminin, mais pour un mâle, c’est aussi bien son propre corps qui se trouve occuper cet espace Autre, ainsi projeté dans cet espace Autre, qui est son Autre, c’est-à-dire le lieu d’où il reçoit ses messages, ce lieu animé par le savoir pratique sur lequel j’ai attiré votre attention. Ce qui fait qu’on rencontre ce paradoxe – qui n’est pas sans intérêt et que la clinique soutient – qui est que le sujet, serait-il mâle, que son propre corps projeté dans cet espace Autre, représentant de cet espace Autre, se trouve féminisé.
Je passe sur le fait que ce dispositif est évidemment support à la bisexualité propre à l’être humain. Vous savez, c’est déjà l’énigme qui ouvre la genèse (c’est un bateau ce que j’évoque) : « Dieu le créa » (c’est le, pas les), « le créa homme et femme » ; c’est bizarre que tout de même ce soit inscrit de la sorte ! Mais si, néanmoins, ledit sujet souhaite que son corps se distingue par sa virilité, ce ne pourra être évidemment que par le port de cet insigne spécifique, caractéristique, qui s’appelle le sexe mâle, ouvrant à cette occasion une discussion étrange mais qui, peut-être, amusera ceux d’entre vous qui se sont intéressés à cette vieille question philosophique qui consiste à distinguer l’essence de l’accident. Question essentielle, puisque justement les Grecs posaient la question de savoir ce qui, d’un corps ou d’un objet, constitue son essence et ce qui lui est accidentel. Par exemple est-ce que la blancheur du cygne est un accident ou est spécifique de l’essence propre à cet oiseau, ce volatile sympathique ? Et ils concluaient par le fait que non : tous les cygnes étaient blancs, disaient-ils – ce qui n’est pas exact mais enfin, ils n’étaient pas allés, comme je le faisait remarquer tout à l’heure, tellement loin dans leurs explorations. Ils en concluaient que la blancheur faisait partie de l’essence du cygne.
Mais, mais, mais… pour un homme, qu’est-ce qui va constituer son essence ? Est-ce que ça va être son corps, forcément féminisé du fait du lieu qu’il va venir occuper, c’est-à-dire le lieu de l’Autre (c’est là qu’est son corps) ? Est-ce que ça va être son corps, ou est-ce que ça va être ce qu’on pourrait après tout juger comme un accident puisqu’il n’est pas forcément sur tous les corps (il y a des corps féminins qui s’en passent, de ce signe) ? Est-ce que donc l’essence pour lui est du côté de son corps, ou du côté de cet accident qui le virilise, qui en fait un corps viril ? Ce qui est également amusant – on ne cesse pas de s’amuser, vous voyez dans cette procédure – c’est que cette question, vous la verrez illustrée en clinique, c’est-à-dire par de braves sujets qui vont se demander de quel côté est leur essence. Et pour savoir si, justement, il ne s’agit - avec cet index viril - que d’un accident, après tout... puisqu’on sait très bien que des corps peuvent s’en passer.
Comme je vous l’ai fait remarquer les fois précédentes, ce corps est habité par le savoir pratique, et en particulier celui qui mène à la jouissance. Mais s’il s’agit d’un corps féminin, c’est aussi, je dirais, le support de la jouissance sexuelle : on jouit d’un corps. Sauf que – ça se complique un tout petit peu, mais légèrement, pour le moment on est dans les toutes petites complications – on ne peut pas jouir d’un corps, on ne jouit pas d’un corps en son entier, intégralement. Allez saisir un corps ! On ne peut jouir que d’un morceau de ce corps, d’une partie de ce corps, et en tant que, pour le partenaire, il se trouve pour lui dans son fantasme, représentatif, investi par l’objet de son fantasme à lui, c’est-à-dire l’objet a.
A cette occasion, on va en profiter, avoir un bénéfice, c’est-à-dire faire remarquer que le rapport sexuel va donc s’établir entre un organe mâle (dans la mesure où la jouissance va être celle de cet organe) et une partie de corps féminin représentative de l’objet a, de l’objet cause du fantasme. A vous le dire de la sorte, nous voyons mieux pourquoi Lacan peut dire qu’« il n’y a pas de rapport sexuel », puisqu’entre ce qui est d’un côté la jouissance d’un organe et, de l’autre côté la tentative de saisir l’objet cause du fantasme, on voit bien que la question de ce qui serait un rapport entre un homme et une femme se trouve complètement obscurcie, obstruée, empêchée par le dispositif.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’aborder, ce corps a un support matériel – ne vous fascinez pas pour sa biologie, qui est une chose, mais intéressons-nous à ce qui fait le prix de ce corps et qui, je dirais, est également le support de ce savoir pratique, savoir qui mène possiblement à la jouissance. Ce qui fait le support matériel de ce corps – c’est là qu’est en quelque sorte la découverte majeure, pourrait-on dire, de la psychanalyse – eh bien ce sont les éléments qui ont chu du langage : ce sont les restes, ce sont les déchets du langage dont le lieu Autre est le lieu de recel. Et ce sont eux qui viennent constituer par leur chaîne, par leur organisation textile, en un tissu, qui viennent donc organiser ce qui donne son esprit au corps : l’esprit de la lettre, et de la lettre en tant qu’elle est, à l’exemple de l’objet a, le support de la jouissance.
Or – et voilà l’événement : attention ! gare ! prudence ! allons-y mollo... ce n’est pas beau – la chute de ces éléments propres à la parole peut se faire de deux façons. Il y a une façon qui est automatique. Je veux dire que l’organisation même de la parole, de la possibilité de l’articulation des phonèmes et de leur liaison entre eux, suppose qu’il y ait des éléments qui, à tel et tel endroit, tombent de la chaîne ; et s’ils tombent ils ne sont pas perdus puisqu’ils vont se retrouver dans le lieu Autre. Et puis, il y a une deuxième circonstance qui commande cette chute, c’est le refoulement. C’est-à-dire que là les éléments tombent du langage (que ce soient des signifiants, que ce soient des phonèmes, que ce soient des lettres), ils chutent de la parole parce qu’ils sont là indus : ils ne doivent pas se dire. Et le petit père Freud a le génie d’avancer qu’il existe ce qu’il appelle un « refoulement originaire ». Originaire, ça veut dire que ce n’est pas parce qu’il y a un représentant de l’ordre moral qui vient commander le refoulement que celui-ci démarre, mais que c’est la constitution même de la langue qui implique justement cette pudeur que je viens d’évoquer. Ce que Lacan a pu illustrer à l’occasion, en faisant remarquer qu’il n’y a pas de peuple, aussi « primitif », entre guillemets soit-il, qui ne se manifeste avec un petit quelque chose pour cacher le sexe. On n’a jamais vu dans le règne animal… Si on voyait des souris commencer à se cacher le sexe, ça provoquerait un choc, ça provoquerait une certaine angoisse : qu’est-ce qui leur arrive ? On les a complètement domestiquées, ma parole !
J’essaye en tous cas de vous rendre sensibles ces deux modalités de chute d’éléments de la parole dans le lieu Autre : d’une part cette chute automatique qui, elle, n’est pas commandée par quelque pudeur que ce soit, qui se fait parce que le langage, ça fonctionne comme ça ; si je veux articuler, je suis obligé de passer par là. Et vous savez que Lacan commence ses Ecrits par ce séminaire sur « La lettre volée » pour montrer justement, d’abord – avec ce qu’il a appelé sa référence, la chaîne d’un mathématicien, la chaîne de Markov – de quelle manière s’opérait la chute spécifique de tel ou tel élément dans une chaîne formalisée (c’est extrêmement simple, ce n’est pas la peine que je reprenne ça, je vous y renvoie), et puis les conséquences que vont avoir dans ce conte de Poe, le fait que la lettre qu’il ne faudrait pas (c’est-à-dire la lettre adressée par le Duc de Buckingham à la Reine), en tant qu’elle est là justement symbolique de la lettre qu’il ne faudrait pas (puisqu’elle vient dire le désir de la reine, qui est parfaitement illégitime, interdit, qui, s’il était dévoilé, la mènerait à l’échafaud), et donc de quelle manière la présence de cette lettre du duc de Buckingham dans le conte, dans le récit, va entraîner un certain nombre de conséquences, dont l’analyse que Lacan en fait est fort intéressante ; et y compris dans sa conclusion que je vais juste évoquer, et qui en général est parfaitement incomprise, lorsqu’il dit qu’une lettre va forcément aboutir à son destin, comme cela va se produire dans le conte, qui est… qui est quoi ? quel est le destin de toute lettre ? Ce n’est pas la boîte aux lettres, il ne faut pas confondre ! C’est quoi le destin de toute lettre ?
La salle : Elle féminise ?
Elle féminise, nous sommes d’accord, mais quel est son destin quand même, justement peut-être en féminisant ? Où est-ce qu’elle aboutit, où est-ce qu’elle va ?
La salle : inaudible.
Quoi ?
La salle : L’oubli.
L’oubli ? Si vous oubliez une lettre, elle, elle ne vous oublie pas, ça je vous le promets, elle va se rappeler à vous !
A la poubelle ! (rires) Eh oui ! Au titre de déchet, elle va aboutir à la poubelle, c’est-à-dire au lieu Autre ; car cet objet magnifique, support irisé du désir, est aussi, je dirais, le déchet. Et c’est le sort de toute lettre, ce qui entre parenthèses – enfin je ne voudrais pas contrarier quiconque – place l’exercice littéraire sous un signe un peu spécial, un peu particulier. Mais en tout cas, en vérifiant donc l’amphibologie, la double valeur toujours extrême de cette lettre, on s’étonnera moins qu’il y ait, chez de nombreuses femmes, cette aspiration à l’écriture. Mais tout ça, c’est une pure digression, pour nous amuser avant que je ne frappe les trois coups, c’est-à-dire avant de vous permettre de situer que si ces lettres dans le champ de l’Autre vont pouvoir être le représentant du désir, il convient que leur chute ait été commandée par le refoulement, et qu’il ordonne donc, ce sens sexuel privilégié, d’être cause et objet du désir, et dont je viens de parler à l’instant. Si ce n’est pas le cas, si la chute est automatique, eh bien se constitue au lieu de l’Autre un ensemble qui n’est plus sensé, étranger, hostile, comme ce paysage au-delà de la ligne d’horizon que j’évoquais au départ pour illustrer mon propos.
Il y a chez Lacan cette démarche qui tranche avec celle de Freud qui n’observait les manifestations de l’inconscient, c’est-à-dire le retour du refoulé, qui ne retenait ce retour du refoulé qu’à l’occasion des actes manqués, des lapsus, des symptômes, des rêves. Mais Lacan franchit un pas qu’aucun de nous ne peut méconnaître, c’est que cet inconscient, ce qui a été refoulé, ce lieu dont nous viennent nos messages, informe toute notre vie quotidienne, informe ma pensée. Autrement dit l’inconscient n’est pas seulement cet accident, qui vient comme ça dans sa manifestation me surprendre, me choquer, me heurter, me plaire, ou me déplaire, me gêner, me contrarier... mais ma pensée diurne, mes spéculations (qu’elles soient pratiques ou philosophiques), mes amitiés, mes dégoûts, mes options, ma bêtise : tout ceci est constamment informé par l’inconscient. Autrement dit, alors que je pensais tenir la maîtrise solidement, aussi bien de mon corps que du même coup de mon inconscient, en réalité, c’est lui qui commande.
Il n’y a pas très longtemps je suis parti faire une conférence dans un endroit improbable, je suis sûr qu’il n’y en a pas un parmi vous qui le connaisse, et qui est situé près d’Aix-en-Provence, près de Manosque plus exactement, et qui s’appelle Sainte-Tulle. Vous n’avez jamais entendu parler de ce bled, Sainte-Tulle ? C’est un lieu qui a été pendant longtemps le siège de manifestations ouvrières, d’un très fort corporatisme syndical et où l’éducation politique des habitants, des citoyens, est en général assez forte. Et comme – pour ne pas parler toujours devant des auditoires spécialisés – j’aime mettre à l’épreuve ce qu’il est possible de dire et de ne pas dire devant un auditoire que l’on va qualifier de populaire, j’accepte toujours l’invitation de la municipalité pour aller faire un laïus à Sainte-Tulle. Et la dernière fois, le sujet que je leur avais proposé comme thème de conférence – ce qui est amusant, c’est qu’il y a actuellement des élèves de l’école là-bas qui sont en train de suivre – je leur ai proposé comme thème de la conférence : « Est-ce que je pense avec mon cerveau ? »
Puisque nous assistons au triomphe du cognitivisme. « Est-ce que je pense avec mon cerveau ? » Je me disais, vraiment, ce n’est pas très appétissant comme proposition de conférence. Eh bien il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Comme quoi, c’est un sujet d’actualité ! C’est vrai, avec quoi on pense ? Puisque là je suis en train de vous signaler au passage que l’on pense avec son corps, à partir de son corps. Alors il y a des biologistes qui viennent de découvrir qu’il y a tout un système neuronal intestinal, donc pour eux on pense maintenant avec son intestin. Ce n’est pas une mauvaise idée ! Je vous demande pardon mais quand on est obsessionnel, ce n’est pas qu’on pense avec son intestin, c’est l’intestin qui pense, voyez. Mais j’ai pu donc faire remarquer à l’auditoire de ce lieu que j’apprécie, que j’aime beaucoup, que l’on ne pensait jamais qu’à partir de ce qui fait butée, de ce qui fait obstacle, de ce qui résiste. C’est-à-dire que ce qui donne à penser à Ulysse, ce n’est pas son environnement familier ; ce qui lui donne à penser, c’est ce qu’il y a au-delà de la ligne d’horizon et qui résiste à la maîtrise.
En tout cas, s’il est donc vrai que l’inconscient, que ce qui est refoulé revient, je dirais, en permanence (et pas seulement dans ses manifestations bruyantes de la vie quotidienne), il nous faut supposer le support physique de cette possibilité : physique, géométrique, spatial, matériel... ce que vous voudrez. Parce qu’il est évident que Freud ne pouvait qu’imaginer l’inconscient enfoui, comme les tanagras qu’il affectionnait et dont il disait que lesdits tanagras, une fois qu’ils étaient sortis à l’air, s’effritaient, que c’était comme les symptômes : une fois qu’on les avait exhibés et sortis à l’air, ils allaient comme ça se dissoudre. Donc pour lui c’étaient les profondeurs ; la psychanalyse : psychologie des profondeurs. Seulement le problème, c’est que ce qu’il y a en surface – et ça, ce n’est pas les tanagras qui peuvent en rendre compte – est entièrement déterminé par le sous-sol supposé.
Et donc il nous faut nous interroger sur la manière dont ça peut comme ça se connecter, sans aucune frontière, sans coupure. Vous vous rendez compte ? Sans discontinuité. J’ai beau refouler... je suis un grand refouleur, mais ça revient tout le temps, et plus je refoule, plus ça revient. Alors ? C’est bien justement qu’il n’y a pas frontière, pas de limite, qu’il y a continuité entre ce qui est refoulé et ce qu’on appelle le conscient, conscient qui ne sait jamais ce qu’il sait évidemment. C’est à cet endroit que s’illustre pour vous la pertinence de cette figure topologique élémentaire dont vous savez que Lacan l’a individualisée, qui s’appelle la bande de Möbius et qui nous montre comment ce qui est de l’autre côté, sans aucune coupure, sans aucune rupture, pas aussi bien revenir sur la face exposée, sur la face visible. C’est donc là un cheminement qui à l’occasion de la bande de Möbius est matérialisé, mais la bande n’a même pas besoin d’être matérialisée, je ne développe pas ça, ce n’est pas le point ; la bande de Möbius est donc le support des propriétés de l’inconscient et de son passage permanent à titre d’informateur dans la conscience.
Ce qui fait que ce qu’il y a de l’autre côté, c’est mon environnement familier ; ce n’est pas, je dirais, sur la face que j’occupe, c’est de l’autre côté, mais qui est en même temps le même côté, puisque la bande a pour propriété de n’avoir qu’une face, mais c’est Autre par rapport à la face où moi je suis venu dans l’espace me situer. Et si vous ouvrez Lacan, vous en trouvez l’illustration explicite à propos du schéma L, si je ne me trompe pas, qui est construit justement à partir du lieu qui dans la bande est la torsion caractéristique et décisive de la bande, et vous voyez parfaitement écrit par Lacan, sur ce schéma, le terme d’inconscient pour désigner donc ce qui viendrait se situer de l’autre côté de la même face. Voyez comment ça vient déranger nos habitudes mentales, ça, notre rapport ordinaire à l’espace-plan, à l’espace cartésien. Et c’est donc ce qui fait que nous avons avec ce qui est de l’autre côté de cette même face et qui constitue, en tant qu’Autre, notre environnement, ce rapport de familiarité et en même temps, évidemment, d’appréhension au titre d’éléments supports de la jouissance. Freud s’étonnait qu’il n’y ait pas de propos qui ne soit vectorisé par la libido. C’est une forme de pansexualisme qui signifie que quoi que tu penses, en dernier ressort, et quoi que tu croies, c’est la libido qui fait marcher ta pensée. C’est une leçon qui est rarement retenue, à cause du refoulement justement.
Or – et c’est là que je poursuis, je dirais en douceur, puisque je vois que ça a l’air de passer, à peu près – l’autre élément décisif de cette affaire, c’est que si avec ce passage permanent de mon inconscient dans ce qui est mon exposition, dans ma pensée présente, là, je me trouve amené à devoir refouler sans cesse, je suis sans cesse dans ce travail d’avoir à censurer. Même sur un divan, c’est difficile de ne pas être amené à censurer tel ou tel truc : quand même, quoi, il ne faut pas exagérer ! Libre association... on ne va pas quand même tout dire, non ? Enfin tout ce qui vient, tout dire, non, mais enfin dire tout ce qui vient... vous vous rendez-compte ? Tout ce qui vient justement, et qui est bien l’illustration de ce que j’évoque à l’instant. Tout ce qui vient ? C’est-à-dire immédiatement tout ce qu’il ne faudrait pas et tout ce qui va s’avérer difficile à dire, quelles que soient les consignes que l’on est supposé respecter. Donc il y a un travail de refoulement permanent et qui va s’avérer d’autant plus absorbant que le sujet cherchera à être plus pur, c’est bien connu : le tourment des mystiques ; plus ils cherchent à retrancher d’eux tout ce qui vient ainsi de spontanément abominable chez chacun, plus ils cherchent à retrancher, plus ils en sont évidemment obsédés. Expérience bien connue.
Or si cette chute des éléments propre à la parole se fait de façon automatique, c’est-à-dire sans être sensée, c’est-à-dire sans être vectrice de ce sens, de ce désir qu’il ne faudrait pas, de ces pensées qu’il ne faudrait pas, de ces vœux de mort, de ces vœux obscènes, de ces vœux incestueux, tout ce qu’il ne faudrait pas... – si ce n’est pas le cas (et ce n’est pas toujours le cas), à ce moment-là, nous n’avons plus affaire à une bande de Möbius, nous avons affaire à une disposition toute simple qui est une bande biface, comme si je prenais ce gobelet, je découpe une bande biface : c’est-à-dire qu’il y a d’un côté mes pensées, puis de l’autre côté ce qui a chu, et qui donc va constituer cet élément insensé, étranger, hostile, moi ne sachant pas ce que ça veut tout ça, ni même ce que ça dit, et mon message venant forcément de ce côté, je vais me trouver dans cette situation qui s’appelle tout bêtement la psychose.
J’ai calculé ça (ça m’a effrayé d’ailleurs), j’ai calculé le fait qu’il y a 60 ans, j’avais présenté un travail – j’en parle à l’occasion pour dire vraiment comment j’ai flemmardé pendant 60 ans – un travail sur ce que j’ai appelé le phénomène du mur mitoyen dans la psychose. Vous ne le trouverez nulle part, la revue où ça a été publié a évidemment disparu. Qu’est-ce que ça veut dire le phénomène du mur mitoyen ? Ça veut dire quelque chose de très joli et de très simple en même temps, ça veut dire que dans la psychose le persécuteur est toujours de l’autre côté d’une paroi commune. Si vous habitez au deuxième étage, le persécuteur, il n’est pas au quatrième ni au rez-de-chaussée, il est forcément situé de l’autre côté d’une cloison qui vous sépare immédiatement de lui. Et je n’ai pas besoin de vous faire remarquer que dans la vie urbaine qui est la nôtre, le problème des murs mitoyens, du fait de notre habitation dans des immeubles, dans des ensembles, est d’une virulence ! Ce n’est pas parce que les gens sont psychotiques. Non mais attendez, la télé, ou alors la dispute, ou alors le chien, ce que vous voudrez... ça rend les gens dingues ! Cette création artificielle, si je puis dire, d’un dispositif propre à la psychose rend les gens dingues. Et avec en plus cette situation que vous connaissez bien, c’est que si vous allez gentiment chez le voisin, gentiment, pacifiquement, avec un bon sourire, en disant : « écoutez, si vous pouviez un peu baisser votre... », eh bien ça ne marche pas ! (Rires) C’est ça qui est étrange. C’est très étrange et vous connaissez, vous connaîtrez des gens que, vraiment, ça rend marteau – c’est le cas de dire – cette affaire. Donc ce travail appelé phénomène de mur mitoyen pour signaler justement que ce qui est caractéristique de la psychose, c’est le fait que le support de l’organisation psychique n’est pas une bande de Möbius mais une bande biface, et que ça met donc dans un rapport direct avec l’étranger, avec l’hostile – et alors si en plus ça parle une langue étrangère, alors là, c’est le bouquet !
Un dernier mot encore : qu’est-ce qui fait que dans un cas il y a névrose, bande de Moebius, et dans l’autre cas, bande biface et psychose ? Eh bien ce qui fait la différence, c’est que cette chute de l’objet est attribuée dans le premier cas à l’intervention d’une instance paternelle qui est venue sexualiser cette affaire (« il y a un objet auquel tu renonces ») ; et il se trouve que c’est ce dispositif langagier nullement pré-adapté à cette affaire qui va être le support de cette chute de l’objet, mais qui dès lors devient l’objet cause du fantasme, puisque c’est celui qui manque, et donc organisateur du désir. Et dans la mesure où cette bande de Möbius s’organise à partir de ce que Lacan n’a pas moins distingué comme autre figure topologique qui est le bonnet d’évêque, le cross-cap, vous voyez que ce qui va commander cette organisation de la bande de Möbius, c’est l’instance phallique – je vous renvoie à l’étude de cette affaire – l’instance phallique en tant que justement elle est réputée être l’organisatrice de cette chute et donnant son prix, sa valeur à cet objet.
Je ne vais pas là rentrer dans des digressions ; je pourrais mais je ne veux pas entrer dans des digressions sur les différentes sortes d’objet, la différence entre l’objet anal, justement, et l’objet qui se trouve autrement sexualisé, ce n’est pas le propos. Or, pour en revenir à ce qui fait la différence de destinée, il se trouve que cette instance phallique peut parfaitement être nettoyée du champ opératoire : pas refoulée, pas niée, nettoyée, comme si elle n’existait pas. C’est ce que Lacan appelle – en reprenant un terme de Freud qui le distingue justement du refoulement – la forclusion. Il évoque la forclusion du nom du père, puisque dans ce cas, dans cette circonstance, c’est dans sa fonction paternelle, c’est en tant qu’un père vient se référer à cette instance phallique, que celle-ci est opératoire. Ce père n’ayant pas d’autre présence dans l’espace que ce nom, ce signifiant : père. Ce qui ne veut pas dire que cette instance phallique est un père ; je peux évidemment en faire la source d’une religion, mais cette instance phallique peut n’avoir d’autre représentation dans l’espace que celle du nom qui, en cette circonstance très précise et que Freud a appelée œdipienne, vient en spécifier la fonction d’être un nom, père, un signifiant. Et ce n’est pas vous faire une surprise de vous dire combien nous sommes les uns et les autres dépendants de notre relation à cette instance, qu’elle soit présente, absente, traitée de la manière qu’on voudra... et cætera, et cætera...
Donc, sans avoir soulevé trop de protestations de votre part, apparemment (en tous cas, je n’en ai pas vues), je crois vous avoir introduit pacifiquement à ce qui est la différence majeure en psychopathologie entre névrose et psychose, avec le fait que dans les deux leçons qui nous restent, nous allons pouvoir avec beaucoup plus d’aisance et beaucoup plus de tranquillité, aborder la clinique des psychoses. Et la première que j’évoquerai pour nous une prochaine fois est une clinique merveilleuse, que j’adore, et qui est celle des paranoïas : j’ai même un gros bouquin, deux années de séminaire là-dessus. C’était également le sujet de prédilection de Lacan. Sa thèse porte sur un cas de paranoïa qu’il a appelée paranoïa d’autopunition : la paranoïa est dans son rapport – il faudrait que je retrouve le titre exact – avec la subjectivité... ce titre m’avait toujours intrigué. Mais vous verrez de quelle manière je l’éclaircirai pour nous. Paranoïa d’autopunition : Lacan pensait isoler une forme de paranoïa, en réalité il sera facile de vérifier que toutes les paranoïas sont en quête d’une punition, et en général elles aboutissent d’ailleurs à ce qui sera la sanction à laquelle elles aspirent.
Est-ce que, avant de nous séparer, il y a une question que vous auriez envie de poser ? Ce n’est pas du tout obligé... moi, vous me soulagez quand vous n’en posez pas, ça me dispense d’un effort supplémentaire. Donc, merci de ne pas en poser ! (Rires)
Et donc bonne soirée et à la fois prochaine.
